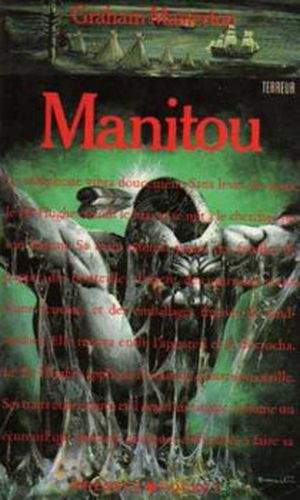Critique initialement publiée sur mon blog : http://nebalestuncon.over-blog.com/2017/08/manitou-de-graham-masterton.html
MASTERTON (Graham), Manitou, [The Manitou], traduit de l’anglais (Grande-Bretagne) par François Truchaud, Paris, Bragelonne – Milady, [1975, 2007] 2009, 380 p.
PAS TOTALEMENT UNE DÉCOUVERTE (PUTAIN…)
On ne peut pas lire que des bons livres, hein ? Et la chronique d’aujourd’hui portera donc sur un très mauvais livre – ce qui ne l’a certes pas empêché de très bien se vendre en son temps et même depuis, au point où il a suscité toute une carrière et plusieurs suites, et continue visiblement d’être porté au;pinacle par une horde de fans dont les arguments me dépassent totalement. Et il s’agit donc de Manitou, le premier roman du Britannique Graham Masterton.
Je l’avais depuis un bail dans ma bibliothèque de chevet : oui, le bouquin était célèbre, difficile de passer à côté sans jamais en entendre parler. Et j’ai lu, ici ou là, plein de critiques étrangement élogieuses… même si je me doutais un peu que mon propre avis risquait d’être un peu moins unilatéral. Surtout parce que j’avais en tête, vaguement, le retour plus que négatif de S.T. Joshi dans The Rise, Fall, And Rise Of The Cthulhu Mythos ? Mais je ne me souvenais de rien de plus précis – et notamment concernant le contenu censément « lovecraftien » du roman, en fait… Mais ça, j’y reviendrai plus tard. Même si, ne nous voilons pas la face, cette dimension censément « lovecraftienne » a pesé dans ma décision de lire enfin Manitou…
De toute façon, il était bien temps de lire enfin quelque chose de Masterton, hein ! De le découvrir !
…
Sauf qu’un aimable camarade m’a très justement fait remarquer que j’avais déjà lu un Masterton, et que j’en avais même parlé sur ce blog. Et il avait raison, le bougre… Oui, j’avais lu Démences, il y a cinq ans de cela, certes pas dans les meilleures conditions – et j’avais tout oublié de cette lecture. Sérieux. Même quand on m’a signalé ce fait, et que j’ai relu ma propre chronique, je n’en avais absolument plus aucun souvenir. Au point, en fait, de supposer avoir été la cible d’un complot. Il est parfaitement impossible que j’aie lu Démences et l’aie chroniqué, puisque je ne m'en souviens pas. C’est donc que quelqu’un d’autre a rédigé ce compte rendu, à mon insu et en se faisant passer pour moi ! Et…
Bon, d’accord.
Mais retenons-en tout de même une chose : ma chronique de Démences mentionnait que le roman louchait plus qu’un peu sur le navet, et parfois aussi (heureusement ?) sur le nanar. Même avis, globalement, concernant ce Manitou. Mais il y a pourtant une grosse différence : au sortir de Démences, tout en reconnaissant l’évidence, à savoir que ce n’était « pas bien bon », je me disais prêt à prolonger l’expérience avec d’autres bouquins de Masterton (j’ai notamment Rituel de chair dans ma bibliothèque de chevet), car il est vrai que je n’ai certes rien contre le gros bis qui tache à l’occasion. Mais, au sortir de Manitou, je suis plutôt porté à brailler :
« PLUS. JAMAIS. ÇA. »
LA GROSSE HORREUR
Contexte. Nous sommes au milieu des années 1970, et, depuis L’Exorciste, roman de William Peter Blatty (1971) et film de William Friedkin (1973), l’horreur cartonne, en littérature et au cinéma. Dans ce dernier médium, c’est « l’âge d’or » américain, d’une certaine manière, avec les premiers films des Tobe Hooper, Wes Craven, John Carpenter, etc. En littérature, c’est peut-être un peu plus compliqué ? J’ai l’impression, du moins, qu’on peut davantage faire la distinction entre d’authentiques auteurs talentueux (Stephen King perce dès 1974 avec Carrie), et quantité de faiseurs et autres tâcherons… « beaucoup moins » talentueux.
Parmi ces derniers, à l’évidence, Graham Masterton. Le futur maître (?!) de l’horreur, à l’époque, faisait office de « journaliste », essentiellement pour la presse dite « pour adultes ». Il a notamment été le rédacteur en chef de l’édition britannique de Penthouse pendant des années, et gagnait alors beaucoup d’argent, mais alors beaucoup, beaucoup, semble-t-il, en pondant à la mitrailleuse des ouvrages « de conseils sexuels ». Mais, à l’époque, il a été pris de l’idée saugrenue de tenter autre chose, pour voir, mais dans une perspective pas moins commerciale, et donc de pondre cette fois un de ces romans d’horreur qui se vendaient très bien.
La « légende » dit qu’il a écrit Manitou en une semaine (et je veux bien le croire, au vu du résultat) – un roman passablement putassier d’ailleurs (même si pas du tout dans la dimension sexuelle, ce qui m’a un peu surpris), car, à tout prendre, c’est juste un mauvais remake de L’Exorciste, et qui ne se cache même pas vraiment… Le manuscrit traîne quelque temps, puis Masterton, à la bourre pour un énième livre de théorie et pratique du sexe, le soumet en lieu et place à son éditeur anglais.
Qui l’accepte. Le roman est publié… et rencontre bientôt un très improbable succès, notamment quand il est repris en poche par un éditeur américain (avec une fin différente, j'y reviendrai) : c’est un vrai best-seller, qui remporte encore plus de pognon que les bouquins de cul, a fortiori quand il est adapté au cinéma, dès 1977 (et pour un résultat visiblement gratiné, starring Tony Curtis…), au point de décider d’une carrière – Masterton, sans pour autant laisser totalement de côté les livres de fesses, sera dès lors connu d’abord et avant tout en tant qu’écrivain d’horreur, de cette très grosse horreur qu’on dirait parfois « mainstream » et dont il a vendu des palettes entières. Et il reviendra sans cesse à ce premier succès qu’avait été Manitou, lui suscitant des suites ; on a longtemps parlé de « trilogie Manitou », mais d’autres titres se sont ajoutés depuis : en tout, à l’heure où je vous écris, la série compte semble-t-il six romans et une nouvelle.
Et, putain, ça sera sans moi.
PLUS NAZE, TUMEUR
Pitchons la chose (indicible).
Nous sommes à New York. Le roman s’ouvre sur un prologue à la troisième personne, qui voit une jeune femme du nom de Karen Tandy consulter Jack Hughes, un jeune docteur, néanmoins considéré comme le deuxième (parce qu’il est humble) spécialiste mondial des tumeurs, à propos d’une grosseur dans la nuque, et très étrange – elle semble… avoir une vie propre ? Se déplacer ? Et en tout cas elle grossit à une vitesse inouïe… Par ailleurs, un examen radiologique semble déterminer qu’il ne s’agit pas à proprement parler d’une tumeur – on dirait plutôt… un fœtus ! Qui se développe sur la nuque de la jeune femme, et à toute vitesse ! Il va falloir lui ôter ça… si la créature en germe le veut bien.
Puis le roman passe à la première personne, jusqu’à la fin. Notre narrateur est un certain Harry Erskine, prétendument un « voyant », en fait un charlatan de bas étage dans sa robe verte assortie d’un chapeau pointu (si !). Il escroque gentiment des vieilles dames riches qui viennent lui confier leurs frustrations comme à un curé ou à un psy… Parmi elles, la tante de Karen Tandy, laquelle lui rend elle aussi visite à la veille de son opération. Pas si cynique, Erskine ne se contente pas d’être étonné par la « tumeur », il l’est tout autant du rêve que lui narre la jeune femme, et qui ressemble énormément à celui que sa tante lui a continuellement évoqué : une côte, une île probablement, et à l’horizon un de ces vieux bateaux à voiles, un galion disons… Quand une autre des clientes du charlatan lui fait une improbable et fatale scène de possession démoniaque, Erskine, convaincu d’être mouillé jusqu’à l’os dans une bien étrange et redoutable histoire, troque volontiers sa robe verte ridicule contre les atours plus sobres d’un détective de l’étrange…
Cette mise en condition achevée, le roman peut sans doute être découpé en deux phases. Dans la première, on assiste à l’agrégation progressive d’un groupe de sous-héros, tous sans épaisseur aucune, mais bien décidés à lever le mystère sur cette affaire – et à sauver Karen Tandy, dont la tumeur croît à un rythme exponentiel : le Dr. Hughes ne peut pas la lui retirer, car cela tuerait aussitôt la jeune femme… L’association entre Erskine et Hughes est déjà globalement improbable, avec un médecin qui, tout scientifique qu’il soit, adhère bien vite au discours ésotérique du faux spirite (lequel se présente toujours, devant qui que ce soit, comme l’escroc qu’il est bel et bien, sans que cela lui nuise jamais), mais d’autres sous-héros s’y associent sans cesse, sans plus de vraisemblance ; certains très temporairement (ici une copine médium d’Erskine, là un distingué professeur d’anthropologie), d’autres de manière plus décisive, au premier chef le medicine man Singing Rock (outre Marino, un flic bourrin et con).
Parce que, à ce stade, les sous-héros ont parfaitement compris ce qu’il en est, bien sûr – et sans guère s’en étonner, au fond : la prétendue tumeur est bel et bien un fœtus, celui d’un vieux sorcier indien du nom de Misquamacus, qui vivait il y a trois siècles de cela, à l’époque où les Hollandais ont débarqué dans le coin pour fonder la Nouvelle-Amsterdam. Et il veut se venger des Blancs qui ont massacré son peuple ! Même s’il a donc disparu avant l’extermination des Indiens d’Amérique du Nord, et ne semble pas comprendre, à terme, ce qu’impliquent les trois siècles de son absence, notamment concernant ce génocide… D’autant qu’il avait semble-t-il eu l’intuition de ce que les maladies propagées par ces Blancs qu’il n’avait jamais vus joueraient un rôle essentiel à cet égard, mais sans bien comprendre de quoi il s’agissait, et sans même y croire – un élément crucial de la fin originelle du roman, en grand format britannique, mais squeezé dans la fin alternative, celle de l’édition de poche américaine, depuis devenue « canonique » (cette édition chez Bragelonne – Milady, pour la première fois en France, comprend les deux fins du roman, « l’originelle » après « l’alternative/canonique », ce qui implique son lot de redites), mais cela n’empêche pas le roman « retouché » de s’étendre longuement sur ce sujet dans les chapitres précédant la bascule, et pas le moins du monde revus et corrigés : Manitou est littéralement saturé d’incohérences, c’est ici un cas très voyant, mais il y en a bien d’autres…
Mais passons, pour l’heure – car il y a donc la seconde phase du roman, qui consiste en un plus ou moins long combat contre Misquamacus jailli de la « tumeur », à l’hôpital privé où exerce Jack Hughes et où Karen Tandy a sombré dans le coma quand son opération s’est révélée impossible. La fin « originelle », pour un roman sensiblement plus court ai-je l’impression, ne s’y attarde pas outre-mesure, et donne même l’effet d’avoir été salement précipitée ; elle est aussi passablement niaise, et j'y reviendrai. La fin « alternative/canonique » est plus ample, et plus tournée vers l’action, en renforçant l’idée initiale d’un véritable combat entre manitous (au sens d’esprits), mais elle n'est pas moins idiote, hélas – et, bien sûr, il faut donc prendre en compte de très nombreuses incohérences dont l’auteur et son éditeur semblaient se foutre complètement.
« LOVECRAFT », EUH
Mais Lovecraft, alors ? Que vient-il faire dans tout cela ? Pourquoi S.T. Joshi mentionnait-il ce vilain navet de grosse horreur dans The Rise, Fall, And Rise Of The Cthulhu Mythos ? Je n’en avais plus aucun souvenir en entamant ma lecture de Manitou – d’où une certaine surprise quand j’ai lu le paragraphe en exergue du roman, mentionnant le sorcier indien Misquamacus, et signé « H.P. Lovecraft ». Ce qui ne me disait absolument rien. Et pour cause : ce passage est extrait du Rôdeur devant le seuil, une des prétendues « collaborations posthumes » Lovecraft/Derleth, en fait dues essentiellement et presque intégralement au seul August Derleth, même si ces bouquins globalement navrants ont longtemps été édités, sinon sous le seul nom de Lovecraft (mais je crois que c’est arrivé), du moins en mettant Lovecraft en avant et en minimisant « l’apport » de Derleth, jusqu’à l’absurde. Mais, à en croire S.T. Joshi, Masterton a ici eu du bol, sinon du nez : le paragraphe cité est semble-t-il bel et bien de Lovecraft, il fait partie des 1200 mots du roman que l’on peut attribuer au gentleman de Providence (contre 49 000 mots écrits par Derleth…).
En tant que tel, cela ne suffit probablement guère à conférer un caractère « lovecraftien » à Manitou. À vrai dire, rien n’y suffit – mais cela n’empêche pas Masterton de charger un peu la barque par la suite, et plus encore dans la fin « alternative/canonique », plus ample, mais aussi beaucoup plus explicite à cet égard que la fin « originelle ». L’auteur n’a pas eu le mauvais goût, en dehors de l’exergue, de citer nommément Lovecraft et son univers, livres maudits et pseudo-divinités tentaculaires – et ce dans un livre dont le mauvais goût est pourtant une caractéristique essentielle. Mais ses « allusions » sont donc malgré tout explicites, et au fond tout aussi malvenues. Masterton nous décrit les manitous auxquels fait appel Misquamacus, avec quelques mises en bouche, puis, surtout, via le medicine man Singing Rock terrorisé, il nous explique que Misquamacus compte invoquer un manitou d’un ordre supérieur, dont le nom varie selon les peuples amérindiens (avec des « C » et des « L »), mais que l’on peut désigner de manière générale comme étant « le Grand Ancien » ; lequel est présenté, de manière guère pertinente et c’est peu dire, comme l’équivalent de Satan pour les Indiens (nouvelle incohérence marquée : Singing Rock avait commencé par dire que ce genre d’analogies ne faisait aucun sens ; il disait même que l’appui de la religion, chrétienne ou indienne, ne serait d’aucun poids face à pareille créature, et pourtant voyez la fin « alternative/canonique » du roman…). Une lecture derléthienne, oui… Car, quand ce manitou apparaît, ses traits ne laissent guère de doutes quant à son identité : c’est probablement Cthulhu lui-même, sinon une larve de son type… Cthulhu, oui, qui rôde dans les couloirs d’un hôpital comme un alien de seconde zone, et que notre charlatan Harry Erskine n’aura finalement guère de difficultés à contrer et même bannir, puisque c'est de bannir qu'il s'agit…
Disons-le : au-delà de ces quelques allusions, et de l’emprunt guère significatif du nom de Misquamacus à un fragment signé Lovecraft, tiré d’un roman en fait écrit par Derleth, Manitou n’a absolument rien d’un roman « lovecraftien » : c’est un roman d’horreur lambda, où les allusions « mythiques » éparses n’ont pas la moindre épaisseur, se contentant d’être des clins d’œil superflus et guère pertinents.
Le vrai problème est cependant ailleurs, et c’est que Manitou n’est pas seulement un roman d’horreur lambda – c’est un très mauvais roman d’horreur lambda : mal foutu, crétin, et même vaguement puant.
MAL FOUTU, CRÉTIN ET VAGUEMENT PUANT
Commençons par ce qui saute très vite aux yeux : Manitou est incroyablement mal écrit, avec une plume de plomb qui s’égare plus que de raison, des descriptions creuses et ineptes, des dialogues aussi percutants que ceux de Plus belle la vie, et balancés avec le même naturel, sans même parler des mauvaises blagues récurrentes, qui laisseraient perplexe même un fan hardcore de Nicolas Canteloup.
La responsabilité initiale de l’auteur est manifeste – mais on avouera que la traduction de François Truchaud n’arrange probablement rien à l'affaire… Le bonhomme a été un grand passeur dans l’édition d’imaginaire française, on peut et on doit sans doute lui reconnaître cela. Mais il m’a toujours fait l’effet d’un traducteur au mieux médiocre, et parfois bien pire encore. Dans le cas de Manitou (une traduction récente, d'ailleurs, puisque datant de 2007, bien après le pic d'activité du traducteur), c’est proprement catastrophique – presque un cas d’école (notes de bas de page intempestives incluses). Le roman en anglais n’était sans doute pas brillant, mais le passage en français est semble-t-il miraculeusement parvenu à le desservir encore, ai-je l’impression.
Avec quelques savoureuses boulettes à l’occasion ? Par exemple : « Tout ce qu'il vous faut, c'est suffisamment de force pour modifier sa course de 360 degrés. » Je ne peux pas me prononcer avec certitude quant au responsable, certes… Mais ce n’est qu’un exemple, et il y en aurait bien d’autres.
De manière générale, de toute façon, le roman est absurdement mal foutu. J’ai déjà évoqué certaines de ses incohérences – elles sont très nombreuses, tout particulièrement si l’on prend en compte les deux fins du roman, incompatibles ; or la fin « alternative/canonique » ne pourrait faire éventuellement sens qu’à la condition de remonter aux premiers chapitres du roman, pour assurer une cohésion d’ensemble ; mais ni Masterton, ni son éditeur américain ne s’en sont préoccupés : ça saute aux yeux, et, à ce stade, pareil je-m’en-foutisme relève de l’insulte.
Mais le roman ne nécessite certainement pas qu’on se livre à ce genre de pinaillages, si c’est ce que vous voulez y voir, pour afficher son caractère fondamentalement stupide. Il est saturé d’idées idiotes, et pourtant souvent prévisibles, pour un rendu assurément bisseux, mais sans rien de réjouissant hélas, sauf quand l’auteur lâche tout pour se complaire dans la nanardise. Un exemple ? SPOILER, mais j’apprécie particulièrement celui-ci, propre à la fin « alternative » : pour combattre Misquamacus et le manitou du Grand Ancien, Erskine et Singing Rock font appel à la technologie moderne – ce qui était pour le coup très prévisible. Ils usent donc d’un ordinateur de la police appelé Unitrak – qui a un manitou, car tout a un manitou, y compris les cailloux, le vent, ou, comme ici, les produits de l’inventivité humaine. Bon, admettons… Même si les scène impliquant alors Unitrak sont à la fois ridicules et invraisemblables (on lui pose carrément la question, en lignes de code : comment vaincre le Grand Ancien ?). Il y a une part d’humour volontaire, à l’évidence, mais, à ce stade de bêtise, ça ne change plus grand-chose au résultat… Le vrai souci, cependant, c’est au moment de la confrontation ultime entre ce manitou technologique et celui du Grand Ancien… quand la victoire d’Unitrak est assurée parce que le manitou de l’ordinateur, invoqué par Erskine, est « blanc » (?!) et... « chrétien » ?! Oui, oui, l’esprit d’une machine ! Et qu’importe si Singing Rock avait sans la moindre ambiguïté expliqué plus haut que l’implication religieuse chrétienne ne serait d’aucune utilité face au manitou du Grand Ancien, qui s’en moquait complètement, d’ailleurs il n’avait rien à voir avec Satan, sauf que, euh, tout compte fait, si, mais alors, euh…
Ce qui nous amène à un dernier point – même si l’on pourrait se contenter d’y voir simplement une autre forme de bêtise : Manitou est un roman qui pue quand même un peu. Je ne sais pas l’impression que cela pouvait donner en 1975, mais, en 2017, c’est quand même assez troublant. À maints égards, le roman semble avoir un postulat au moins vaguement antiraciste : Misquamacus réclame vengeance pour les siens, que les Blancs ont exterminé, et Erskine et ses copains admettent que oui certes, il a ses raisons d'être furax, et hop. Mais, dans les faits, ce postulat est en fait perpétuellement mis à mal par le comportement effectif des personnages et les pensées que leur prête l’auteur. Dans les répliques, ils disent donc parfois que le comportement de Misquamacus est bien compréhensible, mea culpa, blah blah blah mais, systématiquement, trente secondes plus tard, la conclusion demeure : il faut poutrer la gueule à ce sauvage – et limite dans ces termes. La figure même de Misquamacus manque à cet égard de cohérence, en étant tour à tour, et parfois dans le même paragraphe, une victime, un homme légitimement rancunier, un homme essentiellement maléfique, un démon, un héraut de l’apocalypse, etc. Même dans les mots de Singing Rick, l’Indien de service !
Et la manière de s’en débarrasser, dans les deux fins, est pour le moins éloquente… SPOILERS, les gens : j’ai déjà dit comment, dans la fin « alternative/canonique », le vilain Peau-Rouge est défait par le manitou blanc et chrétien d’un ordinateur américain – et c’est pour le moins gratiné. Mais que dire alors de la fin « originelle » ? Elle fait usage, avec une ironie tout de même étonnante, du principe de la contamination des Amérindiens par des germes inconnus – qui est censée avoir été la raison pour laquelle Misquamacus a effectué son rituel lui permettant de renaître trois siècles plus tard, et donc sans vraiment qu’il ait été en contact avec les Hollandais débarquant à Manhattan. Erskine, via Hughes, récupère donc un virus de la grippe, qu’il balance à la gueule de Misquamacus, bravo… Noter que, dans la fin « alternative/canonique », le roman consacre pas mal de paragraphes à cette idée du virus – mais qu’elle est finalement abandonnée laconiquement et sans plus jamais y revenir dès l’instant où la « nouvelle fin » choisit d’aborder le problème de l’élimination de Misquamacus sous un autre angle… Incohérences... Mais revenons à la fin « originelle », car il y a du lourd : elle dresse en effet un portrait moins unilatéralement « méchant » de Misquamacus, avec un gentil Erskine qui lui explique que le monde a changé, oui, certes, les Indiens ont été massacrés, par exemple à l’aide de maladies (comme celle que je t’envoie dans la gueule, PAF !), mais nous pouvons vivre tous ensemble, hey, etc. Et Erskine fait en sorte, une fois Misquamacus quasi tué par la grippe (soit en l’espace d’une demi-heure, le temps d'une poursuite tellement molle qu'elle a quelque chose de burlesque et parodique), de tout faire pour lui sauver la vie, etc. C’est le versant « hippie » du roman, mais avec armes bactériologiques quand même – et je ne sais pas si c’est avant tout niais ou condescendant. Mais pas forcément plus ridicule qu’un ordinateur blanc et chrétien, certes...
Le vrai problème, en fait, c’est de toute façon que le roman se complait dans les stéréotypes, au point où ça en devient parfois quelque peu nauséeux – ou drôle, certes… Les Indiens vus par Masterton, ce n’est pas exactement de l’anthropologie de compétition : on est en gros aux antipodes d’un Tony Hillerman. Seuls les clichés intéressent l’auteur : le simplisme est à ses yeux un atout, pouvant assurer la plus grande diffusion de son bouzin horrifique. Je ne connais certes pas grand-chose aux cultures amérindiennes, mais suffisamment pour m’apercevoir de ce que Masterton leur inflige un traitement à la truelle, même en abusant de la pseudo-caution intellectuelle du personnage anthropologue de service, et, bien sûr, du personnage indien de service.
Et les stéréotypes raciaux dépassent même parfois le seul cas des Indiens. J’ai halluciné (et beaucoup ri, j’avoue) à la lecture de cette imparable réplique : « Nous faisons peut-être fausse route, dit Amelia. Il s'agit peut-être de l'esprit de quelqu'un vivant encore de nos jours. Un nez recourbé ne signifie pas forcément qu'il s'agit d'un Indien. C'est peut-être un juif. » Eh oui, quand même… Au passage, ça vous donne une idée du niveau de l’enquête dans la première phase du roman. C'est du pointu (pas aquilin). Et ça peut vous donner aussi une idée de la traduction de François Truchaud, qui s'accommode visiblement très bien des répétitions.
Enfin, peut-être (...) faut-il dire quelques mots des femmes dans le roman ? Ce que l’auteur lui-même ne fait guère, et c’est bien le souci. J’adore, à cet égard, cette scène, au tout début du roman, où une femme, une radiologiste, vient faire passer un examen à Karen Tandy, on nous le dit… mais nous ne l’entendons pas, et ce sont ses collèges masculins qui dissertent plus ou moins doctement de la nature de la tumeur/fœtus, devant la radiologiste mais en faisant comme si elle n’était pas là : elle n'a visiblement aucun mot à dire de cet examen qui relève pourtant de sa spécialité. Les autres personnages féminins ? Karen Tandy fait l’effet d’une gentille idiote, avant de sombrer dans le coma. Les clientes de Harry Erskine sont de vieilles veuves superstitieuses, et rien d’autre. Et le vague élément féminin du groupe de sous-héros traquant la vérité occulte est donc la perspicace Amanda que j’ai citée au paragraphe précédent, médium de son état. Masterton, toutefois, nous épargne en gros toute romance (encore que Karen Tandy et Harry Erskine ont, au tout début et à la toute fin, l’occasion de flirter un brin), et toute scène de fesses (ce qui m’a surpris, pour le coup). Alors si l'on est porté à se contenter de peu...
90 % NAVET, 10 % NANAR
Mais oui, donc : Manitou est un roman mal écrit, mal foutu, idiot et parfois un peu puant. C’est une bisserie, au mieux, mais plate et convenue (je suppose que c’était déjà le cas en 1975, tant ce roman doit visiblement beaucoup à L’Exorciste, mais je peux me tromper), accumulant les mauvaises idées, accomplie avec l’implication d’un poisson rouge, et le sérieux d’un escroc. C’est un très mauvais roman d’horreur, dont le succès à l’époque a quelque chose d’incompréhensible, et la réédition aujourd’hui plus encore. C’est, globalement, un navet – mais aussi parfois un nanar, au fil de quelques scènes particulièrement gratinées, où la part de l’humour volontaire et involontaire n’est pas toujours aisée à établir.
On ne peut pas lire que des bons livres. Mais ce n’est pas une raison pour s’en infliger d’aussi mauvais. Et, à l’instar de M. Joshi, dont je ne partage pas toujours les enthousiasmes comme les dégoûts, mais pour le coup tout à fait, je n’ai aucune envie de prolonger le calvaire en m’enquillant les suites de Manitou.
Je vais tâcher aussi, cette fois, de me souvenir de ma lecture de ce roman effectivement horrible, pour ne pas m’enliser dans une autre mastertonerie dans les années à venir. Autre chose à foutre. Souviens-toi, Nébal, souviens-toi ! Le navet premier et dernier.