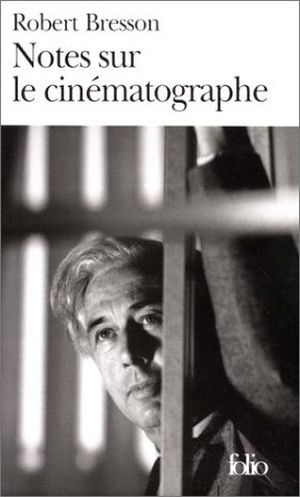Le principe des Notes sur le cinématographe est d'élaborer le propre de l'art cinématographique. Pour cela, Bresson cherche à purifier le cinématographe de tous les autres arts. Le cinématographe doit trouver ses moyens propres et s'exprimer par eux seulement. Pourquoi ? Il ne le justifie jamais, il exprime simplement son fantasme de la pureté artistique et son dégoût du métissage des arts, qui ne peut rien produire de bien à ses yeux.
Au lieu d'une pratique inter-artistique qui brouille les frontières mais élargit le champ de la création, Bresson promeut la ségrégation artistique qui réduit. Il y a une recherche bête et forcenée de la pureté à tout prix. La théorie du cinématographe incarne le pire des théories de l'art: la normativité et la prescription. Elle entrave le libre-développement de l'art avec ses prescriptions. La théorie doit se contenter de ce qu'elle est, elle ne doit pas transgresser ses limites. Elle n'a pas à dire à l'art ce qu'il devrait être mais doit se contenter de dire ce qu'il est.
Les théories de l'art sont souvent mauvaises, notamment en raison de leur caractère historique. Elles apparaissent à un certain moment du développement des arts, et se cantonnent à ce qui a été produit jusqu'à elles. Or le nouveau qui émergera après ces théories les contredit bien souvent. Une bonne théorie de l'art n'est pas normative mais descriptive, elle ne restreint pas la création mais essaie de comprendre son fonctionnement. L'existence de la théorie est déjà fragile, la théorie n'est pas nécessaire et la plupart des artistes s'en fichent complètement. La théorie de l'art n'est pas féconde, elle n'inspire pas, elle décrit simplement. Mais si en plus la théorie se permet un impérialisme que rien ne justifie (l'art émerge librement de l'artiste sans qu'on lui dicte un ouvrage), un devoir-être prescriptif, alors elle ferait mieux de se taire. Si la théorie infertile se permet en plus d'être meurtrière, de réduire le champ des possibles, elle ferait mieux de mourir seule sans emporter l'art avec elle.
Le cinématographe doit donc se purifier des autres arts. D'abord de la musique, pas de musique (« elle éloigne du réel comme une drogue »). Puis de la littérature et de la poésie. Il faut noter au passage que Bresson ne dit rien de la photographie. En effet, se débarrasser du propre de la photographie, l'image, tuerait le cinématographe. Bresson n'aborde donc jamais vraiment la photographie (il ne l'aborde qu'à un seul moment pour dire qu'elle est fausse) puisque c'est l'exemple même du métissage nécessaire des arts. Le cinématographe ne peut se contenter de son propre, il ne peut se passer du propre de la photographie. Il ne peut être pur comme le voudrait Bresson.
Et enfin, le cinématographe doit surtout se purifier du théâtre. Bresson passe le livre à distinguer son cinématographe du théâtre et du théâtre filmé/photographié: le cinéma. Bresson définit le théâtral comme ce qui emploie des acteurs et de la mise en scène. Par cette définition, Bresson annule de lui-même la distinction qu'il veut établir entre le cinéma et son cinématographe.
Mais Bresson ajoute un autre critère de distinction pour sauver cette distinction: le recours du théâtre aux acteurs qui le condamne au faux, contre l'usage par le cinématographe de modèles qui lui permet d'exprimer le vrai. Bresson veut des modèles pris de la vie, qui sont (être) au lieu de simuler (paraître). Bresson fantasme donc une naturalité, une vie naturelle, des comportements instinctifs, des paroles innées, etc. Bresson méconnaît donc la vraie nature du social, qui est la confrontation entre des individus qui élaborent des stratégies semi-conscientes à partir des codes normatifs qu'ils s'approprient et réitèrent à la manière qui leur est propre. Dans la vraie vie on est très loin de l'accord naturel entre les êtres. Il n'y a jamais un tel accord harmonieux, il y a (ré)action, puis réaction, puis réaction, etc.
Bresson fantasme donc une naturalité opposée au faux du jeu théâtral, que les modèles pourraient rétablir et reproduire. Mais qu'avons-nous en réalité ? Nous avons:
1. la vraie vie (acting (stratégies d'habitus))
2. le théâtre (acting d'acting)
3. le cinématographe (acting de non-acting)
On voit donc que le cinématographe n'est pas plus vrai que le théâtre, il est aussi faux que ce dernier puisque les deux se proposent de reproduire la vraie vie en lui retirant les conditions de son déroulement naturel. Appeler modèles des acteurs ne change rien au fait qu'il sort des personnes de la vie réelle pour les faire jouer quelque chose qu'ils ne sont pas. Bresson ne reproduit pas la vie réelle, il crée une abstraction irréelle qui est autant un jeu que le jeu théâtral, en dépit de ses dénégations.
Bresson est obsédé par le vrai et le faux. On pourrait s'en étonner venant d'un artiste. Mais Bresson est vraiment un artiste puisqu'il se contredit quelques aphorismes plus tard. Après avoir dit que le cinématographe exprimait le vrai contre le faux théâtral: il dit que le cinématographe ne cherche ni vrai ni faux. Mais s'il prétend rejeter ces critères, pourquoi est-il obsédé par le faux du théâtre, le non-naturel du cinéma ?
« Rien n’est plus faux dans un film que ce ton naturel du théâtre recopiant la vie et calqué sur des sentiments étudiés.» Et bien si, le jeu des modèles est plus faux que le jeu des acteurs. Ce jeu mime l'inexpressivité maximale, il joue la monotonie absolue, il joue l'insignifiance.
(Ces éléments ne sont pas des critiques venant de moi mais des principes qu'il revendique explicitement.) Le jeu des modèles nie tous les éléments de la vraie vie, il sacrifie une partie de la vie quotidienne au profit de l'autre: il ne montre que des paroles insignifiantes et des automatismes sans émotions. Bresson dit vouloir « Respecter la nature de l’homme sans la vouloir plus palpable qu’elle n’est ». En pratique, il la nie complètement et ne la rend pas palpable du tout.
Mais de toute façon Bresson se fiche du rationnel et du vrai, en réalité. Bresson veut de l'automatisme, il cherche à défaire l'intelligence, la pensée et la réflexivité, qui condamnent automatiquement un film. Voilà l'idée: « Les paroles qu’ils ont apprises du bout des lèvres trouveront, sans que leur esprit y prenne part, les inflexions et la chanson propres à leur véritable nature. Manière de retrouver l’automatisme de la vie réelle. » On retrouve ici la nature fantasmée, réfutée plus haut.
Mais passons. Bresson est-il au moins sûr de ce qu'il veut ? Pas vraiment, parce qu'il veut aussi « attraper des instants. Spontanéité, fraîcheur. » On peut néanmoins reconnaître qu'il ne met pas en pratique ce second précepte puisqu'aucune fraîcheur/spontanéité ne transpire de son oeuvre. En effet, Bresson oppose « au relief du théâtre le lisse du cinématographe ». Or, la vie n'est pas lisse. Le cinématographe n'exprime pas la vie à vouloir effacer tout relief
En bref, c'est une philosophie qui fonctionne avec des dichotomies aussi strictes que bêtes (acteur/modèle, cinéma/cinématographe) et qui repose sur des concepts bêtes (vraie vie, réel, moi, nature). Il n'y a rien de tel, comme nous espérons l'avoir démontré. Chaque aphorisme des Notes pourrait être brandi contre la pratique réelle, ses films, qui contredit la théorie 24 fois par seconde,