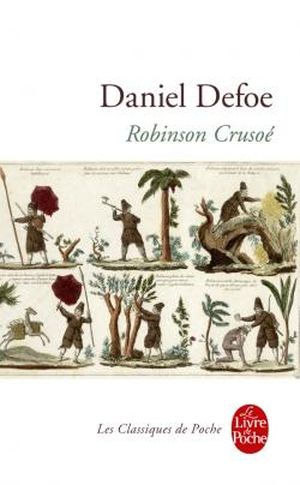Robinson Crusoé est un livre fondateur du roman moderne, car il fait fi du classicisme de la littérature pour aborder avec liberté une forme d'expérimentation permanente dans laquelle l'expérience du vécu en temps réel est primaire. C'est le premier point important de ce roman au mythe devenu universel et intemporel qui fut un succès prodigieux dès sa publication. Ensuite, Robinson Crusoé est le récit d'un naufragé qui réinvente la civilisation dans une aventure extraordinaire et qui marquera à jamais la postérité en devenant l'archétype du roman d'aventure moderne, avec un fort réalisme et une approche scientifique. Le livre donne aussi son nom à un genre important : la robinsonnade, et puis il porte en lui le prototype du livre de survie, plus particulièrement celui se déroulant sur une île déserte. À travers l'unique point de vue de son protagoniste et de sa voix, dont Daniel Defoe s'est inspiré d'Alexander Selkirk, un marin écossais qui a été abandonné sur une île du Pacifique pendant quatre années, l'auteur nous immerge dans une histoire où Robinson raconte de façon méthodique le déroulé de ses vingt-huit années de vie solitaire.
Le livre paraît pragmatique, direct et terre-à-terre, impression passant par le style de Defoe, car ce dernier va toujours droit au but et assaille le lecteur d'impressions instantanées et de notes prises sur le vif, en épousant le fonctionnement des sens et des pensées psychologiques de l'humain. Il y a donc quelque chose d'empirique, à l'image de la philosophie de John Locke, dont s'inspire l'auteur anglais. Chez Locke, comme le souligne Michel Baridon dans sa préface : « toute la vie mentale, toutes les idées, même les plus complexes, dépendent de ce que perçoivent nos sens. » C'est le premier effet que procure le roman, celui d'un journal de bord qui veut faire vrai. Le titre entier du livre en est la preuve : « La Vie et les Aventures étranges et surprenantes de Robinson Crusoé, marin natif de York, qui vécut vingt-huit ans tout seul sur une île déserte de la côte de l'Amérique près de l'embouchure du fleuve Orénoque, après avoir été jeté à la côte au cours d'un naufrage dont il fut le seul survivant, et ce qui lui advint quand il fut mystérieusement délivré par les pirates. Écrit par lui-même. »
Par ailleurs, Robinson Crusoé est de l'ordre du « traité d'éducation naturel », pour citer Jean-Jacques Rousseau et son Émile, ou De l’éducation. Effectivement, l'œuvre a une approche morale et d'apprentissage, qui est avant tout due au caractère religieux et protestant de son auteur. Le personnage est d'abord un jeune homme voulant s'aventurer vers l'inconnu, mais son père le met en garde et l'invite à ne pas prendre la voie de l'aventure maritime afin de rester confortablement dans la vie aisée que lui a offerte le travail du paternel. Robinson n'écoute pas les conseils (son « péché originel ») et se lance dans plusieurs périples lui annonçant de mauvais présages, comme par exemple les tempêtes qui sont à deux doigts de faire couler son navire, ou lorsqu'il se retrouve prisonnier aux mains de Maures. Chanceux, Robinson s'échappe, s'installe au Brésil et devient le propriétaire d'une culture de plantation. Alors qu'il est bien installé et qu'il devient riche, ce goût de l'aventure est encore en lui. Il rejoint ainsi un navire pour faire de la traite négrière. C'est là que le voyage devient fatidique et qu'il se voit naufragé sur une petite île des Caraïbes, près du Venezuela.
Tout d'abord, le roman est une invitation à suivre les signes de la Providence. Robinson apprend à connaître les signes divins, car finalement tout a une logique qui est dirigée par Dieu, puisqu'il gouverne le monde et ses créatures. L'homme a beau être désespéré au début, il a la chance d'avoir survécu, contrairement à ses camarades dans le navire. C'est l'une des premières leçons : apprendre à ne pas sombrer dans la mélancolie, car la situation aurait pu être pire (« Il faut toujours considérer dans les maux le bon qui peut faire compensation, et ce qu'ils auraient pu amener de pire. »). Tout a une bonne raison d'exister ou d'arriver, car Dieu décide de notre chemin. Au début, Robinson n'est pas croyant, mais il apprend à l'être dans la rigueur qu'il met à lire la Bible. À force de vouloir s'en sortir, Dieu peut offrir des miracles, mais pour cela, il faut comprendre et accepter les voies de la Providence. C'est pour cela que Robinson se demande : « Pourquoi lui et pas les autres ? »
Le lecteur pourrait se dire qu'il a été puni injustement de son élan libertin, mais au contraire, Dieu a sauvé Robinson de nombreuses catastrophes et lui a offert la chance de se repentir et de laver ses péchés. Dieu aurait pu l'abandonner dans une île peu fertile et sans aucune matière première pour s'en sortir. Il aurait pu ne pas laisser le navire échoué près de la plage et ne pas laisser Robinson pouvoir récupérer des objets nécessaires pour se construire son foyer. Ou encore, Dieu avait le choix de le faire échouer sur une île où se seraient trouvés directement des animaux dangereux ou des Sauvages barbares. C'est pourquoi, Dieu lui apprend à ne plus être tourmenté par ce qui lui manque, mais au contraire à être heureux et reconnaissant de ce dont il peut jouir. Ses conversations avec Dieu l’aident donc à être une meilleure personne et à faire en sorte qu'il ne se lamente pas sur son sort, pour à l’inverse avoir de la gratitude. L'extrait suivant exprime bien cette idée : « Je m'étudiais à regarder plutôt le côté brillant de ma condition que le côté sombre, et à considérer ce dont je jouissais plutôt que ce dont je manquais. [...] Tous nos tourments sur ce qui nous manque me semblent procéder du défaut de gratitude pour ce que nous avons. »
Le protestantisme est ainsi au cœur du sujet, mais l'écrivain était plus particulièrement un presbytérien. Être presbytérien, comme le dit Michel Baridon, c'est être « contre le pouvoir de l'Église établie, l'Église anglicane, à qui l'on reprochait ses cérémonies, sa hiérarchie proche de l'Église catholique et sa compromission avec le pouvoir royal considéré comme corrompu. [...] Cela signifiait aussi que l'on était résolument hostile à l'Espagne et à la France, championnes d'un catholicisme monolithique et rivales de toujours sur l'Atlantique. » S'opposant au pouvoir en place, il s'est donc retrouvé en prison à cause de ses positions non conformistes et de ses pamphlets envers le pouvoir anglican, qu'il considérait intolérant. À cela se rajoute une période où l'Angleterre avait le droit de commercer des esclaves entre l'Afrique et l'Amérique du Sud. L'auteur a rêvé de d'autres mondes, et même s'il n'est pas parti, il a capté le pouls de son époque, où le voyage, la conquête et l'exploration étaient propices. Il faut savoir que Defoe s'est retrouvé plusieurs fois en faillite, car il a été entrepreneur. L'aspect commercial lui a fait défaut ; il le dit lui-même, cet aspect « aventureux » lui a fait tourner la tête. Ainsi, Defoe a utilisé sa propre jeunesse (le récit se déroule au temps de son père, à partir de 1651) et l'actualité pour combiner cette œuvre où il met de lui.
Ainsi, dans une certaine mesure, les vingt-huit années de solitude de Robinson peuvent faire écho à la vie de Defoe qui avait, je répète, l'envie d'entreprendre une aventure commerciale, la peur pour sa vie après s'être positionné contre l'avènement du roi catholique Jacques II en 1685, puis contre la reine Anne (1702), une anglicane, qui l'a donc mis en prison et au pilori. Il eut également une identité cachée, car il fut espion et a infiltré des milieux dissidents de l’Écosse. Defoe a eu lui aussi des rêves d'ailleurs et de fortune, et il a vécu dans des milieux hostiles qui l'ont jeté dans une profonde solitude. Un sentiment d'ambivalence s'installe alors, car la morale presbytérienne de l'auteur se retranscrit dans la notion de salut de son personnage, mais elle se mêle avec une forme de réussite sociale. Robinson ne peut s'empêcher de faire le bilan moral de son état avec celui des « états des lieux, des constats d'huissiers ou des inventaires de stocks ». L'homme énumère beaucoup les objets, ses biens, ses territoires et ses propriétés, car elles fondent sa liberté. Ce thème est aussi propre à la philosophie lockienne que je citais déjà auparavant.
En effet, chez John Locke, les hommes sont nés libres, mais ils sont sociables. Leur liberté est volontairement aliénée afin de vivre en société et pour être aux normes avec les lois. Il est donc nécessaire de lier ce pacte par des accords et des contrats pour tenir en respect ce qu'ils possèdent : leur vie et les fruits de leur travail. De ce fait, l'État se base sur l'activité économique et non sur les rentes. Ainsi, lorsque Robinson se sent propriétaire et roi de son petit royaume, c'est parce qu'il se les approprie par son travail. C'est pourquoi l'aventure du protagoniste matérialise cette idée par le travail qu'il a accompli. En effet, c'est l'une des autres morales de l'œuvre : celle d'être besogneux, d’avoir la patience d'apprendre et de se mettre à l'ouvrage pour obtenir un meilleur confort pour sa propriété.
Il devient ingénieux, courageux et débrouillard, et à force de persévérance, il arrive à construire et à établir ce qu'il veut, même si ce sont des choses rudimentaires. S'il échoue dans sa tâche, il s'adapte et reste patient pour trouver une solution. C'est pourquoi Robinson prouve que l'on peut passer de l'état d'un mauvais ouvrier à un bon artisan si l'on prend le temps, avec logique et raisonnement, de mettre la main à la patte. De ce fait, le personnage fait tous les métiers dont une civilisation a besoin pour être bâtie et pour qu'une société soit fonctionnelle : architecte, charpentier, rémouleur, astronome, boulanger, constructeur naval, potier, bourrelier, agriculteur, tailleur, fabricant, etc.
Ce travail bien accompli alloue un climat de sérénité et d'équilibre dans lequel le protagoniste rentre en osmose avec la nature. L'auteur nous décrit une zone hostile qui devient un paradis perdu grâce aux changements de perception de Robinson et à son ouvrage pour le rendre idyllique. Defoe n'est pas un écrivain romantique, car il s'inscrit dans le mouvement des Lumières anglaises et dans la foi protestante. Son pragmatisme le renvoie à une forme de raison, de travail et de rationalité qui va à l'encontre du lyrisme mélancolique du romantisme. Mais il y a une dimension préromantique dans Robinson Crusoé, tout de même, car on parle d'un individu qui est seul face à la nature. Le héros questionne et doute de façon introspective et il se replie sur lui-même dans une spiritualité autocentrée, et la nature qu'il veut dominer ne devient pas seulement un espace à habiter : elle prend des contours symboliques d'une nostalgie de la pureté originelle et primitive où la civilisation est au degré zéro. Robinson trouve le bonheur dans la solitude, loin des désirs matériels de la civilisation, car il subvient seulement à ses besoins sans avoir la nécessité ni le besoin d'obtenir plus. Il le dit lui-même : « Ce fut alors que je commençai à sentir profondément combien la vie que je menais, même avec toutes ces circonstances pénibles, était plus heureuse que la détestable vie que j'avais faite durant toute la portion écoulée de mes jours. »
Mais l'œuvre nous montre qu'on ne peut s'empêcher de recréer le climat de notre civilisation, et de ce fait, le manque de la société des hommes se fait ressentir. Le personnage vacille entre la réticence et la peur, puis l'espoir et l'envie de revoir un autre homme. Robinson est souvent aussi dans cette ambivalence, avec l'envie de rester sur son île et de partir, car il est finalement profondément humain (« Aujourd'hui nous aimons ce que demain nous haïrons ; aujourd'hui nous recherchons ce que nous fuirons demain ; aujourd'hui nous désirons ce qui demain nous fera peur, je dirai même trembler à la seule appréhension ! »). Mais sa rencontre avec Vendredi remplit ce manque et installe également la relation maître-serviteur qui procure la dimension coloniale du roman. Le livre pourrait devenir gênant, mais ce n'est pas le cas, car Defoe instaure un profond respect entre les deux hommes. Je cite ce long extrait pour démontrer l'estime et la confiance qu'a Robinson pour Vendredi :
« Mais je n'avais pas besoin de tant de précautions, car jamais homme n'eut un serviteur plus sincère, plus aimant, plus fidèle que Vendredi. Sans passions, sans obstination, sans volonté, complaisant et affectueux, son attachement pour moi était celui d'un enfant pour son père. J'ose dire qu'il aurait sacrifié sa vie pour sauver la mienne en toute occasion. [...] Ceci me donna souvent occasion d'observer, et avec étonnement, que si toutefois il avait plus à Dieu, dans sa sagesse et dans le gouvernement des œuvres de ses mains, de détacher un grand nombre de ses créatures du bon usage auquel sont applicables leurs facultés et les puissances de leur âme, il leur avait pourtant accordé les mêmes forces, la même raison, les mêmes affections, les mêmes sentiments, d'amitié et d'obligeance, les mêmes passions, le même ressentiment pour les outrages, le même sens de gratitude, de sincérité, de fidélité, enfin toutes les capacités pour faire et recevoir le bien, qui nous ont été données à nous-mêmes ; et que, lorsqu'il plaît à Dieu de leur envoyer l'occasion d'exercer leurs facultés, ces créatures sont aussi disposées, même mieux disposées que nous, à les appliquer au bon usage pour lequel elles leur ont été départies. » Un peu plus loin dans le texte, Robinson met en lumière l'intelligence de l'Indien : « Je m'appliquais constamment à lire l'Ecriture et à lui expliquer de mon mieux le sens de ce que lisais ; et lui, à son tour, par ses examens et ses questions sérieuses, me rendait, comme je le disais tout à l'heure, un docteur bien plus habile dans la connaissance des deux Testaments que je ne l'aurais jamais été si j'eusse fait une lecture privée. »
C'est pourquoi la relation des deux personnages est avant tout amicale et chaleureuse. Ce fait est encore plus constatable dans l'épilogue du livre, après que Robinson soit parti de son île. Les deux hommes font ensemble une expédition pour rentrer du Portugal jusqu'en Angleterre à pied, en passant par des montagnes sinueuses. On voit toute l'alchimie de la relation qui anticipe les binômes très attachants de maître-serviteur qui sont présents chez Jules Verne. Il n'est, à mon avis, pas possible d'en vouloir à Robinson d'apprendre à Vendredi, d'inculquer ses mœurs et sa religion, car il pense bien faire pour sortir son nouvel ami de son paganisme où les sacrifices humains vont bon train. De plus, Robinson questionne lui-même son rapport avec les Sauvages, car il se demande, avant de rencontrer Vendredi, qui nous sommes pour vouloir tuer autrui parce qu'on considère qu'il le mérite. Sommes-nous juges ou l'autorité sur Terre pour pouvoir le faire ? Dieu a ses raisons de faire encore exister des Sauvages qui ont des rituels morbides, car lui seul décide de leur sort.
Par la suite, Robinson tuera des Sauvages, mais ce sera toujours pour se protéger ou protéger les autres, car les Indigènes peuvent être cruels, notamment avec les leurs. Mais il est vrai que Robinson a un esprit colonisateur et un esprit de développement, mais il le fait toujours avec une intention progressiste, à l'instar de sa volonté de laisser la liberté de conscience dans son petit royaume auprès de ses « sujets ». Cela rejoint la pensée de Guillaume III, qui a succédé à Jacques II et dont Defoe était très favorable. Guillaume III était un roi protestant ayant voté une loi qui donnait la liberté de culte aux non-conformistes protestants. De plus, le personnage a peut-être un esprit militaire propre à la discipline anglaise, à l'instar du passage où il affronte sur son île un équipage mutiné s'étant échoué sur celle-ci. Il dirige sa troupe comme un fier dirigeant, mais il reste toujours altruiste et plein de bon sens, car il laisse sa chance à ceux qui ont été déloyaux et dangereux, mais qui veulent bien demander pardon et aider la troupe. L'esprit colonisateur n'est donc pas celui d'un despote cruel, mais celui d'une attirance pour l'inconnu, l'aventure et le besoin d'étendre sa civilisation. Tout cela est de l'ordre de l'inconscient, car Robinson est un être social, qui, malgré le bonheur de la solitude, n'a pu s'empêcher d'être en manque des hommes. Pour paraphraser Michel Baridon, Robinson réinvente la civilisation parce qu'il en a besoin, et son île devient un microcosme qui devient « image du monde ».
Pour conclure, en pleine période d'expansion continentale, mais aussi dans une période composée de raisonnements où la tolérance religieuse devenait une clé de voûte, le livre est aussi le précurseur d'un mouvement qui bâtira tout le XIXe siècle, celui du romantisme, et qu'un penseur comme Jean-Jacques Rousseau va développer par la suite en ayant parmi ses milliers de références celle de Robinson Crusoé. Surtout, le livre nous parle tant aujourd'hui, car notre monde moderne est tellement étouffé par la technologie, la surconsommation, la perte de la foi et la fainéantise que l'œuvre nous invite à revenir vers l'essentiel. C'est-à-dire à retrouver le goût de l'effort et de la discipline pour le travail bien fait, à tout reprendre depuis l’origine, pour réapprendre et mieux se réapproprier le monde, à se construire son propre confort sans qu'il soit offert sur un plateau, à se satisfaire de ce que l'on a déjà et puis à apprendre à vivre dans la solitude afin de se retrouver en soi-même. Le livre rappelle que nos civilisations sont bâties par des artisans méticuleux, mais aussi par une forte croyance en Dieu et par l'accompagnement des signes de la Providence. Qu'importe si nous sommes croyants ou non, qu'importe notre religion, soyons reconnaissants de notre sort, de profiter des beautés de l'univers et de pouvoir hériter et transmettre afin d'édifier la mémoire de nos civilisations dans le temps.