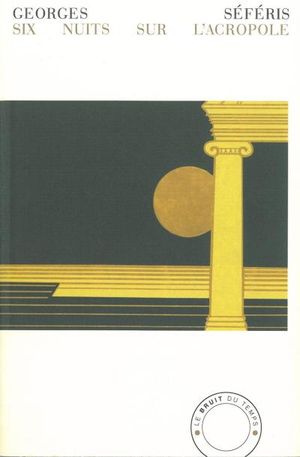Unique roman, publié après sa mort, du premier Nobel grec de littérature, le poète Georges Séféris, Six Nuits sur l’Acropole est très exactement, et donc à double-titre, ce que son traducteur Gilles Ortlieb appelle un « roman de poète », pudique euphémisme indiquant que le livre brille moins par ses qualités narratives que son esthétique générale. Il indique dans sa préface que si le texte est souvent présenté comme un écrit de jeunesse de Séféris, plusieurs indices sur le manuscrit et dans son journal laissent penser qu’il l’a retravaillé plus tard dans sa vie.
Au milieu des années 1920, à Athènes, un groupe de jeunes intellectuel·les se retrouve, les nuits de pleine lune, sur les ruines de l’Acropole pour discuter littérature, philosophie, théologie. Séféris mêle à ces rencontres le journal d’un des participants, Stratis, aspirant écrivain, qui semble être son double.
– Mais qui donc s’intéresse à la poésie aujourd’hui ? La poésie a été supplantée par le roman. Cela ne vous a pas tenté, le roman ? (…) / – Cela m’a tenté, mais je crois que je ne sais pas raconter. Plus gave, je suis incapable de décrire. J’ai toujours l’impression qu’il suffit de nommer une chose pour qu’elle existe. Ce qu’elle est apparaîtra de soi-même, à travers ses actes (…) / – Mais si la chose en question n’est pas un homme ? Si c’est un paysage, par exemple, ou quelque chose d’inerte – qui n’agit pas, devrais-je dire plutôt –, comment saurons-nous alors de quoi il est question, sans description ? / – Il me semble que tout ce qui existe agit, dit Stratis. / La formule résonna étrangement à ses oreilles, comme si elle n’était pas de lui. Il se mit à rire. (p. 21)
Je n’aime pas l’expression mais c’est un roman « moderne » à beaucoup d’égards : sa construction, donc, les thèmes abordés (les scènes érotiques, notamment saphiques, sont à la fois très pudiques car ellipsées, et très osées pour la fin des années 1920), et son écriture. La langue est assez simple, et la complexité du texte tient dans ses très nombreuses références : Valéry, Homère, Macriyannis, Gide, Pascal, Marc-Aurèle, et surtout la Bible et Dante – l’auteur a inséré une recension des références à Dante à la fin du texte. J’avoue humblement ne pas avoir tout compris à ce que je lisais, mais il me semble que c’est une de ses qualités : il règne une ambiance de mystère, et même de mystique ; outre les discussions appuyées sur Dieu qui, en Grèce, renvoie au moins au Dieu chrétien, musulman, et au panthéon antique, la lune joue un rôle prépondérant dans le roman et les cycles lunaires sont indiqués dans la marge (saluons au passage les toujours excellentes éditions Le bruit du temps).
J’ai lu Six Nuits sur l’Acropole comme un roman grec, sur la Grèce, et singulièrement la Grèce des années 1920. Rappelons le contexte : après la Première Guerre mondiale, l’Empire ottoman vaincu s’effondre. La Grèce, qui a gagné son indépendance un siècle auparavant, récupère des territoires d’Anatolie occidentale où des colonies grecques sont installées depuis l’Antiquité ; or, la jeune Turquie unifie l’Anatolie et chasse les Grecs d’Asie Mineure (autour de Smyrne) : c’est la Grande Catastrophe. La Grèce des années 1920 est traumatisée par cette défaite et cet exil, revivant d’une certaine manière l’humiliation de la domination ottomane après des siècles de gloire antique et romaine-byzantine. Il y a tout cela, me semble-t-il, dans ce roman, sous la forme de symboles : l’Acropole en ruines est une métaphore du passé glorieux (et quand on a eu la chance de la voir de ses yeux, on ne peut voir que ça), la lune représente le poids de l’histoire, mais la culture grecque persiste (Homère pour l’Antiquité, Macriyannis, héros de l’indépendance, pour la période moderne), et bien sûr la dialectique terre/mer avec l’île comme figure du refuge… N’ayant lu ni Dante ni la Bible, je manque certainement de clefs pour comprendre toutes les subtilités intertextuelles du roman. Il n’empêche que c’est une lecture envoûtante et un voyage dans le temps et l’espace ; je ne demande que ça.
Il avait l’impression que l’Acropole était demeurée intacte jusqu’à ce soir-là, et que deux millénaires de temps compressé venaient brusquement de se libérer en la réduisant en miettes. (p. 140)