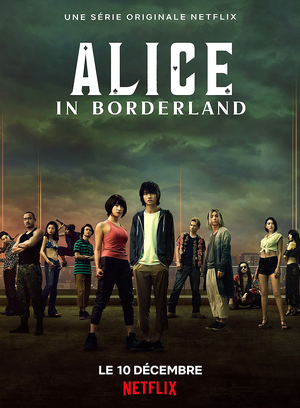Saison 1 :
La production par Netflix de la nouvelle série japonaise "Alice in Borderland" marque une date importante pour tous les fans de shōnen (et de seinen) à travers la planète : la fin d’une malédiction, qui a vu jusque-là toutes les adaptations cinématographiques de mangas déboucher sur des résultats pitoyables (on parle évidemment de « real life », les adaptations en anime réussies ne manquant pas !), trahissant presque toujours l’œuvre originale tout en résultant en des films ridicules, la plupart du temps irregardables.
A la différence par exemple de merveilles comme "20th Century Boys" ou "Death Note", totalement dévastées une fois portées à l’écran, le manga d’Haro Asō a donc droit, lui, à un traitement que l’on a envie de qualifier de remarquable, puisque bénéficiant d’un excellent script – pas forcément fidèle à la lettre à l’œuvre originale, mais nous semblant en respecter l’esprit -, un choix d’interprètes de qualité et surtout une mise en scène plutôt élégante de Shinsuke Sato, sans même parler d’un visuel remarquable, multipliant les plans à l’esthétique scotchante : bref, du travail haut de gamme, sans doute parce que, dans la stratégie Netflix, destiné à conquérir un public international allant bien au-delà de la population geek fan de mangas, auquel on n’était pas habitué, et qui justifie sans doute partiellement, soyons honnête, le coup de cœur que l’on a ressenti devant la série. Car ce n’est pas non plus si simple de conjuguer une forme qui reste le plus possible fidèle au « matériau shōnen » de base, et qui ne rebute pas le téléspectateur lambda.
Bien entendu, la qualité du scénario original est pour beaucoup dans la réussite de la série : nous suivons le lycéen / geek Ryohei Arisu (soit la prononciation japonaise de « Alice » !) et ses amis qui se retrouvent dans un monde parallèle (?) où Tokyo a été quasi intégralement vidé de ses habitants, et où, pour survivre, ils doivent participer à des épreuves soit intellectuels, soit physiques, soit encore psychologiques (les plus terribles) qui leur permettent d’obtenir des visas à la durée limitée leur évitant d’être liquidés par un faisceau laser tombant du ciel. D’où, au programme, un mélange détonnant de résolution d’énigmes proposées à la sagacité du téléspectateur en même temps qu’aux « joueurs » de la fiction, et de suspense particulièrement intense. Et donc une satisfaction garantie pour tous ceux qui aiment cogiter dur pendant une série, toit en jouissant d’un spectacle bien tendu.
Les détracteurs de ce genre de choses parleront de puérilité, de manque de vraisemblance, de sadisme, mais ce sont des arguments pas très recevables : oui, on est ici en pleine « culture manga », avec des codes bien particuliers, mais au final pas foncièrement moins adultes que ceux qui régissent 90% du cinéma hollywoodien auquel tout le monde est désormais trop habitué pour les challenger. Oui, les amoureux du réalisme le plus extrême doivent probablement passer leur chemin, mais le monde de Borderland a une cohérence interne qui devrait satisfaire la majorité des spectateurs (même si, reconnaissons-le, la dernière partie, au sein du complexe « The Beach » montre quelques facilités scénaristiques dont on se serait passés…). Quant à l’aspect sanglant de la série, il est indiscutable, mais on est ici très loin du torture porn façon "Saw" et consorts, et au contraire on est dans un mélange bien dosée de challenge intellectuel (comprendre ce qui se passe, ce qui est en jeu, et comment résoudre l’énigme) et d’empathie vis-à-vis de personnages
Et c’est là que le choix judicieux des acteurs, correspondant à des personnages au look très manga mais néanmoins pour la plupart charismatiques, fait la différence : on aimera ainsi Tao Tsuchiya en alpiniste dure et obstinée, Kento Yamazaki dans le rôle principal du geek génial, mais surtout les « méchants » tous très réussis, de Nijirô Murakami, fascinant en Cheshire (parfaite illustration du fameux sourire flottant !) à Dôri Sakurada, magnifique psychopathe, en passant par Nobuaki Kaneko, le magnétique et fascinant « Chapelier » en maillot de bain !
On remarquera que "Alice in Borderland" s’attache à fournir à la majorité des personnages importants un background psychologique, destiné à accentuer notre empathie, avec plus ou moins de pertinence. Reste que ces flashbacks ont le mérite d’adresser nombre de questions-clé de l’adolescence, depuis le trouble du genre au harcèlement à l’école, en passant par les (inévitables) problèmes de relation avec les parents, et les addictions diverses : au-delà des stéréotypes sans doute inévitables, cela permet de dresser en filigrane d’une œuvre fondamentalement « SF » un portrait réaliste de la difficulté de grandir dans le monde moderne.
Si le dernier épisode de la saison n’est pas le plus convaincant, il introduit néanmoins la deuxième partie du « jeu », qu’on a hâte de découvrir dans la seconde saison.
[Critique écrite en 2020]
Retrouvez cette critique et bien d'autres sur Benzine Mag : https://www.benzinemag.net/2020/12/16/netflix-alice-in-borderland-enfin-une-belle-adaptation-de-manga-a-lecran/
Saison 2 :
Pour notre Noël 2020, Netflix avait déposé devant le sapin un beau cadeau : Alice in Borderland, l’adaptation réussie en série TV du manga d’Haro Asō. Dépassant aisément les clichés auxquels il était a priori facile de la réduire (Battle Royale, le Roi des Mouches, Saw, ce genre de comparaisons paresseuses qui sont venues à l’esprit de critiques visiblement peu familiers ou mal à l’aise avec l’univers du shōnen), Alice in Borderland trouvait le juste équilibre entre SF conceptuelle, défis intellectuels et psychologie ado. Et puis la vision d’un Tokyo déserté de ces habitants – et en particulier le carrefour de Shibuya – s’était définitivement inscrite dans notre mémoire comme une nouvelle image parfaitement symbolique du grand cinéma de Science-Fiction…
Il nous aura fallu attendre deux ans, qui ont d’ailleurs permis à Squid Game de rafler la mise globalement sur un sujet similaire, pour découvrir la suite – et la fin (?) – des aventures d’Arisu (Alice) et ses amis et ennemis dans un pays qui n’a rien de merveilleux, puisqu’il s’agit pour ceux qui y ont été exilés de manière incompréhensible de survivre en participant, et en triomphant, dans des jeux particulièrement sadiques. Avec, pour horizon, l’espoir qu’une fois toutes les cartes collectées – chaque jeu étant représenté par une des 52 cartes d’un jeu -, il leur serait possible de retourner dans « leur monde ». La première saison déroulant les cartes de l’As au 10, voici cette fois le tour des « figures », avec un twist de taille : cette fois, les gamers affrontent les « citoyens » de ce monde parallèle, c’est-à-dire d’ancien gamers comme eux, passés à l’ennemi (de l’autre côté du miroir ?).
Sur un mode identique à la première saison, et donc sans réelle surprise, mais avec des niveaux de violence et d’intensité accrus (comme tout ce qui concerne la confrontation armée avec le Roi de Pique), la seconde saison de Alice in Borderland nous raconte comment Arisu et sa petite bande vont affronter divers Rois, Reines et Valets pour tenter de trouver une issue à ce labyrinthe de plus en plus en foisonnant qu’est l’univers dans lequel ils ont été mystérieusement transportés : entre la végétation luxuriante qui semble envahir d’un coup Tokyo et les parcs de la ville qui se transforment en immenses forêts entourés de montagnes gigantesques, il est difficile pour le spectateur de ne pas perdre ses repères… et de ne pas juger que la série perd du coup de sa crédibilité (un drôle de mot si on l’applique à une histoire de SF, mais bon…).
Heureusement, les idées des différents jeux (certains tellement complexes qu’on doit quand même – un peu comme chez Nolan ! – attendre des personnages qu’ils nous expliquent leurs déductions et la logique de leur approche face aux défis posés) sont suffisamment passionnantes, et la réalisation de Shinsuke Sato suffisamment efficace, voire brillante, pour qu’on passe sur ce qui ressemble, au moins un temps, à des invraisemblances.
Le second aspect frappant de la série, ce sont évidemment les longs – trop longs parfois ? – dialogues introspectifs entre les personnages qui, plus encore que dans la première saison, vont se poser des questions existentielles, certaines classiques de l’adolescence (« Qui pourrait m’aimer ? », par exemple), d’autres plus intéressantes, comme celles qui adressent les rapports entre morale, éthique, pouvoir et politique : l’un des meilleurs épisodes de la saison se penche sur le passé de Chishiya (le toujours fascinant Chat du Cheshire) et raconte son face-à-face avec un ex-avocat d’affaire devenu citoyen. Il faut bien reconnaître que la série ne vise pas toujours très juste dans ces passages qui hésitent entre un public ado et un autre plus mature. Il reste que tout cela trouvera largement sa justification dans le dernier épisode, particulièrement passionnant.
Car il importait de ne pas rater ce dernier épisode (même si le manga fournissait une base solide qui évitait les conclusions lâches, voire pitoyables, « à la Lindelof ») qui devait justifier et expliquer les 15 précédents : mission accomplie, et avec brio même, puisque l’on s’amusera ici à évoquer une à une toutes les hypothèses qui ont pu germer dans la tête des téléspectateurs, pour déboucher sur une solution « réaliste » convaincante. Avant de basculer, dans un joli aller-retour conceptuel, vers une conclusion où le fantastique, voire la « magie cinématographique », fait son éternel retour. C’est profondément satisfaisant, et le téléspectateur ressentira l’impression paradoxale d’une sorte de récompense – comme s’il avait lui-même triomphé des épreuves – mêlée à une renaissance à l’indéniable caractère « feelgood ».
Jusqu’à un dernier plan, malin, saisissant, petit clin d’œil plutôt que twist : enfin, on l’espère, et on ne voudrait pas voir une troisième saison apparaître après une fin aussi satisfaisante.
[Critique écrite en 2022]
Retrouvez cette critique et bien d'autres sur Benzine Mag : https://www.benzinemag.net/2022/12/28/netflix-alice-in-borderland-saison-2-guerre-aux-figures/
Saison 3 :
La saison 3 d’Alice in Borderland sera donc la dernière de la série japonaise à succès, tout au moins avant un possible reboot / sequel aux USA, suggéré par la conclusion du dernier épisode (comme dans la conclusion de Squid Game : décidément, Netflix a du mal à abandonner ses poules aux œufs d’or !). Le défi que les scénaristes (Yasuko Kuramitsu et Shinsuke Satô) ont dû relever est de s’émanciper du manga de Haro Aso, qui n’allait pas au-delà des faits racontés dans les deux premières saisons. Et cela n’a pas été facile, même si leur choix a été le plus intelligent – et également le plus risqué : porter la série sur un terrain différent, encore plus science-fictionnel, conceptuel et… métaphysique.
Et, surtout, ils ont pris en compte le fait que cinq ans se sont écoulés depuis la stupéfiante incursion d’Arisu (Kento Yamazaki) et de ses copains dans le « monde-frontière » ayant replacé Tokyo dans leur existence. Les acteurs ont vieilli, ils ne sont plus adolescents, mais jeunes adultes, leurs préoccupations ont évolué, et cette troisième saison en fait l’un de ses thèmes centraux. Arisu et Usagi (Tao Tsuchiya, très impressionnante à nouveau) sont en couple, et doivent affronter des défis de couple : la tentation de l’adultère, la venue – ou non – d’un enfant, tout en acceptant que, dans leur tête, ils ne se sont pas totalement échappés ni de Borderland, ni de leurs traumas originels (le suicide du père pour Usagi). Et c’est la rencontre d’Usagi avec un mystérieux professeur handicapé (Kento Kaku, parfois assez caricatural dans son jeu), fasciné par les expériences de « near-death » et leurs conséquences, qui va précipiter notre petit couple mignon de nouveau dans l’enfer des jeux, placé cette fois sous le signe du Joker.
À propos d’« enfer des jeux », il n’est pas inutile de bien préciser, à l’intention de ceux qui – les malheureux – verraient Alice in Borderland comme une version nippone de Squid Game, combien les deux séries sont différentes, en dépit du fait que leur cœur soit constitué de ces fameux jeux mortels qui sont évidemment des « hooks » irrésistibles pour les téléspectateurs à travers le monde. En termes de « thème profond », Squid Game est une série socio-politique, qui démontre comment le néo-libéralisme utilise l’argent, le spectacle, et la mise en compétition entre elles de ses victimes pour « fabriquer du consentement à la cruauté ». C’est aussi une satire pop des travers les plus évidents de la nature humaine. A l’inverse, Alice in Borderland traite de la quête de soi-même, de sa propre vérité au sein d’un labyrinthe infernal, un « monde-jeu » terriblement indifférent au destin de ceux qui y souffrent. Squid Game est en conséquence une œuvre hyper-accessible (ses codes sont universels, la représentation offerte des victimes du capitalisme parle à tout le monde) et est devenu un véritable phénomène global, propulsé par l’allégorie sociale et l’esthétique pop ; à l’inverse, Alice in Borderland, plus « cinéma de genre », très SF finalement, cible spécifiquement un public plus jeune, familier avec les high concepts de nombreux mangas, la résolution d’énigmes complexes et les « puzzles mentaux » : la série bénéficie d’un fandom solide, mais peine, logiquement, à plaire à un plus grand public.
Et l’introduction – une grande partie du premier épisode – de cette dernière saison va plus loin encore dans la pure SF, en essayant (parfois pas très logiquement) de rationnaliser l’existence de Borderland… au risque d’irriter ceux qui n’y verront que des élucubrations pas très solides autour de la vie, la mort, et ce qu’il y a (peut-être) « entre les deux ». Ceux qui auront réussi à rester jusqu’au retour d’Arisu dans Borderland seront « récompensés » par une nouvelle série de jeux extrêmement spectaculaires, qui réinjectent l’excitation des deux premières saisons. Le budget semble avoir augmenté, avec pour effet une mise en scène plus sophistiquée et des effets spéciaux plus impressionnants, mais la logique des jeux n’est pas toujours aussi implacable qu’avant : on a parfois l’impression que le hasard a au moins autant d’impact sur le résultat du jeu que l'intelligence d’Arisu. La conséquence la plus négative de ce « hors-piste » des scénaristes, qui ne bénéficient plus de l’intelligence « supérieure » du manga, est que le « curseur » a un peu bougé : ces nouveaux épisodes privilégient la tension immédiate par rapport à la satisfaction intellectuelle différée.
L’une des réussites de la saison est de jouer sur la séparation et les retrouvailles d’Arisu et d’Usagi, nourrissant l’histoire de leurs deux trajectoires parallèles (jolie image des trains roulant côte à côte dans les tunnels de Borderland). Mais l’une de ses plus grandes faiblesses est sa dernière partie, plus confuse qu’éclairante – que nous ne spoilerons pas ici –, même si elle nous offre une belle apparition du magistral Ken Watanabe. Chacun décidera s’il l’aime ou pas.
Même si l’on objecte à la suggestion, en conclusion, d’un possible Alice in Borderland US (rien n’est confirmé à l’heure qu’il est) sur fond de cataclysme planétaire (on nous présente même « LA » future Alice !), qui risque évidemment de voir la série s’éloigner – pour le pire – du manga original, on doit admettre que cette dernière saison, que l’on pourra juger un poil moins convaincante que les deux précédentes, aura constitué l’un de nos grands plaisirs « sériels » de 2025.
[Critique écrite en 2025]
https://www.benzinemag.net/2025/09/30/netflix-alice-in-borderland-saison-3-le-hors-piste/