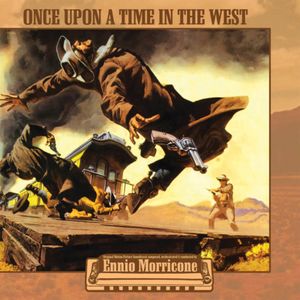On ne naît pas monument, on le devient. En 1968, Ennio Morricone atteint avec Il était une fois dans l’Ouest le sommet de son art, celui où la musique ne se contente plus d’accompagner l’image, mais la précède, la transcende et parfois la remplace. Si la trilogie du dollar avait déjà révolutionné le western en dynamitant ses codes sonores, Il était une fois dans l’Ouest en est l’apothéose lyrique et métaphysique : un poème sur la mort, la vengeance et la fin d’un monde, porté par une partition qui semble écrite pour l’éternité.
Ce qui frappe d’abord, c’est le dépouillement. Le film de Sergio Leone s’ouvre sur dix minutes de silence — ou plutôt de bruits : le vent, une mouche, une goutte d’eau, le grincement d’une enseigne. La musique n’entre que plus tard, comme un souffle attendu. Lorsque le thème principal surgit, il s’impose immédiatement comme une révélation : une mélodie lente, suspendue, portée par la voix spectrale d’Edda Dell’Orso, véritable instrument de chair et de souffle. Morricone comprend ici ce que la plupart des compositeurs de cinéma n’osent pas : la musique doit parfois naître du silence, comme une extension de l’espace.
Le génie de Morricone, c’est de bâtir sa partition sur des figures motiviques minimales qui, par leur orchestration et leur interprétation, deviennent des mythes sonores. Chaque personnage possède un motif distinct, mais aucun n’est traité comme un simple thème de reconnaissance : ils incarnent, par leur timbre, leur rythme, leur instrumentation, une force symbolique.
- Harmonica (Charles Bronson) : son motif, réduit à une cellule simple et obsédante, repose sur un intervalle répétitif — immédiat et presque primal — qui fonctionne comme un appel suspendu plutôt que comme une mélodie développée. C’est moins une ligne musicale qu’un cri contenu.
- Cheyenne (Jason Robards) hérite d’un motif plus léger, marqué par la guitare et le banjo, oscillant entre ironie et mélancolie, comme si Morricone refusait la caricature du bandit.
- Frank (Henry Fonda) est accompagné de cordes tendues et de cuivres sombres, un langage harmonique qui sature presque l’espace, rappelant l’héritage du post-romantisme italien.
- Enfin, Jill (Claudia Cardinale) reçoit l’un des plus beaux thèmes jamais composés pour le cinéma : une longue ligne mélodique ascendante, soutenue par des cordes vibrantes, des cors, et surtout la voix d’Edda Dell’Orso, qui devient la véritable âme du film.
Cette structure thématique fonctionne comme une polyphonie dramatique. Morricone oppose les registres : le grave et la stridence, la corde et le souffle, la chair et le métal. Le résultat, c’est une écriture orchestrale qui conjugue rigueur classique et invention timbrale radicale. À la différence de John Williams, dont la richesse harmonique s’appuie sur la tradition du leitmotiv wagnérien, Morricone procède par déformation, suspension, attente. Ses accords ne résolvent pas toujours, ses motifs s’étirent, se répètent, se consument.
Dans Il était une fois dans l’Ouest, chaque note a un poids métaphysique. L’harmonica n’est pas un instrument, c’est un fantôme. Le violoncelle est souvent traité dans une tessiture lamentante, proche du gémissement, plutôt que du chant lyrique traditionnel. Les percussions ne rythment pas, elles martèlent la fatalité. L’usage de la voix féminine est d’une audace inouïe : non pas un accompagnement, mais une incarnation, une transfiguration de la féminité dans un monde d’hommes et de poussière. Le thème de Jill, d’ailleurs, repose sur une mélodie en mouvement contraire, où la montée des cordes est contredite par la descente vocale — symbole même du destin contrarié.
Sur le plan harmonique, Morricone use volontiers d’allusions modales (notes rivées autour d’un centre mineur, ponctuées de pédales et de secondes dissonantes) plutôt que de progressions tonales complexes. Le tout est enveloppé dans une orchestration diaphane, où les instruments sont traités comme des solistes dans un vaste chœur de timbres. Les guitares sèches dialoguent avec les cors, les cordes avec les sifflements du vent, les voix humaines avec les sons mécaniques. Tout ici relève d’un art du contraste et du silence, un art que peu de compositeurs ont su manier sans emphase.
Le succès du film et de sa musique repose précisément sur cette alchimie : la fusion entre le mythe américain et la mélancolie européenne. Morricone, élève de Goffredo Petrassi et nourri de musique contemporaine, ne compose pas un western américain ; il compose une tragédie méditerranéenne déguisée en fresque de l’Ouest. Là où Hollywood exaltait la conquête, lui pleure la perte. La conquête du rail, de la ville, de la civilisation se traduit par la disparition du mythe : la musique ne célèbre pas, elle pleure.
Si l’on compare cette bande originale à d’autres monuments du genre — Williams pour Star Wars, Barry pour Out of Africa, Zimmer pour Gladiator —, la différence saute aux oreilles : là où ces musiques visent l’héroïsme, Morricone recherche la transcendance. Il refuse la structure triomphante, préfère la lenteur et la circularité. C’est peut-être ce qui explique la force émotionnelle du film : la musique ne soutient pas l’action, elle en révèle le sens profond.
Techniquement, la partition reste un modèle de composition pour le cinéma :
- usage de leitmotivs distincts mais unifiés par une même couleur harmonique ;
- équilibre entre écriture modale et orchestration tonale ;
- gestion du silence comme élément structurel ;
- et surtout, une narration musicale autonome, capable de se suffire à elle-même.
Il n’est pas exagéré de dire qu’avec Il était une fois dans l’Ouest, Morricone a redéfini la relation entre musique et image. Là où tant de compositeurs contemporains cèdent à la tentation de l’illustration ou du bruitisme, lui invente une véritable poétique du son : une musique du souvenir, de l’attente, du vent, de la poussière et du destin.
Plus d’un demi-siècle après sa création, l’influence de cette partition se fait sentir dans des esthétiques diverses — de compositeurs de cinéma contemporains à certains artistes de la scène alternative — qui ont repris son goût pour le motif, le silence et l’économie mélodique. Elle a ouvert la voie à une approche émotionnelle et symbolique de la musique de film : moins décorative, plus essentielle.
En définitive, Il était une fois dans l’Ouest n’est pas seulement une bande originale magistrale ; c’est une méditation sur la fin du mythe, un requiem pour un monde disparu. Morricone ne compose pas pour un western : il compose pour le temps lui-même, pour cette lente érosion des légendes que la musique seule peut sauver de l’oubli.