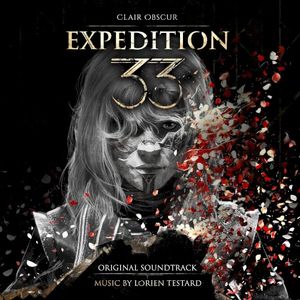Dans l’univers encore jeune, mais déjà surchargé, de la musique vidéoludique, rares sont les œuvres capables de transcender leur fonction pour s’imposer comme des entités artistiques à part entière. La bande originale de Clair Obscur : Expedition 33 n’est pas seulement un écrin sonore à un jeu au parti-pris visuel fort ; elle est, à elle seule, un manifeste esthétique, une œuvre totale où l'émotion se conjugue à la technique avec une intelligence rare. D’une ambition peu commune, tant par sa durée – plus de huit heures de musique originale – que par la richesse de son écriture, cette composition érige une architecture musicale aux allures de fresque symphonique.
L’écriture thématique s’inscrit dans une tradition héritée du romantisme narratif européen, mais revisitée par une sensibilité résolument contemporaine. Le compositeur s’y révèle maître du leitmotiv : non pas comme simple repère mélodique, mais comme vecteur dramaturgique. Chaque thème – qu’il soit lié à un personnage, un lieu, une idée – évolue au fil de l’aventure, tantôt repris en canon, tantôt déconstruit jusqu’à l’abstraction, avant de resurgir transfiguré, dans des tonalités inattendues, révélant le développement psychologique des protagonistes ou l’évolution du monde diégétique. Ce travail de transformation thématique rappelle les procédés de variation utilisés par Mahler ou Britten : le motif n’est jamais figé, il respire, s’érode, renaît.
La richesse orchestrale est à la hauteur de cette écriture : foisonnante, mais jamais bavarde. Le traitement des cordes témoigne d’un raffinement tout particulier. Souvent placées au premier plan, elles ne se contentent pas de poser des nappes émotionnelles ; elles sont le véritable poumon expressif de l’OST. Des contrechants en tierces mineures, des glissandi d’alto, des tremoli en sul ponticello confèrent à l’ensemble une tension organique. Les bois, eux, n’interviennent que ponctuellement, mais avec un relief dramatique certain : hautbois isolé sur fond de silence, clarinette basse dialoguant avec une harpe cristalline, flûte traversière filant en harmoniques… Le moindre timbre est choisi, pesé, ciselé.
Quant aux percussions, elles se distinguent par leur sobriété narrative. Plutôt que de souligner l’action de manière ostentatoire, elles l’accompagnent de l’intérieur. Une timbale voilée peut suffire à annoncer un basculement ; un simple carillon suspendu devient un marqueur de mystère. L’usage des percussions est ici plus textural que rythmique, plus psychologique que mécanique.
Le piano, omniprésent, joue un rôle axial dans la dramaturgie sonore. À la fois narrateur, confident et témoin, il tisse un lien direct entre le joueur et l’univers émotionnel du jeu. Le compositeur le traite tour à tour comme instrument soliste, élément rythmique, ou support harmonique. On note une grande variété de traitements : motifs arpégés à la manière de Debussy, accords plaqués dans les graves comme chez Rachmaninov, et parfois un dépouillement presque méditatif, proche de Satie. Ce piano, souvent seul, joue alors le rôle de miroir introspectif : ce que le jeu ne dit pas, il le murmure.
Mais l’aspect sans doute le plus singulier de cette bande originale réside dans l’usage de la voix. Voix féminine, nue, aérienne, sans texte intelligible : une voix qui ne parle pas, mais qui incarne. Employée avec parcimonie, elle intervient comme un souffle sacré, comme si l’univers du jeu lui-même tentait de se donner une âme. Les inflexions, les respirations, les silences entre deux syllabes susurrées sont composés avec une précision quasi chorégraphique. À plusieurs reprises, cette voix s’insère dans le tissu orchestral, non comme une ligne mélodique autonome, mais comme un timbre à part entière, fondu dans la masse orchestrale, participant à une polyphonie de timbres où chaque son, chaque souffle, a sa place.
La structure même de la bande originale épouse la progression narrative du jeu. Les premières plages, éthérées, lumineuses, parfois presque tonales, cèdent peu à peu la place à des harmonies plus dissonantes, à des textures plus denses, à des ruptures formelles plus fréquentes. L’écoute intégrale de cette œuvre est une traversée émotionnelle, une sorte de descente dans les strates d’un inconscient collectif où la beauté, la mélancolie et l’effroi coexistent. L’ensemble est conçu avec une logique quasi-cinématographique, mais sans céder à la tentation du spectaculaire. Ce qui frappe ici, c’est la pudeur de l’émotion : jamais surjouée, toujours retenue, toujours d’une justesse troublante.
Un parallèle s’impose naturellement avec la bande originale de Lies of P, qui, elle aussi, explore un imaginaire musical ancré dans une esthétique Belle-Époque teintée de décadence. Là où Lies of P joue sur une multiplicité de registres – allant du jazz expressionniste à des valses de salon décomposées, intégrées dans des gramophones comme objets narratifs –, Clair Obscur privilégie une écriture unifiée, continue, presque organique. Lies of P propose des moments musicaux brillants mais souvent isolés, que le joueur déclenche ou découvre au gré de sa progression ; la musique y est un commentaire, un ornement. Dans Clair Obscur, la musique est matrice : elle précède parfois le geste, annonce l’image, provoque la sensation. Il ne s’agit pas de séduire l’oreille, mais de convoquer une émotion profonde, enfouie, parfois difficile à identifier.
Là où Lies of P excelle dans l’iconographie sonore, dans la création de pastiches raffinés, Clair Obscur vise une cohérence absolue. La musique ne se fragmente pas ; elle respire, se développe, se rétracte comme un organisme vivant. En ce sens, elle se rapproche davantage de la logique de l’opéra que de celle du cinéma ou du jeu vidéo traditionnel. Elle porte le récit comme une trame invisible, tissant des liens entre les séquences, les personnages, les lieux et le joueur lui-même.
En définitive, cette bande originale constitue un accomplissement rare. Elle témoigne d’une maîtrise exceptionnelle des langages musicaux, d’un sens aigu de la dramaturgie sonore, et d’une volonté claire de faire de la musique un sujet, et non un accessoire. Loin des conventions, elle s’inscrit dans une démarche artistique exigeante, où chaque note semble nécessaire, chaque silence habité, chaque thème pensé pour durer.
On serait tenté de dire que cette OST mérite d’être jouée en salle, hors contexte vidéoludique, tant elle possède les qualités formelles, esthétiques et émotionnelles des grandes œuvres symphoniques contemporaines. Elle n’accompagne pas seulement un jeu : elle en est l’ombre portée, la voix intérieure, le souffle poétique. C’est une musique qui pense, qui rêve, qui se souvient. Et à ce titre, elle marque une étape essentielle dans l’histoire de la composition pour le jeu vidéo : celle où la musique ne se contente plus de suivre le récit – elle l’écrit.