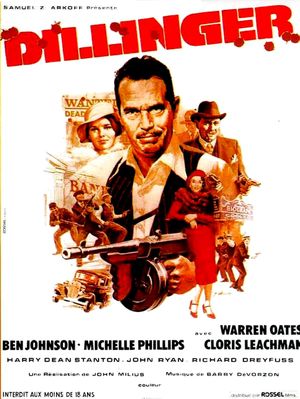Support: Bluray
Pour son premier passage derrière la caméra, il est intéressant de voir John Milius s’attaquer directement à la figure du héros en proposant un contrepoint à la mouvance du Nouvel Hollywood lancée par Bonnie and Clyde en 1967. Personnages cités ouvertement comme des barbares chaotiques par ceux de Dillinger, car représentatifs de l’errance culturelle des 60s-70s qui remettait en cause le modèle américain. Non, Dillinger et sa bande sont, eux, des héros à l’ancienne.
Qu’importe qu’ils soient des gangsters, ils sont des figures symbolisant la possible extraction de la misère précipitée par la crise de 29. Des hors-la-loi portés par un souffle de liberté qui vont forcer leur légende par leur ego, au même titre que leur poursuivant, le G-Man Melvin Purvis. La loi et le braqueur sont indissociables l’un de l’autre, complémentaires, nécessaires pour faire des étincelles face aux yeux des spectateurs. Batman et le Joker en somme, mais ayant pour vocation la célébrité. C’est d’ailleurs en ce sens que va le carton final sur Purvis, l’homme s’étant donné la mort quelques années après avoir mis fin aux agissements de Dillinger, vidé de sens. Une approche à l’ancienne de ces figures, aux inspirations fordiennes dont ne se cache pas Milius, et qui s’explique partiellement par la vision particulière du cinéaste, à la croisée des influences idéologiques : entre un conservatisme certain et une passion des armes (“I love the smell of napalm in the morning” ou “Go ahead, make my day !”, c’est de lui), et des penchants plus beatniks qui font du surf et du Zen des religions.
Conscient de ses influences, Milius les utilise à des fins métatextuelles. Il n’est donc pas étonnant que la scène d’introduction, où Warren Oates pointe son pétard vers la caméra en regardant le spectateur droit dans les yeux, renvoie directement à The Great Train Robbery. Soit les prémices du cinéma, et de l’impression des légendes et héros sur la pellicule. Et que Dillinger tombe à la sortie d’une salle de cinéma. Sortir de la séance équivalant alors à tuer les mythes et symboles dans le blafard du réel. Logique également que les générique de début, en fausses photographies d’archives, se déroule sur la chanson “We’re in the money”, créée pour la comédie musicale Gold Diggers of 1933 et relatant une échappatoire fantasmée à la Grande Dépression.
Comme souvent, parler de cinéma en sous-texte permet d’étendre le message de la première lecture. Ici ce sont les changements de la société américaine qui a délaissé ses héros pour sombrer dans le doute. Sans ces jalons, ces phares idéalisés à l’horizon, il est aisé de se perdre. Une pensée un peu régressive, presque réac (il n’y a après tout que le plomb qui vaille), avec laquelle je ne suis pas forcément en adéquation, mais néanmoins bien menée, malgré des moyens que l’on devinent limités sur les scènes de fusillades quelque peu brouillonnes et peu emballantes.