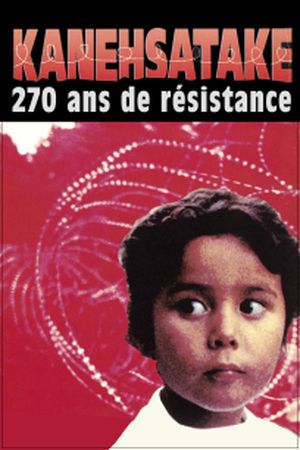Tout commence avec un golfe. Après de nombreuses années de luttes, Ouellette, le maire de la petite ville d’Oka, pas si loin de Montréal, délivre le permis lui permettant de s’agrandir. Problème, les trous qui manquent doivent se creuser dans la pinède adjacente où se trouve également un cimetière Mohawk. La nation et ses Warriors, un groupe de résistant Mohawk, se défendent. Un barrage est monté, une rue est bloquée, des banderoles sont tirées, des voitures sont arrêtées. Une femme autochtone est venue de loin pour soutenir les manifestants, elle est surprise : « c’est ça la route qu’on bloque depuis trois mois ?! Une simple route en terre ». Cela suffit pour la police qui vient en nombre, armé de fusil, de spray au poivre, de lacrymogène. Alors que la tension monte, la police se met à tirer dans le tas, tellement que leur chef se prend une balle. Impossible de savoir d’où elle vient, elle a peut-être rebondi sur un arbre. L’escalade peut commencer. La métaphore serait trop belle pour être vraie si elle n’était pas si triste. Bientôt ce sont les chars, les bottes, les treillis, les fusils d’assauts qui arrivent, grignotent le territoire, le fragmentent avec des barbelés, humilie, frappe, viol…
En réalité comme l’indique le titre, tout commence il y a 270 ans. Les colons débarquent et avec eux leurs systèmes juridiques. Le roi a 6000 kilomètres de là à changé, les Mohawks ne sont plus chez eux à moins de prêter allégeance. Un montage de dossier, de papier et de signature se prépare pendant que les Mohawks eux confectionnent une ceinture wampum inscrivant leurs appartenances aux territoires. Sans valeur pour le colon qui ne respecte que le papier et la plume, les Mohawks seront exterminés, dépossédés, enfermés sur leurs propres terres. Car tout commence et tout termine avec celle-ci. 270 ans plus tard, ce processus n’a jamais pris fin. La pinède appartient à la ville, c’est écrit. Malgré que les Mohawks aient planté ces arbres, les ont entretenus, que leurs morts y soient enterrés. C’est même illégal. Il est donc justifié, et mêmes recommandés, d’assurer la sécurité de tous en envoyant l’armée. Pensez-vous, les Mohawks violent la loi.
L’esthétique de Alanis Obomsawin est calme et respecte un certain classicisme documentaire. Une voix off qui raconte, contextualise, nomme et précise sur des prises de vues en direct entrecoupées de quelques entretiens in situ. La forme presque nous berce, nous sommes en terrain connu, nous connaissons la partition. Mais en conservant à tout prix ce rythme si particulier, au départ presque ennuyant, fait d’autant mieux voir la potentialité fasciste mobilisable à tout moment par la démocratie occidentale et comment celle-ci est inextricablement tressée dans les axiomes coloniaux. La propriété privée, l’état, la colonisation, le fascisme forment une ligne sur laquelle les intérêts privés fixent le curseur. Petit à petit, digue après digue, plan après plan, inlassablement celui-ci se déplace. La violence s’installe, trace de botte après trace de botte, un centimètre de barbelés après l’autre et d’un coup nous y sommes. La démocratie a disparu, comme un presque pas fait exprès. Aucune différence avant, ou presque, mais ne vous inquiétez pas c’est pour la sécurité. Les quelques lucides quant à ce qu’il va bientôt se jouer qui cherchent à fuir sont fouillés, humiliés et caillassés par ceux qui ont pu rester un peu plus bas sur le spectre de la démocratie, les blancs. Les autres continuent de résister avec des rituels, des plumes, du bois, des bâches en plastique.
Et puis alors que la bataille se termine, que les guerriers se rendent sans avoir obtenu de garantie, sans avoir exercé de violence, la brutalité de l’état mis en échec pendant trop longtemps se déchaine. Femmes, hommes, enfants, résistants, journalistes…Tout y passe. Le terrain ainsi débarrassé, balayé, la démocratie peut reprendre, circulez, la sécurité est revenue, les occupants sont partis.