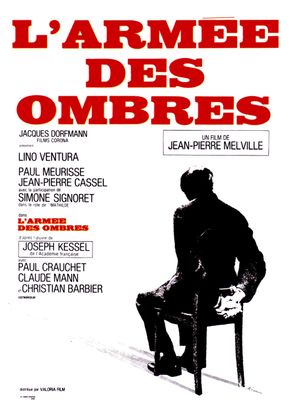Jean-Pierre Melville nous plonge dans la France des "Années Noires" (selon la périphrase d'Henry Rousso) à travers un récit aussi sombre que juste. Loin de participer au mythe "résistancialiste" entretenu par le gaullisme au sortir de la guerre, l'oeuvre de Melville donne l'impression d'une caméra invisible plantée au beau milieu de scènes qui ont pu et qui ont dû exister; les personnages sont d'ailleurs très clairement inspirés de figures importantes de la Résistance (Signoret "Mathilde" dans le film fait référence à Lucie Aubrac...). La brutalité, la froideur et l'angoisse d'un milieu fragile et dangereux permettent au spectateur d'envisager la France résistante dans ce qu'elle a eu de plus sublime, mais aussi dans ce qu'elle a eu de plus terrible. La fresque vue dans sa globalité ne laissera pas le spectateur indifférent; celui-ci est contraint de faire face aux plus belles histoires d'amitié rompues définitivement par une arrestation ou un assassinat, à l'image sombre d'une France collaborationniste traitant avec le mal absolu, à l'immensité du courage d'hommes et de femmes amenés à laisser de côté leurs sentiments. Lino Ventura signe sans doute l'une des plus grandes performances du cinéma français; en incarnat Philippe Gerbier, il prend le risque de jouer le héros au grand coeur, mais s'emploie finalement à n'être qu'un ombre parmi tant d'autres, une ombre plus magistrale, certes, mais une ombre quand même. Guidée par d'énormes convictions, "Mathilde" (Simone Signoret) restitue l'importance des femmes résistantes et leur rôle décisif; mais elle n'est pas uniquement la simple figure féminine, elle est bien plus, guidée par un génie stratégique et des plans ingénieux. Le casting dans son intégralité ne laisse personne indifférent; Cassel père incarne le courage et le sens du sacrifice poussés à leur paroxysme. L'Armée des ombres n'est pas un film à prendre à la légère ni même une métaphore géante; c'est le reflet de réalités dans leur crudité la plus primitive.