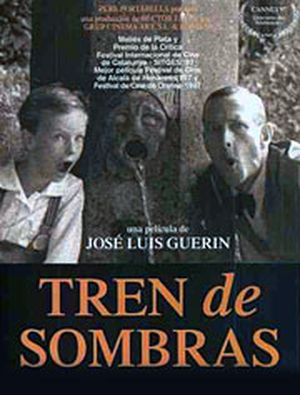Le Spectre du Thuit par Loryniel
Le Thuit est une petite commune de l'Eure, en Haute-Normandie, à côté de laquelle court la Seine et se repose un minuscule lac, à peine dérangé par les coups de rame de barque de quelques villageois endimanchés. Un avocat, Gérard Fleury, cinéaste amateur et propriétaire d'un modeste domaine ainsi que d'une caméra 8 mm, s'y balade en famille pour y tourner un film paysagiste. Hélas, suite à un enlèvement, un assassinat, par accident ou on ne sait quelle intervention divine, ce père de famille y disparaît quelques jours plus tard, dans des conditions demeurées inexpliquées.
Les images renoiriennes que monte José Luis Guerín dans la première partie de son film ont été enregistrées en 1930, l'année (peut-être le mois) de l'évaporation du protagoniste. Primesautières et estivales (les enfants jouent dans l'eau et rient, les adultes s'amusent à bicyclette et au golf, la famille se prend sans cesse en photo et danse), elles n'offrent pour seul contraste à ces images d'Epinal que le regard mélancolique de la fille aînée. Chacun de ses regards-caméra traverse l'écran comme un éclair, un appel à une réalité plus sombre mais quasi-subliminale tant sa présence et ses mouvements se fondent dans la musique joviale de cette partie de campagne. Pas le temps de considérer si ce bonheur est artificiel ou non.
Puis un train traverse l'horizon. Gérard Fleury s'élance vers lui et la pellicule se déteriore soudain. Avec elle, la musique ronronnante laisse place au chevrotement agonisant de la pellicule. Les lieux précédemment visités et les visages devenus familiers réapparaissent tâchés par la jaunisse du film brûlé. C'est l'annonce de la fin, non seulement de celle que Miguel Gomes appelait Paradis perdu dans Tabou, sans doute de la paisibilité de cette famille soudée du Thuit, et, se dit-on, également du cinéma de l'avocat-cinéaste normand.
Fin d'une vie, fin d'un monde, fin des images.
67 ans plus tard, Guerín, ayant fait la découverte de ces images, vient filmer ces mêmes lieux. Le domaine, affecté par la langueur d'un automne bien entamé et davantage déserté qu'un palais d'un film de Duras, n'est guère plus visité que par les moutons des environs à la recherche d'un pâturage. Alors, que reste-t-il de la vie de la famille Fleury dans cette demeure dévitalisée ? On se doutait trop bien de ce que le cinéaste espagnol était venu chercher : des fantômes planqués. On les attend dans chaque recoin de l'image : dans les photos dépassant d'un livre poussiéreux, dans la broderie d'un animal sur une tapisserie au bout d'un travelling, dans le reflet d'un miroir qui ne renvoit pourtant que son propre reflet, dans la lueur de la pleine lune qui filtre un rayon entre deux antiques pins.
A ce stade, Guerín n'a rien trouvé sinon réaliser une recette éprouvée par Duras. Pour se sortir de cette impasse, il lance alors une première piste, celle du polar. Les phares de trois voitures déchirent l'obscurité de la nuit pour rejoindre la demeure. La musique devient plus aigue, l'ombre des animaux empaillées se fait menaçante, la pluie bat à tambour la baie vitrée. Puis Guerín, visiblement pas suffisamment convaincu par cette idée "au présent", revient sur les images de Fleury. Forcément, il se passait quelque chose sur le visage de la fille aînée, quelque chose que nous n'avions pas pu voir sans être passé soi-même par là-bas ET par ici, sans avoir navigué entre ces deux espaces-temps.
Du mélancolique durassien un peu affecté, l'espagnol se transforme alors en laborantin de palmesque compulsif et génial et ouvre des images pourtant déjà vues à des possibilités infinies. A coups d'accélérations, de rembobinages, d'arrêts sur image, de double screens, Guerín réinvente, littéralement, à la fois la valeur affective et narrative de ces images, mais également notre regard sur elles-mêmes. Que signifie ce signe de la main adressée par la petite à vélo ? Quelle relation adultèrine se cachait en réalité entre la bonne et le maître de maison ? Comment se fait-il que ces deux regards trouvent-ils le même point de chute ? Qu'est-ce qui justifie la mélancolie de ce regard ?
A force de fabriquer tant de pistes, ce fabuleux laboratoire à mystères finit par accoucher d'une image concrète : le cinéaste-avocat réapparaît en 1997. Antonioni craignait dans Blow Up que le cinéma contemporain, racoleur et artificiel jusqu'à la vacuité, se vide de toute sensualité, de tout sens et finalement de tout mystère. Guerín, magicien digne de lui, propose une alternative inversée, où le sens des images déborde, où l'intelligence de celui qui les reçoit est sans cesse à l'affut de sens. Il fallait ce tour de magie pour que le fantôme de Fleury réapparaisse enfin, sorte avec sa caméra et se dirige une dernière fois vers le lac qui l'a dérobé au monde, pour disparaître, cette fois, avec nous.
Cet utilisateur l'a également mis dans ses coups de cœur.