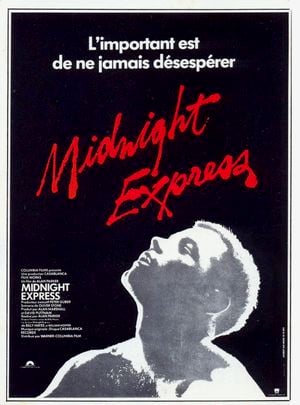Il y a dans Midnight Express cette impression d’un film fait à mains nues, comme si la pellicule avait été trempée dans la même sueur que celle de ses personnages. Alan Parker n’y filme pas une histoire de prison, mais l’expérience sensorielle de la perte : perte de repères, de langage, de soi. Le cinéma n’est plus un dispositif de représentation, il devient machine à confondre le spectateur avec la matière du cauchemar. Ce n’est pas le récit d’un homme enfermé, mais celui d’un regard qui ne sait plus où se poser.
Tout le film tient dans un tremblement. Le premier plan — Billy Hayes qui court, le cœur cognant plus fort que les tambours de Giorgio Moroder — installe déjà la logique du piège. Parker resserre, découpe, tord l’espace jusqu’à ce que la fuite devienne pure abstraction. On dirait que la caméra cherche un point d’air et n’en trouve pas. Elle tourne autour des corps comme autour d’une vérité impossible à saisir. Le grain de l’image, légèrement brûlé, étouffe la lumière : on entre dans un monde sans dehors. Le soleil d’Istanbul ne brille que pour mieux mordre. Rien n’est exotique ici, tout est hostile, saturé de bruits métalliques, de halètements, de cris étouffés — un théâtre organique où la géographie devient un muscle en tension.
La force de Parker est de ne pas se contenter de montrer la souffrance : il en fabrique la texture. La caméra devient un instrument de supplice, et le montage, une alternance de spasmes et de silences. Rien ne dure, tout saigne par fragments. On pourrait parler d’expressionnisme si ce mot n’avait pas perdu son tranchant ; disons plutôt que le film invente une forme d’excès contrôlé, où chaque plan semble au bord de l’explosion. C’est là que réside la modernité de Midnight Express : dans ce déséquilibre calculé qui fait que la violence n’est jamais décorative, mais organiquement liée au dispositif. Le spectateur n’assiste pas, il subit. Et c’est ce qui, aujourd’hui encore, rend le film presque insoutenable.
Brad Davis, visage d’enfant broyé par la fatalité, est l’un des rares acteurs de l’époque à avoir su jouer la défiguration. Son corps devient métaphore : ce n’est plus un personnage mais un territoire ravagé. Son regard, d’abord naïf, se vide peu à peu de tout reflet. À ses côtés, John Hurt compose une ombre — une présence dissoute, spectrale, qui semble toujours au bord de disparaître. Parker filme ces hommes comme des figures écorchées dans une fresque de Francis Bacon : le visage coule, la chair s’ouvre, le cadre absorbe tout. Le cinéma retrouve ici son pouvoir archaïque : non pas raconter, mais inciser.
Ce qui frappe, en revoyant le film aujourd’hui, c’est l’audace plastique de son dispositif technique. Les effets spéciaux, discrets et pourtant décisifs, agissent comme des opérations d’illusion internes. Le maquillage — plaies, sueurs, fièvres — n’est jamais décor, mais prolongement de la matière du film. Parker refuse la stylisation ; les blessures ont l’air humides, les murs transpirent. Les trucages de chaleur et de lumière, obtenus par des filtres orangés et des halos sur-exposés, créent l’impression d’un enfer étouffant sans recourir à l’artifice visible. Les visages deviennent surfaces mouvantes, rongées par la chaleur. On touche ici à une forme d’hyperréalisme poétique, presque charnel, rendu possible par l’exacte alliance entre l’éclairage de Michael Seresin et la machinerie analogique du tournage : un effet spécial non pas pour simuler, mais pour sentir.
La musique de Moroder agit comme un fil électrique tendu à travers le film. C’est une pulsation synthétique, un battement de cœur électronique qui contredit l’époque de l’action et propulse le récit dans une temporalité décalée. Ces nappes sonores — d’une modernité glaciale pour 1978 — ne commentent pas, elles perforent. On pourrait croire qu’elles appartiennent à un autre film, à une autre matière, mais c’est justement cette dissonance qui donne à Midnight Express sa dimension hallucinée. L’électronique, encore balbutiante, se mêle au bruit organique du monde, et le cauchemar devient rythmique. Rarement la musique aura autant contaminé la mise en scène.
Certains ont reproché au film sa simplification morale, la manière dont la Turquie y est réduite à un monstre collectif. C’est vrai : le regard occidental de Parker et d’Oliver Stone ne cherche pas l’équilibre, il tranche dans le vif. Mais cette réduction, loin de diminuer la force du film, en accentue la portée symbolique. La prison devient métaphore de tout pouvoir sans visage. Ce n’est pas la Turquie qui est en cause, mais la mécanique de l’enfermement — cette part de barbarie que tout État, toute société, porte en son centre. L’outrance est ici une méthode, pas un accident. Le film ne prétend pas à la vérité documentaire, il s’abandonne à la vérité émotionnelle : celle du cauchemar.
On aurait tort de voir Midnight Express comme un simple film à thèse ou un pamphlet. Ce qu’il met en jeu, c’est le pouvoir du cinéma à fabriquer du réel avec du désespoir. La caméra de Parker, tour à tour inquisitrice et hallucinée, est un instrument de transmutation. À mesure que Billy se déshumanise, le film se dépouille lui aussi : la mise en scène se simplifie, le cadre se resserre, les sons se raréfient. Au moment de l’évasion, l’image retrouve soudain la respiration qu’elle avait perdue, et ce souffle arraché devient une libération non pas narrative, mais plastique. Le montage final n’est pas celui d’un triomphe, c’est une sortie de corps, presque mystique, qui dissout toute notion de justice ou de victoire.
On pourrait dire que Midnight Express marque la fin d’une innocence du cinéma américain : celle où la souffrance pouvait encore se filmer sans distance critique. Mais cette absence de distance est aussi sa grandeur. Parker ose la frontalité, la surexposition, la démesure. Son film ne se regarde pas avec le confort de l’analyse : il se reçoit comme une fièvre. Il brûle l’écran, comme la chaleur des cellules qu’il filme. Et c’est peut-être cela, la plus belle des transgressions : faire du cinéma un lieu où l’angoisse devient lumière.