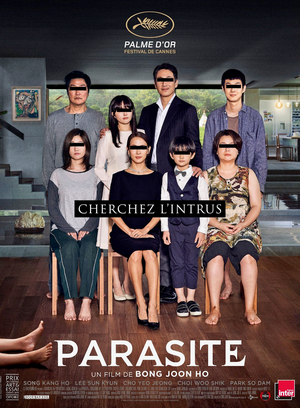Avec Parasite, Bong Joon-ho signe un retour magistral à ses racines. Après l’expérience exigeante d’Okja et les contraintes imposées par l’industrie hollywoodienne, le cinéaste choisit un cadre intimiste, presque minimaliste, et y déploie pourtant une œuvre de grande ampleur. Satire sociale, comédie de mœurs, thriller domestique et tragédie morale se conjuguent ici avec une fluidité remarquable, transformant ce qui pourrait sembler modeste en un véritable chef-d’œuvre de maîtrise narrative et stylistique.
Les obsessions de Bong, déjà présentes dans The Host, Mother ou Memories of Murder, trouvent ici leur incarnation la plus féroce. La famille Kim, logée dans un demi-sous-sol à peine percé de lumière, vit dans un espace clos et perméable : poussière, odeurs, ruissellements, chaque détail matérialise l’invisibilité sociale et l’humiliation quotidienne. En contrepoint, les Park évoluent dans une villa lumineuse et aseptisée, suspendue au-dessus du monde, reflet d’une cécité morale presque innocente. Entre ces deux univers, l’ascension des Kim se fait verticalement : chaque étage franchi symbolise à la fois espoir et fragilité, chaque escalier devient vecteur de tension dramatique.
L’usage des espaces est l’un des tour de force du film. Bong transforme la maison des Park en personnage à part entière : escaliers, couloirs, trappes et sous-sols sont autant de signes de pouvoir et de domination. L’infiltration méthodique de la demeure, d’abord comique et ingénieuse, glisse progressivement vers le malaise et l’horreur, maintenant le spectateur en constante oscillation entre le rire et l’effroi. La comédie marivaudienne se fait piège, la farce devient tragédie.
Les personnages incarnent cette tension. L’étudiante Kim, méthodique et résolue, illustre la discipline imposée par la nécessité ; le patriarche, malgré ses maladresses, déploie un génie pratique du camouflage et de la ruse. Chez les Park, les enfants, innocents, contrastent avec l’indifférence implicite des adultes, incapables de percevoir l’intrusion des Kim. Bong exploite ces contrastes pour accentuer sa satire tout en ménageant une tension dramatique intense.
Le film transcende la simple critique sociale. L’odeur qui trahit les pauvres, les hauteurs inaccessibles, la lumière et l’ombre deviennent autant de signes de la fracture verticale de la société. Plus de monstres fantastiques comme dans The Host : la véritable menace est humaine, incarnée par la cécité et le mépris des dominants. Chaque espace, chaque plan, chaque geste contribue à cette démonstration visuelle et morale.
La virtuosité de Bong réside aussi dans sa capacité à mêler les registres. Le rire peut basculer en suspense, l’humour glisser vers l’horreur, et l’horreur se transformer en tragédie. Cette maîtrise confère au film une richesse émotionnelle rare, capable de susciter à la fois jubilation, effroi et réflexion.
L’épilogue, subtil et poignant, laisse une image durable : la faible lueur d’une ampoule, minuscule pulsation dans la nuit des habitations luxueuses. Elle symbolise la persistance fragile d’un peuple relégué à l’ombre, mais dont la voix, grâce au cinéma, retrouve une visibilité. Bong conclut son œuvre avec une puissance rare, entre mélancolie et fureur, rappelant que la lutte sociale, verticalisée et inévitable, ne peut jamais être entièrement sublimée.
En somme, Parasite est un chef-d’œuvre de narration et de symbolisme. Chaque espace, chaque personnage, chaque plan est porteur de sens. Bong Joon-ho y démontre une maîtrise exceptionnelle de la mise en scène, tout en livrant une fresque sociale et émotionnelle d’une intensité rare, où l’art et la critique se conjuguent avec un souffle incomparable.