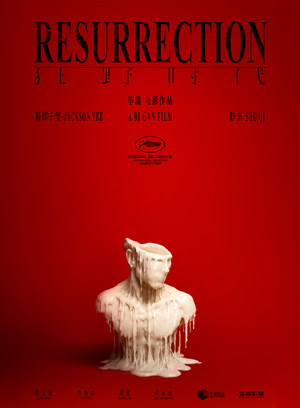"Chaque segment semble être un palimpseste du précédent. Le rêve se dissout progressivement, la capacité à rêver est de plus en plus limité jusqu'à disparaître quasiment totalement" tels étaient mes mots à la sortie de la salle. Bi Gan m'a donné envie de sortir de mon silence, et de me remettre à la critique.
C'est beau. Plusieurs niveaux d'écriture se répondent, le scénario, la mise en scène et le montage. Peut-être l'œuvre la plus complexe de son auteur, tout en étant à la fois sa plus accessible. Au départ et la fin, au milieu des/ du rêve/s, le cinéma, sa naissance et sa mémoire, jamais sa fin. La fin d'un rêve sans doute : celui du rêve par soi-même ; des images nous permettent de continuer de rêver. Finalement, les rêves sont le cinéma, et la vie se trouve dans sa plus pure abstraction.
L'homme-moteur nous montre, se projette en prenant conscience de ce qui existe déjà, d'œuvres qui nous ont marquées : des Lumières à Mizoguchi, en passant par l'expressionnisme allemand, tous seront là à la fin. La création et l'incarnation restent, mais faut-il encore que l'on s'en souvienne. Vous souvenez-vous autrefois, lorsque nous entretenions la pensée ? Plus les décennies passent et plus il est difficile de rêver.
Les premières images du moteur, ou du mot cœur, la possibilité de rêver. Après les déambulations de Shu Qi dans le couloir du cinéma, nous sommes dans une prison. Les barreaux ne nous empêchent pas de penser, ils nous permettent de trouver la solution de l'esprit. Même lorsque le cinéma évoque le rêve dans sa façon la plus littérale, autant dans sa colorimétrie bleuâtre, presque cyberpunk, que dans les mots des personnages semblant être ceux de penseurs, une question demeure : Quelle est cette mallette ? Elle est la constante, elle sera là tout au long des segments. Son contenu changera, mais le signe restera : VOYAGEONS !
Le prochain segment est porté sur la foi, on quitte le rêve dans tout ce qu'il a de plus hermétique, de plus incompréhensible, pour se retrouver avec un dormeur confronté à la religion. Après la violence et les discussions méta poétiques, la simplicité de deux discours, la communions de deux êtres, un jeune adulte et un moine. Un drame avec une dimension du rêve, incarné par des éléments fantastiques qui guettent les personnages. Nous sommes à la frontière de l'implosion, mais le calme prend le dessus sur les cris et la douleur... comme la nette impression d'être dans un gendaigeki de Mizoguchi Kenji. Vers la fin de ce segment, le dormeur se fait entendre, des ronflements grondent et perturbent même le récit rêvé. Il évoque l'entre-deux, à mi-chemin entre le sommeil profond et l'éveil.
Passons à un autre niveau d'abstraction. Cette fois-ci, le rêve est perçu par ceux qui croient. Nous suivons un homme magicien et une jeune fille. Il lui enseigne la magie. Cependant, elle n'est pas surnaturelle, comme au cinéma, elle est une illusion, mais le cinéma a pour but de masquer le mensonge et de n'en montrer que sa conclusion. Ici non, nous avons l'impression d'être dans la réalité, à ceci-près qu'un vieil homme se révèle avoir de réels pouvoirs. Ce rêve paraît être le plus compréhensible pour quiconque. Dans le sens où nous avons tous déjà rêvés d'une réalité quelque peu altérée par des éléments fantastiques sous-jacents. Ici, c'est totalement le cas. Le cadre est bien plus réaliste que les segments précédents, avec une photographie semblant bien plus naturaliste, simple et épurée. Impossible de ne pas se remémorer des films tels que L'été de Kikujiro. Nous sommes proches du réveil, il est de moins en moins profond, au plus près du dormeur. Là où les premiers segments illustraient un sommeil plus profond et imperméable.
Dans le dernier segment, nous suivons un homme et une femme dans des rues chinoises. L'ambiance nous rappelle le Hong-Kong des années 90. Les personnages errent au rythme de ce plan-séquence impressionnant illustrant un rêve violent, au plus proche de la réalité... d'ailleurs... elle n'a plus d'image à nous donner, elle est terne, rêver est de plus en plus difficile, à l'aube du XXIe siècle. Ce qui intéresse, c'est de survivre, dans une société de plus en plus impitoyable. Peut-être est-ce un rappel de la rétrocession de Hong-Kong, du protectorat britannique à chinois en 1997 ? Avec ce contrôle de l'image qui contraint les artistes ? Au final, quand la caméra s'arrête et laisse le temps défilé, l'arroseur arrosé défile à 24 images par seconde, mais la population est accélérée, elle ne parvient plus à regarder et à rêver. Cependant, le couple avance au rythme du cinéma, et Bi Gan les filme sans accélération, leur passion est aussi belle que n'importe quelle histoire que le cinéma nous a déjà raconté. D'ailleurs, nous sommes au cinéma, elle est un vampire. Souvenons-nous de la scène d'introduction avec l'interprète du vampire ? Pouvons-nous en déduire que le seul élément de rêve dans ce segment est un souvenir de cinéma ? Le souvenir de Nosferatu de Murnau ? Non, c'est bien plus que ça, et la conclusion l'affirme. C'est le souvenir du Septième Art.