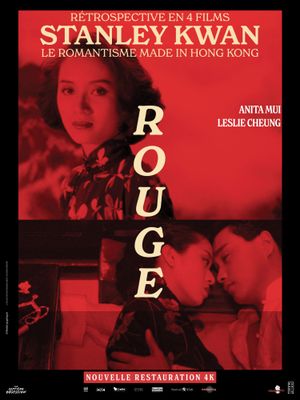Proche stylistiquement et visuellement du cinéma de Wong Kar-wai, qui fait partie de la Nouvelle Vague venue de Chine comme Stanley Kwan, le film Rouge déploie une mise en scène au service presque exclusif de son actrice principale, Leslie Cheung : son personnage, Chang Chen-Pang, use des raccords entre deux champs-contre champs pour se mouvoir ou disparaître de façon magique – à cause de sa condition de fantôme. Et, plus globalement, elle est la force d’attraction de la caméra, dont les mouvements, nombreux, sont toujours pensés d’après elle, pour la maintenir dans le cadre, mais pas nécessairement toujours au centre. La caméra de Stanley Kwan l’aime, alors qu’elle incarne elle-même l’amour absolu : celui qui est profond et éternel, et qui traverse littéralement le temps.
Compréhensif envers les histoires d’amour innervées par la rationalité – illustrées en cela par le couple de journalistes -, le réalisateur choisit néanmoins son camp, celui de l’amour absolu de Leslie Cheung, qui incarne par ailleurs à merveille un personnage d’une beauté fascinante, et dont le fonctionnement au sein de la diégèse n’est pas altéré par le fantastique : ce dernier est présent mais discret, avant tout cinématographique plus que complexe ou théorique, et le film évacue notamment de manière salutaire d’éventuelles règles qui auraient étouffé à coup sûr un film contemporain sous plusieurs couches d’explications. Ici, Stanley Kwan laisse l’aspect fantastique dans le flou, à raison, pour se concentrer sur le mélodrame, en appuyant sur les sentiments des personnages, et les obstacles socio-culturels qui empêchent leur amour de se développer. La musique enrobe cette histoire d’une touche un peu datée, à cause d’un kitsch parfois envahissant, mais contrebalancé par certains moments de grâce musicale – et pas que. Une perle.