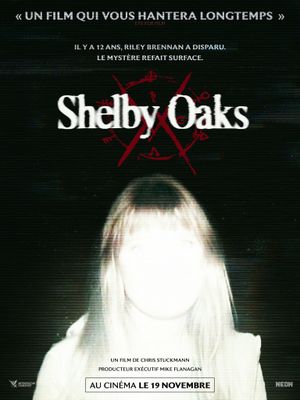Dans Shelby Oaks, la peur ne se présente pas comme un événement, mais comme une lente efflorescence, une de ces ombres qui se déposent d’abord imperceptiblement sur la surface des choses, puis finissent par troubler l’air même que l’on respire. L’enquête autour d’une sœur à la recherche de celle qu’elle a perdue n’est qu’un prétexte pour sonder une autre disparition, plus intime : celle de la certitude que le réel existe sans failles.À mesure que l’héroïne progresse dans ce réseau de souvenirs, d’archives imparfaites, de voix à moitié éteintes, quelque chose se met à dériver. Les images semblent trembler d’un frisson intérieur, comme si le film gardait la mémoire d’une histoire plus ancienne que celle qu’on nous raconte. Les couloirs vides, les enregistrements où un souffle se mêle au silence, les silhouettes qui semblent attendre que l’on détourne le regard : tout cela ne vise pas tant à effrayer qu’à rappeler une vérité enfouie, que l’on avait préféré oublier.Cependant, cette matière anxieuse, si subtile qu’elle en devient presque capillaire, se heurte parfois à une construction trop visible. Les blocs narratifs se succèdent comme autant de chambres qu’on ouvre avec précaution, mais dont on referme la porte trop vite, sans laisser au parfum qui s’en échappe le temps de se mêler entièrement à notre propre respiration. Alors, le charme se fissure par instants : l’histoire voudrait s’étirer davantage, se faire plus continue, tandis que le film semble redouter de s’y perdre.Dans sa dernière partie, l’œuvre révèle l’architecture secrète qui la soutenait, mais cette révélation survient avec un empressement qui contrarie la lente maturation que tout le reste du récit avait patiemment installée. L’on sent que le monde évoqué excède son cadre, qu’il appelle une durée plus vaste, une exploration plus profonde.Reste un film habité d’une mélancolie particulière, où l’horreur naît moins d’un choc que d’un glissement de la mémoire, d’un interstice entre ce que l’on croit avoir vu et ce qui continue à vivre derrière l’image. Shelby Oaks n’est pas une œuvre d’effroi, mais une œuvre d’effritement : quelque chose y se délite, doucement, comme la lumière du soir qui se retire d’une pièce sans laisser personne savoir à quel moment précis elle a cédé la place à la nuit.