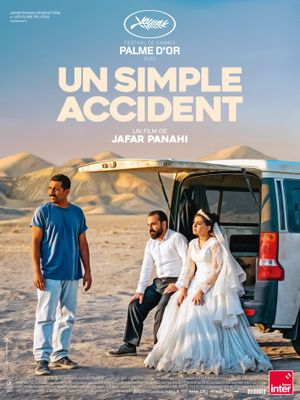Il a décidément de la chance, Jafar Panahi, un cinéaste que j’adore : à part les cinq premières minutes — ce plan-séquence dans une voiture, motif qu’il a déjà décliné une dizaine de fois au fil de sa carrière —, les suivantes m’ont littéralement hérissé les poils. On croirai voir l’un de ces innombrables films franco-européens où tout se joue dans des champ-contrechamps sans âme, où la dramaturgie s’épuise à force d’être filmée avec une banalité désarmante.
Heureusement, à un tiers du film, Panahi se ressaisit : il se souvient qu’il sait encore filmer l’espace, le temps, la durée — bref, qu’il sait faire des plans-séquences. Enfin. Il était temps !
Si je suis resté jusqu’à la fin, c’est moins par intérêt ‘esthétique’ que par curiosité politique : où en est-on aujourd’hui en Iran, du point de vue de la censure ? Et plus encore, du régime ? Car le film en parle ouvertement. Le Guide suprême y est même évoqué. Et malgré cela, Panahi est rentré en Iran après Cannes, revenu en France pour la promotion, repartira sans doute bientôt… À croire que « tout va très bien, Madame la Marquise ».
Mais c’est précisément là que probablement réside le malaise : le pouvoir iranien a toujours su jouer sa survie, se réinventer dans la répression comme dans la tolérance de façade. De ce point de vue, ce film-là n’est peut-être pas le plus courageux de Panahi. Le fait qu’il s’agisse d’une production plus lourde, plus visible — osons le mot : plus mainstream — n’est sans doute pas un hasard. Car, au bout du compte, on ne sait plus très bien qui manipule qui : le régime, ce cinéaste qu’il a pourtant emprisonné quelques mois, ou l’inverse ? C’est peut-être là, paradoxalement, que se niche même la faiblesse, finalement artistique du film, le moins subversif du cinéaste. Hasard ?