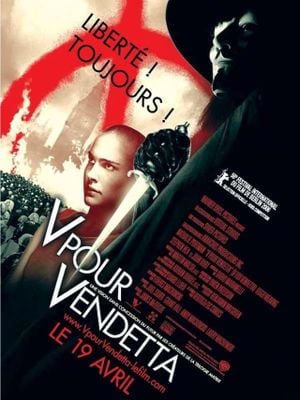Sous le voile de son masque, V veille, verbe vibrant, vengeance vivante. Le film que James McTeigue lui consacre, produit par les Wachowskis, se déploie comme une vaste variation autour de la voix, de la violence et de la vérité. Non point un manifeste figé mais une vision mouvante, à la fois vénéneuse et vertueuse, où chaque plan semble venger le regard du spectateur des vulgarités visuelles de son temps.
Le Londres de V pour Vendetta n’est pas seulement une ville mais un ventre : vaste, vicié, vibrant de peur. La verticalité de ses architectures, les vitres froides de ses couloirs, les visages effacés de sa population esquissent un univers totalitaire où la vérité se dissimule sous le vernis du pouvoir. McTeigue filme cette oppression avec une vigueur rare. Sa mise en scène, volontairement cadrée, presque géométrique, impose une vision ordonnée où tout excès devient suspect. Dans cet ordre glacé s’invite la variation, l’écart, la faille ; V surgit, silhouette noire découpée sur fond de feu, figure vocale et vociférante, véritable vecteur de vertige.
Hugo Weaving, visage voilé, insuffle au personnage une vibration d’humanité paradoxale. Sa voix, voluptueuse et vibrante, vaut plus que mille expressions : elle module la vengeance en volupté verbale, transforme la violence en vers. Chaque phrase semble une volée de violons, un vœu vibrant d’émancipation. Face à lui, Natalie Portman, visage vulnérable, accomplit sa métamorphose avec une vérité poignante. La scène du rasage, traversée de silence et de pluie, s’apparente à une confession. Elle dévoile la vertu que le film valorise : la délivrance par la vérité, la victoire sur la peur.
La photographie, veloutée et presque vespérale, enveloppe les visages d’une lumière vacillante. Elle oscille comme vacille la foi, révélant, dans la vibration des flammes, la valeur spirituelle du combat. La musique de Dario Marianelli, voile symphonique, accompagne le mouvement avec une volupté grave. Violons, valses et crescendos ponctuent la vengeance comme une liturgie révolutionnaire. Le montage, vif mais jamais brutal, veille à maintenir la tension en jouant sur la variation des rythmes, de la lenteur méditative des dialogues à la vélocité vertigineuse des explosions.
Ce qui vaut ici, c’est la visée. V pour Vendetta ne vend pas un simple spectacle ; il revendique une vision. Derrière la vengeance se devine une vocation : faire vibrer la vertu politique dans un monde vidé de valeur. Le film ne prêche pas, il provoque. Sa verve, sa vigueur, sa verticalité en font moins un pamphlet qu’un poème visuel. On y sent la volonté des Wachowskis de varier le vocabulaire du blockbuster : la violence devient vecteur de pensée, la virtuosité visuelle véhicule un vertige moral.
La verve symbolique frôle parfois la véhémence démonstrative. Certaines visions s’étirent et s’enivrent de leur propre verbe. Cette profusion appartient cependant au vertige même de l’œuvre : elle atteste de la vitalité du cinéma lorsqu’il ose renouveler son vocabulaire. Car derrière le masque de V, c’est le visage du cinéma qui vibre — visage variable, vulnérable, voué à renaître dans chaque regard.
Ainsi V pour Vendetta vaut moins pour son verdict narratif que pour sa valeur visionnaire. Véritable vortex d’images et d’idées, il rappelle que la vertu du cinéma réside dans sa capacité à faire vaciller les vérités établies, à faire vibrer l’invisible. Le film s’achève sur un peuple vêtu de masques, foule vivante et vouée à la vengeance symbolique. Ce moment, vibrant d’un souffle collectif, invite à voir au-delà du voile et peut-être à croire encore à la victoire du verbe sur la violence.