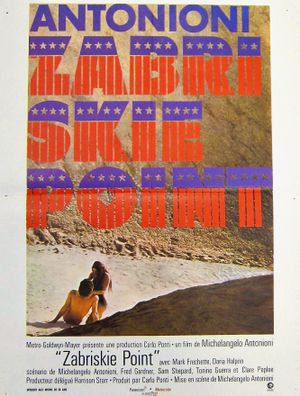Zabriskie Point reste avant toute chose un film sur les illusions révolutionnaires, que Michelangelo Antonioni place au contact d’autres illusions inhérentes au rêve américain ; en cela, son geste artistique et politique prolonge celui de Jean-Luc Godard qui, trois ans plus tôt, orchestrait la faillite d’un idéal et la séparation des étudiants qui le défendaient (La Chinoise, 1967). Aussi la quasi-totalité des images est-elle issue d’un point de vue explicitement référencé, en témoigne ce goût pour les zooms réalisés alors que la caméra est en mouvement, captant un visage de la même manière qu’un feu tricolore venant de passer au rouge, signe de l’interdit ouvert sur d’autres signes, la transgression et l’arrêt définitif : l’explosion réitérée de la villa, déclinaison politique de l’orgie accomplie auparavant, n’advient que par le truchement de Daria, tel le mirage désertique durant lequel des cops s’assemblent dans une poussière faisant disparaître leurs différences.
À l’instar du cinéma d’Antonioni dans son ensemble, le long métrage interroge la notion de représentation et articule les trajectoires individuelle et collective : son protagoniste masculin incarne la nécessité de « prendre de la hauteur », seule action pour s’affranchir de la manipulation médiatique et publicitaire qui dégrade les idéaux en produits de consommation, convertit l’inhumanité d’un désert en paradis pour couples friqués – métaphore de la ville de Las Vegas, située non loin de là. Le cinéaste et son équipe ne cessent de subvertir des symboles, qu’ils appartiennent au camp de l’ordre ou au camp étudiant : le nom de Karl Marx est inscrit au registre lors d’une arrestation, mal orthographié= d’ailleurs (« Carl »), le vêtement rouge de la révolution ne sied pas à la jeune femme et devient un accessoire pour jouer au toréador avec un avion… L’ambiguïté règne et constitue l’audace suprême de ce chef-d’œuvre à ce point libertaire qu’il s’affranchit de toute idéologie établie pour voler de ses propres ailes.