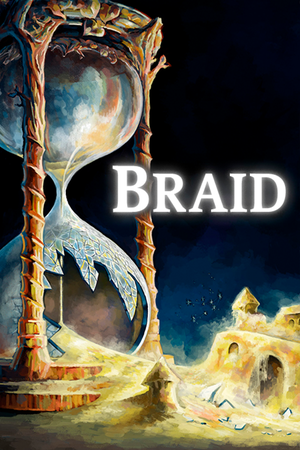Braid, c’est un jeu qui m’a profondément marqué. Il fait partie de ces rares titres auxquels j’ai mis un 10/10, sans hésiter.
À sa sortie, il m’avait semblé unique : une aventure poétique, presque hors du temps. Les décors ressemblaient à des tableaux vivants, peints à la main, suspendus dans une atmosphère mélancolique. Et justement, le temps est au cœur du jeu — non seulement comme mécanique, mais aussi comme métaphore.
L’histoire n’est jamais racontée de manière frontale. On la devine, on la reconstruit peu à peu. Derrière ses puzzles ingénieux, Braid cache un récit sombre, souvent interprété comme une métaphore du remords et de la destruction, avec des allusions à la bombe atomique et à des conséquences irréversibles.
L’histoire semble, à première vue, celle d’un homme (Tim) cherchant à sauver une princesse.
Mais à mesure qu’on avance, on comprend que cette quête est métaphorique : Tim ne cherche pas une princesse réelle, mais une idée, un souvenir, ou même une création dangereuse qu’il regrette. Et cette création, c’est la bombe.
C’est un jeu qu’il faut ressentir plus que comprendre. On avance, on échoue, on remonte le temps — un peu comme dans la vie.
À l’époque, Braid m’a même donné envie d’écrire. J’étais adolescent, et ce jeu m’a fait comprendre qu’un média interactif pouvait raconter des histoires autrement, avec autant d’émotion qu’un livre ou un film. Et, encore aujourd’hui, il m’arrive par moments de retrouver ce goût, cette envie d’écrire — un écho de ce que j’ai ressenti la première fois que j’y ai joué.
J’ai testé la version anniversaire, qui m’a laissé une impression plus mitigée : techniquement réussie, mais un peu paresseuse dans l’esprit. Rien, cependant, qui ne ternisse l’éclat de l’œuvre originale.
Braid n’est pas qu’un simple jeu indé culte : c’est une expérience artistique, un voyage intérieur sur le temps qui passe, les erreurs qu’on voudrait corriger, et la beauté de ce qu’on ne peut pas changer.