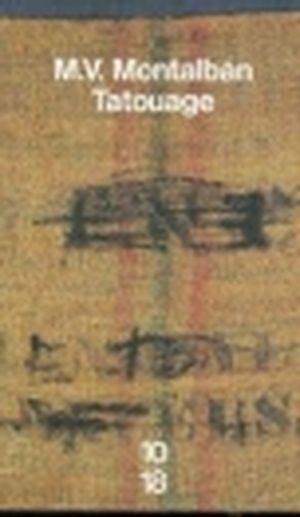Lectures – 2025
18 livres
créée il y a 8 mois · modifiée il y a 29 joursTatouage (1976)
tatuaje
Sortie : avril 2000 (France). Roman
livre de Manuel Vazquez Montalban
Mark-McPherson a mis 4/10.
Annotation :
Classique enquête policière réhaussée de quelques exubérances : le déplacement de l’intrigue dans les quartiers hippies d’Amsterdam (propice à une bonne scène de filature), l’appétit insatiable du narrateur, obsédé par la nourriture... L’ensemble reste toutefois conventionnel, à commencer par la caractérisation des personnages (le privé taciturne, la prostituée servant de compagne au héros, le client patibulaire). Montálban ne se démarque toutefois par écriture stylisée, témoignant parfois, dans des enchâssements d’images poétiques complexes, de l’influence baroque d’une certaine littérature sud-américaine.
Meurtre au Comité central (1981)
Asesinato en el Comité Central
Sortie : 1982 (France). Roman
livre de Manuel Vazquez Montalban
Mark-McPherson a mis 5/10.
Annotation :
Roman le plus célèbre de son auteur, Meurtre au comité central vaut avant tout pour la galerie de portraits qu’il dresse, véritable condensé des différentes tendances de la politique de gauche espagnole au début des années 1980. Des vieux barbons staliniens aux tenants de l’euro-communisme, Montálban donne un éventail des différents courants du marxisme à l’heure où bloc de l’Est perd en influence sur les politiques européennes. On regrette toutefois que l’auteur n’ait pas articulé l’intégralité de son récit à la question politique. Les impératifs narratifs de l’enquête et le goût du pittoresque madrilène, réhaussé par le chauvinisme de l’enquêteur-narrateur (qui est originaire de Barcelone) finit par diluer la pertinence du propos dans un classique récit policier d’une facture plutôt conventionnelle.
Dans l’œil du démon (1918)
Sortie : octobre 2019 (France). Roman
livre de Junichirō Tanizaki
Mark-McPherson a mis 7/10.
Annotation :
Courte novela policière sur le thème du voyeurisme et du désir de fiction. Les trois-quarts du livre, composés exclusivement de longues scènes dialoguées (les échanges entre le narrateur et son meilleur ami) ou beaux sommaires descriptifs (le meurtre central, étalé sur près de 20 pages), sont souvent remarquables. La conclusion, prenant la forme d'un sommaire beaucoup plus ramassé et démultipliant les points de vue par un système de récit enchâssé, s'avère moins convaincante, tant Tanizaki semble pris au piège de la résolution rationnelle de son intrigue, après un récit frisant souvent – et pour le meilleur – le fantastique.
Mon nom est Rouge (1998)
Benim Adım Kırmızı
Sortie : 2001 (France). Roman
livre de Orhan Pamuk
Mark-McPherson a mis 8/10.
Annotation :
Faux polar et vrai roman-monde, Mon Nom est Rouge ambitionne de raconter, à travers le prisme d’une enquête sur le meurtre d’un enlumineur au XVIe siècle, une histoire de l’art renaissant et des rapports esthétiques, théologiques et politiques entre Orient et Occident à l’heure de l’humanisme triomphant. Sous la plume lyrique et variée de Pamuk (qui multiplie jusqu’à une quinzaine de narrateurs différents), le roman fait de la question du naturalisme pictural
et de la perspective, importés de Venise dans les ateliers de peinture stambouliotes, les pivots d’une réflexion sur le conflit entre art et religion. Le sujet fait évidemment écho aux inquiétudes du temps et Pamuk ne tardera pas à pâtir, quelques années plus tard, des foudres de la censure d’État, aux mains des séides conservateurs et du futur président Erdoğan. Au-delà de la force politique de son plaidoyer pour le métissage culturel et le dégoût du fondamentalisme, le livre vaut comme un échantillon de la littérature post-moderne triomphante des années 80-90 (on pense à Salman Rushdie, Michael Ondaatje, Kazuo Ishiguro ou encore Arundathi Roy), où la carte de la littérature s’est étenduée aux confins de nations laissées aux marges de la modernité littéraire. En découle un appétit de récits issus de toutes cultures, particulièrement sensible dans la place prépondérante que donne Pamuk aux légendes perses, ottomanes ou arabes, qui servent à la fois de commentaires allégoriques et ironiques sur le sort des personnages, mais aussi d’excursions imaginaires particulièrement envoûtantes.
Les Racines du mal (1995)
Sortie : 21 avril 1995 (France). Roman
livre de Maurice G. Dantec
Mark-McPherson a mis 6/10.
Annotation :
Roman de tous les excès, préfigurant un certain usage de l’IA (donner foi aux intuitions de la machine) mais aussi terriblement daté dans sa tonalité millénariste (le côté Nostradamus de Dantec) et ses obsessions pop-philosophiques (Deleuze, les serial killers, les biotechnologies). Ce qui ressort de la lecture des Racines du mal, c’est avant tout le caractère inégal d’une écriture mal maîtrisée, alternant scènes dantesques (ne serait-ce que la découverte de la maison des tueurs, étalée sur 40 pages) et passages dialoguées aux limites du nanar. La caractérisation psychologique de l’enquêteur Darquandier et de Svetlana, son acolyte, frise les limites du tolérable, ce que souligne un usage médiocre du point de vue interne (combien de commentaires inutiles à couper par un éditeur !) et des facilités stylistiques à faire frémir - ainsi de quelques zeugmes affreux, dont : "Je reppussais ma tasse de thé et un deuxième soupir" et ce genre de joyeusetés... Mais en dépit de ses fragilités, force est de constater que Dantec s’en sort brillamment dans la première (et meilleure) partie du roman, exclusivement consacrée à la description méthodique des délires psychotiques d’un tueur en série schizophrène. Sens de l’action et de la durée, usage efficace de la focalisation interne, brouillage entre l’imaginaire et le réel : le roman réussit ici, par des moyens relativement traditionnels, ce qu’il peine à retrouver par la suite, après son changement de narrateur et de dispositif.
La Végétarienne (2007)
Chaesigjuuija
Sortie : 25 mai 2015 (France). Roman
livre de Han Kang
Mark-McPherson a mis 7/10.
Annotation :
Dans La Végétarienne, étrange petit roman à l’écriture froide et concentrée, la part centrale prise par le rêve, la fantasme et le souvenir tend à déplacer le récit du côté d’une forme de naturalisme violent, où la brutalité du monde social trouve son origine dans un univers pulsionnel sous-jacent. À la différence de Zola ou des surréalistes, Han Kang refuse les registres épiques et lyriques au profit d’une poésie ouatée et discrète, fondée sur l’accumulation de notations objectives et de fines comparaisons difficiles à dénouer. La structure tripartite du récit, tournant autour de la folie ordinaire d’une femme décidée à abandonner tous ses devoirs sociaux, témoigne toutefois d’une certaine irrégularité : les brefs passages donnant à lire les pensées de l’héroïne dans la première partie ("La végétarienne") atténuent le mystère entourant la jeune femme, figure quasi théorique évoquant certains personnages de Robbe-Grillet. La construction sous forme de fragments, dans la deuxième partie ("La tache mongolique") alterne scènes remarquables et passages moins investis. Dans la dernière partie (la plus belle et éprouvante de l’ouvrage), Han Kang semble la plus à l’aise dans un mélange entre ligne claire (l’extension d’une scène jusqu’à un point de rupture) et brouillage des contours, lorsque le monde intérieur vient s’entrelacer avec la réalité objective.
La Maison noire (1997)
Kuroi ie
Sortie : 1 février 2024 (France). Roman
livre de Yūsuke Kishi
Mark-McPherson a mis 4/10.
Annotation :
La période à laquelle Yūsuke Kishu a rédigé La Maison noire (1997), ainsi que le milieu qu’il dépeint (une agence d’assurance de Kyoto) laissaient espérer, derrière ce récit d’enquête horrifique, une sorte d’équivalent littéraire à la J-Horror (alors en pleine expansion). Que nenni. Le premier roman de Kishi est un thriller de facture traditionnelle, réhaussé d’un peu de gore (les romans de Thomas Harris sont passés par là) et de profiling, en accord avec la mode du polar glauque des années 1990. En résulte un roman parfaitement conventionnel sur le plan du récit, à partir d’un canevas faussement original : Wakatsuki, assureur de son état, devient enquêteur malgré lui après avoir flairé la piste d’un meurtre en lien avec une arnaque à l’assurance. Kishi (qui fut lui-même assureur) connaît ses classiques, puisqu’il s’agit d’une structure héritée du roman noir américain des années 1950. La modernité du récit passe par sa critique assez directe de l’affaissement moral de la société japonaise, en lien avec la dissolution progressive du tissu social derrière les lois de la libre concurrence. Deux scènes d’angoisse pure ressortent du lot à la fin du roman : la visite de la "maison noire" et la course-poursuite entre Wakatsuki et l’assassin dans l’immeuble des assureurs. Presque exclusivement centrées autour d’une logique d’exploration spatiale (dans quels recoins se cacher ? où avancer sans tomber dans le piège ?), ces scènes signalent en creux les apories du reste du roman : un sens assez flottant du point de vue, une distribution mal maîtrisée des indices et une construction narrative à la fois trop lente et précipitée.
Étude en rouge (1887)
Sherlock Holmes, tome 1
A Study in Scarlet
Sortie : 1903 (France). Roman, Policier
livre de Arthur Conan Doyle
Mark-McPherson a mis 6/10.
Une page d'amour (1878)
Sortie : 1878 (France).
livre de Émile Zola
Mark-McPherson a mis 5/10.
Annotation :
Courte récréation sentimentale entre deux mastodontes des Rougon-Macquart, L’Assommoir et Nana. Écrit pour démontrer la versatilité du talent de Zola, satirique endiablé du Second empire et porte-flambeau du registre épique, Une page d’amour est un roman fragile et souvent conventionnel, dans sa peinture de la bourgeoisie oisive et des jeux de l’enfance. C’est la part la plus mièvre de l’auteur qui transparaît dans le portrait de Jeanne, adolescente phtisique surprotégée par Hélène, descendante isolée de l’engeance Mouret. La perversité intrinsèque du récit, qui dessine une relation œdipienne entre la mère et la fille, n’est l’objet que d’une poignée de scènes, brillantes par ailleurs, où le cadre réaliste se fissure pour développer une esthétique aux limites du fantastique. C’est dans la représentation des situations-limites que Zola s’avère le plus inspiré, ce qui démontre par ailleurs les limites éventuelles de son écriture : maître de l’emphase, il peine à restituer la subtilité de sentiments plus nuancés, tant son analyse psychologique se repose, in fine, sur un répertoire de figures et de formules stéréotypées. Bien plus intéressant sera son usage du discours indirect libre, notamment pour restituer les pensées affolées de la mère et l’enfant, où s’ébauche discrètement un rapport moderne à la syntaxe et à la langue.
Les Jours de la peur (1974)
Le piste dell'attentato
Sortie : 10 mai 2024 (France). Policier
livre de Loriano Macchiavelli
Mark-McPherson a mis 6/10.
Annotation :
Court polar de gauche italien, dans une veine d’inspiration française post-68, par son usage constant de la dérision à l’égard des forces de l’ordre. Soit la création d’un personnage culte du "giallo" littéraire (sans rapport avev le cinéma hitchcockien et maniériste qui se développe à la même période) : Sarti Antonio, inspecteur bolognais inefficace et affecte d’une colite ravageuse. L’intrigue des Jours de la peur importe moins que le climat général dans lequel évoluent les protagonistes, suscitant autant de distance ironique que d’inquiétude discrète, jusqu’à la résolution de l’intrigue, aux antipodes du spectaculaire. L’ensemble est servi par la langue drôle et dynamique de Macchiavelli, qui s’amuse à construire une figure de narrateur labile, dont la position dans l’intrigue n’est pas fiable : à la fois narrateur omniscient et personnage intradiégétique auquel Sarti se met discrètement à parler à la fin du récit, ce narrateur serpentin synthétise la perte de repères à laquelle postule le récit, dans la droite lignée des romans noirs californien des années 1940. Difficile de dire si tout cela est vrai, faux, exagéré, inventé ou retranscris d’une histoire vrai, tant l’ironie constante contribue à grignoter la croyance du lecteur dans la sincérité de l’énonciation. Ou comment la littérature populaire a su intégrer les innovations de l’avant-garde littéraire pour le grand public.
Passé, présent et après (1978)
Passato, presente e chissà
Sortie : 15 janvier 2025 (France). Policier
livre de Loriano Macchiavelli
Mark-McPherson a mis 6/10.
Annotation :
Nouvelle aventure de Sarti Antonio, plus déliée et la mélancolique que la précédente. Macchiavelli multiplie davantage les registres, abandonnant la stricte gaudriole, remisée aux dernières pages du roman, pour un mélange de mélancolie et de dénonciation frontale des inégalités sociales et de la misère endémique des banlieues. Les plus belles scènes se situent toutefois aux antipodes des infernales rues de Bologne, dans un havre de paix rural où réside Louisa, beau personnage féminin apportant un contrepoint de dignité aux médiocres protagonistes masculins. Entre silence et notations sensuelles, l’écriture de Macchiavelli décélère et atteint une poésie inattendue, évoquant par endroit un sens de la contemplation issu du cinéma moderne.
Chez les fous (1925)
Sortie : 1925 (France). Récit
livre de Albert Londres
Mark-McPherson a mis 5/10.
Annotation :
Recueil d’articles publiés par Londres en 1925, Chez les fous passe pour un monument du journalisme d’investigation. L’ensemble s’apparente toutefois souvent à une collection de "choses vues" unie par une stricte cohérence géographique (un établissement psychiatrique analysé de fond en comble) ou thématique (les aliénées, les fous dangereux, les enfants). Le tableau, rapide et brossé avec vigueur, des conditions de détention, confine toutefois à l’accumulation foraine. Londres s’avère plus incisif dans ses pages de réquisitoire (les "Réflexions" qui closent le livre) ou dans les courts portraits de fous qu’il donne de-ci, de-là. Reste, malgré tout, un sentiment de déception devant les acrobaties de cette langue dont le style s’épuise en pure perte, dans une série de traits ironiques confinant au système.
Le Parfum (1985)
Histoire d'un meurtrier
Das Parfum, die Geschichte eines Mörders
Sortie : 1985 (France). Roman
livre de Patrick Süskind
Mark-McPherson a mis 7/10.
Annotation :
Le Parfum est raconté par un narrateur omniscient au ton surplombant, méticuleux et discrètement ironique, ce qui n’est pas sans évoquer le modèle à venir des relations, journalistiques ou non, de true crime (on rêverait presque d’entendre la voix de Fabrice Drouelle sur le phrasé de Süskind). Cela signale un premier élément d’analyse : l’auteur se donne avant tout l’ambition d’être un conteur, chose dont il ne fait pas mystère dès la première (et célèbre) phrase du livre. Il serait donc sans doute abusif de voir dans son écriture une tentation formaliste de restitution, par le style, de l’évanescence du parfum. Cet enjeu, qui semble beaucoup jouer dans la réputation de l’ouvrage, reste strictement thématique, quand bien même il permette d’activer un solide réseau de significations subalternes, d’ordres principalement philosophique et poétique, parfois très fécond. Parmi ceux-ci, on notera une allégeance manifeste à l’héritage de Baudelaire : Süskind fait du parfum la forme la plus immatérielle - donc la plus profonde - de la Beauté, en même temps qu’il dessine un monde exclusivement tourné du côté de l’horreur et du sadisme. En ce sens, Le Parfum se révèle empreint d’un romantisme noir qui tranche avec la mode postmoderne des années 1980, durant lesquelles il fut publié. Peut-être est-ce précisément l’une des raisons de son succès. Süskind ne semble avoir que faire des jeux sur l’évanouissement du sens dans le déploiement des signes ; son roman est tourné du côté de la métaphysique, dans la mesure où Jean-Baptiste Grenouille, son héros assassin et parfumeur, est à la recherche d’une forme de perfection artisanale (le parfum personnifiant la beauté) tout en percevant l’aporie d’une telle quête. Métaphore de l’artiste moderne, il devient pour le lecteur une conscience obstinée dans la recherche de l’absolu.
Les Frères Karamazov (1880)
(traduction André Markowicz)
Brat'ya Karamazovy
Sortie : 2002 (France). Roman
livre de Fiodor Dostoïevski
Mark-McPherson a mis 10/10.
Annotation :
950 pages en Folio, presque 1300 dans la traduction dans la traduction de Markowitz pour Actes Sud... Les Frères Karamazov s’apparente bien au "roman le plus imposant" désigné par Freud dans un célèbre article, sur "Dostoievski et le parricide". Par-delà ses réputation - et la terreur qu’inspirent les digressions philosophiques et théologiques de ce monument du récit d’enquête -, Les Frères Karamazov s’avère d’abord un grand roman "à scènes", parfois étalées sur une centaine de pages, et dont l’enchaînement parfaitement maîtrisé produit une narration résolument lisible et linéaire. L’inspiration théâtrale de Dostoïevski est indéniable, chaque chapitre consistant (à quelques expressions près) en la confrontation dialoguées d’une poignée de protagonistes. Le modèle de la plaidoierie judiciaire, qui occupe la fin de l’ouvrage, se révèle rétrospectivement l’ultime référent de sa poétique : autour du point aveugle de la vérité inaccessible s’ébattent les tirades, agencées dialectiquement sans que l’intention de l’auteur ne se dégage pleinement. Si l’issue du récit semble jeter l’opprobre sur le parti de Ivan et Smerdiakov, les deux impies de la fiction, la force de conviction se dégageant de la fable du "Grand Inquisiteur", au cours de laquelle Ivan développe une argumentation démolissant toute conviction théologique, est suffisamment convaincante pour que tout l’existentialisme athée, de Sartre à Camus, s’en réclame soixante ans plus tard. Cette propension au dialogue plus qu’à l’architecture narrative, qui pourrait sembler une faiblesse ou une facilité, met par ailleurs l’accent sur une dimension essentielle de l’écriture romanesque : la narration est d’abord une voix, ou un cortège de voix entremêlées, agencées par opposition et ressemblances - ce que Bakhtine désignera plus tard sous le nom de "dialogisme". La poétique de Dostoïevski se révèle à cet égard une école de l’écoute du texte, dans ses accents singuliers et ses incohérences, éléments définitoires de la tonalité particulière de cette figure si mystérieuse qu’on appelle narrateur.
Edit : À la lecture d’un article sur L’Odyssée, je note cette définition de l’épopée : " Qu’est-ce que l’épopée ? À l’origine, une suite dramatique, une série de dialogues récités et joués. D’où l’importance des discours dans L’Odyssée." Dostoïevski était-il familier de cette origine "spectaculaire" (au sens de sa racine, le spectacle) de l’écriture narrative et romanesque ? Son art se révèle en ce sens une tentative de r
Nana (1880)
Sortie : 1880 (France). Roman
livre de Émile Zola
Mark-McPherson a mis 6/10 et a écrit une critique.
Annotation :
Voir critique
L'Île des esclaves (1725)
Sortie : 1725 (France). Théâtre
livre de Marivaux
Mark-McPherson a mis 6/10.
Annotation :
Sous l’apparence d’une courte récréation en un acte sur des thèmes philosophiques à la mode (l’utopie et l’inversion sociale), Marivaux écrit une pièce, certes mineure, mais plus ciselée qu’elle n’en à l’air. Construite, comme de coutume chez l’auteur de La Vie de Marianne, sur une série de mises en abyme, la pièce dévoile la théâtralité inhérente aux coutumes sociales : en adoptant le rôle de leurs anciens maîtres, Arlequin et Cléanthis font l’expérience d’un habitus et d’un langage qui ne sont pas les leurs, offrant au spectateur des savoureuses scènes de parodies galantes, où Marivaux semble tourner en dérision les préciosités de ses propres comédies sentimentales. C’est bien cette la fièvre du jeu (théâtrale, amoureux) qui passionne Marivaux, plutôt que la finalité politique du texte - à l'issue de la comédie, aucun désir révolutionnaire ne pointera le bout de son nez, car nobles et valets regagneront avec joie leurs places d’origine. Cléanthis constitue à cet égard le plus beau personnage de la pièce : esclave enragée vengeant son sang et sa race, elle est le principale vecteur d’une satire aux accents juvénaliens contre le beau monde. Son appétit sensuel témoigne d'une dynamique discrète d'enivrement qui envahit l’île entière : jouant à séduire Arlequin pour imiter ses anciens maîtres, elle manque de tomber réellement amoureuse, à « un mot » près. C’est enfin à elle que revient la morale de la pièce, lors d’une tirade farouche contre les puissants, où "avoir le cœur bon, de la vertu et de la raison" se révèle être l’unique critère valable de distinction sociale - comme une préfiguration discrète des discours frondeurs de Figaro, cinquante ans plus tard, chez Beaumarchais.
Pot-Bouille (1882)
Sortie : 1882 (France). Roman
livre de Émile Zola
Mark-McPherson a mis 7/10.
Annotation :
Rougon-Macquart, tome 10. Me voilà arrivé au point où je m’étais engagé il y a deux ans, lorsque la lecture d’Au Bonheur des Dames (le tome 11) m’avait convaincu de replonger sérieusement dans le cycle à partie du Ventre de Paris. Un premier bilan d’étape s’impose : Zola ne gagne pas à être approché par la lorgnette envahissante et réductrice de la méthode naturaliste, dont les composantes scientistes et hygiénistes la font ressembler à une moraline passée de mode. La vivacité initiale de l’œuvre de Zola se situe dans la tonalité satirique et polémique de ses ouvrages, prolongeant la verdeur de ses articles de presse des années 1865-1870. À l’exception notable de L’Assommoir (qui se nourrit d’une autre inspiration) et de La Faute de l’Abbé Mouret (qui constitue d’ailleurs aussi l’unique ratage de l’auteur pour le moment), tous les romans des Rougon-Macquart, de La Fortune des Rougon au Bonheur des Dames ont à voir avec la satire cruelle, dont l’acmé est atteinte avec Pot-bouille. Zola use (et abuse) ici des procédés flaubertiens de l’asyndète et de l’ellipse pour confronter les lieux communs du conformisme, avide de son propre maintien, à la réalité des faits, incarnée sous la double engeance d’Octave Mouret (le séducteur qui met à bas les ménages) et du chœur des servantes, dont les remarques acrimonieuses ponctuent le roman jusqu’à la dernière page. Comme l’écrivait Gide, il ressort de la pesanteur de Zola la singularité d’un tempérament singulier, hargneux et sans commisération, dont on ne trouverait à l’époque d’équivalent que chez Vallès ou plus tard Barrès. C’est que la satire zolienne suit, finalement, le même chemin que son sens bien connu - et judicieusement célébré - de l’épos zolienne, soit la constitution d’un univers où le réel atteint ses limites - cette "forme de surréalisme particulier" qu’évoque Deleuze pour définir le naturalisme. Si Pot-bouille est une indéniable réussite sur le plan comique, il n’atteint pas tout à fait l’équilibre inouï des grands romans "névrotiques" de Zola (La Curée, La Conquête de Plassans) où l’impulsion critique donne corps à la figuration d’individus monstrueux, traversés par des pulsions qui les animalisent, les disloquent, les abrutissent - révélant la prescience de Zola vis-à-vis des mécanismes de l’inconscient, simultanément des premières découvertes de Freud. Seul Séraphin, le frère fou de Berthe, incarne-t-il cette tendance insane de l’imaginaire zolien, rejoignant les "grandes bêtes" des autres romans.