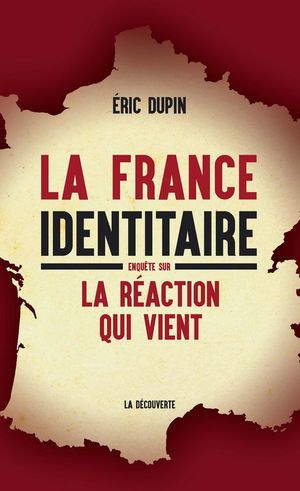On pouvait s’attendre, avec ce titre, à un énième essai consterné (et consternant) de journaliste fantasmant sur le prétendu retour des années trente, dans le goût d’un certain nombre de titres parus ces dernières années. Ce n’est pas le cas cette fois-ci : si l’auteur diagnostique la progression d’une « réaction qui vient » et que c’est une perspective qui ne le réjouit guère, ça ne l’empêche pas de faire preuve de nuances et d’essayer de comprendre les raisons des personnes et des mouvements auxquels il s’intéresse, qu’il s’agisse du Bloc Identitaire, des animateurs du site Fdesouche ou du Front national. On croise également dans le livre les figures de Dominique Venner, de Jean-Yves Le Gallou, de Philippe Vardon, d’Ivan Rioufol ou de Julien Rochedy.
On relèvera un chapitre d’une honnêteté tout à fait inattendue sur Alain de Benoist, faisant la part belle à quelques unes de ses idées motrices et relevant la cohérence intellectuelle de son parcours. « Le fond de la pensée du philosophe consiste à magnifier la diversité humaine et à critiquer vivement tout qui vise à la réduire » explique Dupin. Même Renaud Camus, pointé pourtant pour ses outrances, aura droit ici à une écoute attentive et dépassionnée, considéré enfin pour ses opinions et non par le truchement de l’image diabolisée construite par les médias à son propos. « Les adversaires de Camus avancent souvent une double argumentation logiquement peu compatible, concède-t-il. Primo, ce n’est pas vrai ; secundo, ce n’est pas grave. »
La critique, politique et philosophique, du renouveau identitaire, s’exprime sous la plume de l’auteur comme un argumentaire raisonné et non comme un réquisitoire moralisant – ce qui est peut-être la moindre des choses mais qui mérite tout de même d’être relevé compte tenu du climat actuel. L’auteur réserve par contre une hostilité plus franche à d’autres personnalités, comme Alain Finkielkraut et surtout Houria Bouteldja, chantre d’un racisme qui ne dit pas son nom et d’une véritable haine de la France. Dupin, qui s’inscrit vraisemblablement dans une sensibilité progressiste, reconnaît pourtant la réalité de la « mutation de la composition ethnique de la population française », admet qu’il existe un lien entre homogénéité ethnique et solidarité sociale (il oppose les USA à la Scandinavie) et met en procès l’universalisme abstrait, qu’il voit à l’œuvre à la fois dans une certaine gauche angéliste et chez les tenants de ce qu’il appelle « l’intégrisme républicain ». Refusant le discours anti-communautariste, il appelle à « un universalisme prenant en considération les ancrages ethniques ». Le différentialisme serait-il en train de se faire une place à gauche ?