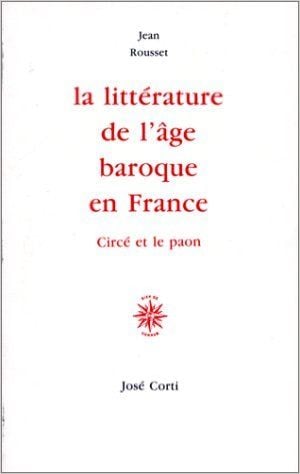La Littérature de l'âge baroque en France
Fiche technique
Auteur :
Jean RoussetGenres : Essai, Littérature & linguistiqueDate de publication (France) : 1953Langue d'origine : FrançaisParution France : 1953ISBN : 9782714303585Résumé : La Littérature à l'age baroque en France a été un événement, I'un de ces livres (comme ceux de Raymond, de Béguin) qui revoient, recueillent, concentrent et dépassent des travaux antérieurs qui n'apparaissent plus alors que comme des préliminaires. D'autres avaient songé, depuis le livre d'Eugenio d'Ors (Du Baroque, traduction française, 1935), à emprunter à l’histoire de l'art la catégorie du baroque pour l'appliquer à la littérature (Boase, Köhler, Lebègue, Raymond, Wellek) : il manquait une synthèse. Il s'agissait de délimiter un corpus : de 1580 à 1670, de Montaigne au Bernin, dans le temps ; en France, quoique le phénomène soit européen, dans l’espace ; une définition sera empruntée à «l'architecture romaine du Bernin, de Barromini et de Pierre de Cortone», parce que «c'est d'elle seule qu'on peut attendre une définition pure et indiscutable du Baroque ; c'est elle qui est chargée de fournir les critères de l'œuvre baroque idéale ». Les principes ainsi posés, la méthode d’analyse et de démonstration est thématique, mais, nous le verrons, ces thèmes sont aussi des formes. Le développement s'organise autour de deux grands thèmes, la métamorphose, symbolisée par Circé, et l'ostentation, symbolisée par le paon. La dernière partie énumère les formes baroques, les critères du baroque littéraire, et les rapports avec des auteurs, des écoles, des périodes voisines. Chaque genre représente un thème privilégié : le ballet de cour la métamorphose, la pastorale dramatique l'inconstance et la fuite, la tragi-comédie le déguisement et le trompe-l'œil. Analysant les œuvres littéraires, Rousset marque la «consonance» entre les niveaux du texte : «entre un héros traité comme un jouet et comme un être de métamorphoses, et une composition disloquée, ouverte, organisée sur plusieurs centres ; I'action se multiplie, le temps s'étale, Ies lignes se rompent, les fils s'entrelacent, les acteurs se déplacent, la matière dramatique foisonne, donnant une impression de mouvement, de complication et de surcharge». Parmi les thèmes, ceux du mouvement (I'eau), du feu et de la fuite, de la mort dominent. L'intérêt des catégories littéraires étant de redécouvrir des textes, c'est un monde inconnu que Rousset ramène à la lumière, une littérature de supplices, d'angoisses nocturnes, de paysages funèbres. C'est le mouvement, finalement mortel, qui domine la vie, dans les figures de la flamme et de la neige, du nuage et de l'arc-en-ciel ; chez Montaigne, « le peintre et le modèle sont mobiles», comme pour Le Bernin, qui, pour son buste de Louis XIV, n’a pas demandé au roi de poser, et l'a laissé bouger. Le mouvement, c'est aussi l'eau des jardins, et des textes dont le Baroque « fait une œuvre d'art ». Ces thèmes présentés, c'est au dernier tiers de sa thèse que l'auteur définit les critères de l'œuvre baroque : I'instabilité, la mobilité, la métamorphose, la domination du décor ; la méthode consiste donc à poser une équivalence entre les thèmes fondamentaux de l'architecture et de la peinture baroques et ceux d'un « ensemble d'œuvres littéraires contemporaines », puis à tenter une contre-épreuve, à partir d'une métaphore (conçue comme déguisement), d'un type de poème (mobile comme la vague et la spirale), de la structure en voie d'éclatement, et de toute une œuvre poétique, celle de Malherbe. Celle-ci, en effet, s'est construite contre le baroquisme, mais ne s'en est pas entièrement dégagée : « On est parfois baroque malgré soi. » L'œuvre de Corneille poursuit la contre-épreuve : après une période baroque, elle tente d'échapper au changement, à la métamorphose, mais c’est pour tomber dans un autre trait, I'ostentation. Celle-ci est bien, en effet, une attitude baroque, que symbolise le paon. C'est encore le cercle épistémologique : parti des arts visuels, Rousset a dégagé des principes, qu'il retrouve dans les textes. Le résultat est un nouveau XVIIe siècle français, où le classicisme n’occupe plus toute la place, soit que l'on jette un regard différent sur des œuvres connues (Corneille, Molière, Malherbe), soit que l'on redécouvre des écrivains oubliés, parce que non classiques (Jean Rousset a publié, en 1961, une anthologie de la poésie baroque française). La méthode a donc une valeur heuristique ; la littérature contre laquelle s'est défini le classicisme ressurgit, résumée dans son architecture : « Au lieu de se présenter comme l'unité mouvante d'un ensemble multiforme, I'œuvre classique réalise son unité en immobilisant toutes ses parties en fonction d'un centre fixe ». Jean-Yves Tadié, in La Critique littéraire au XXe siècle, Pierre Belfond, 1987. SOMMAIRE de L'OUVRAGE : PREMIERE PARTIE De la métamorphose au déguisement Chapitre premier.- Circé ou la métamorphose (Le ballet de cour) Un monde étrange. - 2.- Circé. - 3. L'Univers en mouvement.- 4. Digression autour du ballet. - 5. Protée. - 6. Les êtres doubles. - 7. Le monde renversé. - 8. Le monde est un théâtre. Chapitre II. - L'inconstance et la fuite (La pastorale dramatique) Un modèle de vie. - 2. Magiciens et métamorphoses. - 3. Les inconstants. - 4. Louange de l'inconstance.- 5. La pastorale mystique. - 6. La descendance d'Hylas. Chapitre III. - Le déguisement et le trompe-l'œil (La tragi-comédie) Le théâtre de 1630. - 2. La folie et le déguisement . 3. La précarité et le doute. - 4. Les doublés et les dédoublés. - Le théâtre sur le théâtre. - 6. Une nouvelle esthétique. - 7. Où Protée réapparaît. DEUXIEME PARTIE La vie en mouvement Chapitre IV.- Le spectacle de la mort - Le spectacle macabre: Un théâtre de la cruauté. - 2. Le jardin des supplices. - 3. Survivances gothiques ? 2- De la mort gracieuse au rêve funèbre: L'image de la mort. - Ronsard et la mort. - 3. - Les poètes de la mort. - 4. Le rêve funèbre. - 5. Le paysage funèbre. - 6. La mort convulsée. - 7. La mort en mouvement. Chapitre V.- La flamme et la Bulle (La vie fugitive et le monde en mouvement) 1. - De Sponde à Pascal.- 2. - La flamme et la neige. - 3. Le nuage et l'arc-en-ciel. - 4. La vie fugitive: la bulle. 5. L'homme en mouvement. - 6. Pascal contre le Bernin. Chapitre VI. - L'eau en mouvement L'eau vive. - 2. Précieux et berninesques. - 3. Rêveries. - 4. Les fontaines. - 5. Le dialogue parmi les eaux. TROISIEME PARTIE Du Baroque Chapitre VII. - Formes baroques (Du Baroque dans les beaux-arts) Fontaines baroques. - 2. De la Renaissance au Baroque.- 3. Façades. - 4. Prédominance de la façade. - 5. L'éclatement de l'intérieur: plans ovales; de la Renaissance au Baroque. - 6. La peinture. - 7. L'aire du Baroque. - 8. La France et le Baroque. Chapitre VIII. - D'un Baroque littéraire Les critères de l'œuvre baroque.- 2. Rappel de positions acquises.- 3. Expériences: 1) Un type de métaphore: "Violons ai!és". 2) Un type de poème; 3) Une œuvre poétique prise dans son ensemble: Malherbe. 4) Une œuvre dramatique prise dans son ensemble: Corneille. 5)Une attitude générale: l'ostentation. Chapitre IX. - Conclusions - Rappel. - 2. Le paradoxe baroque. - 3. Le siècle baroque. - Un pré-baroque. - 5. La France et l'Europe. - 6. La part des Jésuites. - 7. Le Baroque et la Préciosité. - 8. Le Baroque et le Classique. - 9. Racine. - 10. A propos de Tartuffe. - 11. Le Baroque et le Romantisme. - 12. L'heure du Baroque.