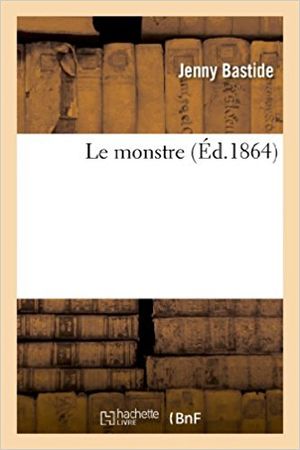Livre obscur d’une autrice obscure : Jenny Dufourquet, qui aura beaucoup écrit pendant la première moitié du 19ème siècle sous les pseudonymes de Jenny Bastide et de Camille Bodin. Elle eut peut-être Eugène de Lamerlière pour complice. Les imitateurs français du roman gothique anglais sont alors légion à cette période, et les plus grands auteurs, Hugo, Balzac, Dumas, s’en inspirent copieusement ; certains en font à proprement parler leur affaire, comme Nodier, ou d’une manière encore plus personnelle Gautier et Nerval. A ces essais en quête de renouveau et de légitimité s’ajoute une quantité d’écrits plus ou moins hybrides, de qualité extrêmement aléatoire, d’auteurs dits « mineurs », dont les noms ne nous sont plus du tout familiers, à l’instar d'Attel de Luttange, auteur du roman intitulé L’Épouse, ou Mystère et fatalité.
Le Monstre est un exemple canonique du roman frénétique dans ce qu’il représente de plus médiocre : tellement médiocre qu’il en devient presque génial, tel un nanar littéraire. En effet, avec ses accointances avec le mélodrame, son écriture fluide dépourvue de réelle originalité, son manichéisme et surtout, surtout, son avalanche de situations clichées et paroxystiques, ce livre est d’un kitsch débridé, d’une noirceur si noire qu’il est difficile d’y croire sincèrement une seule seconde. Tout est exagérément dramatique, ce qui, contrairement au but recherché, peut parfois faire sourire, j’en veux pour exemple le titre de cet avis mais aussi ce simple passage terminant le premier chapitre : « La fatigue de ma route précipitée, la vue de Marie, l’amour qui venait de s’emparer avec violence de toutes les puissances de mon âme, tout contribua à me ravir l’usage de mes sens. Je tombai à leurs pieds et je fus plus d’un mois aux portes du tombeau. »
Sans discontinuer, les malheurs frappent Marie, jeune femme pure et angélique, et Albert, le narrateur, tous deux victimes du comte de Mulsen, être cruel ayant prit en haine l’entièreté de l’espèce humaine, riche brigand, libertin immoral, proprement sadique et manipulateur ; victimes des institutions, de l’appât du gain et de la bêtise des hommes (« Ah ! Qu’il est facile au malheur de ressembler au crime, et combien de fois, hélas! des preuves foudroyantes de culpabilité ne se sont-elles pas déjà amoncelées sur la tête d’un innocent ! ») ; enfin, en dernier lieu et comme il se doit, victimes de la terrible fatalité. Mais les victimes collatérales sont innombrables : la pauvre Louisa, violée et tuée par son propre père ; l’enfant de Marie, mort de cause inconnue au cours d’une sordide course-poursuite ; le vénérable père Anselme, expirant avant d’avoir pu secourir Marie d’une injuste mise à mort ; le père d’Albert et même son serviteur dévoué finissent par mourir sous le coup de ces tragiques évènements. Cette accumulation de malheurs à un rythme si effréné pourrait déjà justifier l’appellation de roman « frénétique ».
A nouveau, comme de juste, le monde entier et la nature se mettent au diapason, reflétant les situations désespérées qui s’agitent en leur sein : « Une forêt de pins, dont la triste et sombre verdure se détachait seule au milieu des neiges qui couvraient la terre, le mugissement sourd des vents sifflant dans la montagne, l’horizon chargé d’épais nuages, et un froid aigu qui commençait à engourdir mes membres. Tout cela m’attristait et je réfléchissais douloureusement à ma fatale destinée, quand le voile funèbre de la nuit vint lentement couvrir toute la nature. », « Les éclats du tonnerre, qui recommença à gronder sur nos têtes, couvraient d’espaces en espaces les sinistres voix des brigands dont les accents entrecoupés arrivaient jusqu’à mon oreille, comme les présages funestes d’une plus funeste destinée. »
Dans un tel climat de désespoir, l’horreur, partout présente, ne se distingue plus nulle part. Il s’agit là d’un paradoxe qui souligne le caractère médiocre d’un tel récit ainsi que les limites du genre bizarroïde auquel il appartient. En fait, là où le style est plus bref, plus sobre, une forme plus sensible et plus subtile d’horreur intervient : « Je vis le bras du bourreau présenter à la multitude une tête sanglante. Je reconnus cette tête où brillaient encore, peu d’instants auparavant, toutes les grâces de la jeunesse et de la beauté… J’ai revu Marie ! »
Quoi qu’il en soit, rien que pour poser ce questionnement, et s’interroger sur l’horreur en général, sa réception, ses motifs, ses qualités et caractéristiques, je trouve justifiée l’existence de ce genre d’écrits, aussi mauvais soient-ils d’un point de vue objectif.