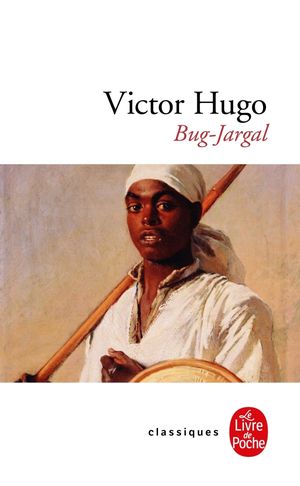Dans son premier roman, Hugo choisit de s’intéresser à la révolution d’Haïti, ancienne colonie française et espagnole nommée Hispaniola puis Saint Domingue, à travers un système narratif particulier : le personnage principal, soldat de l’armée française, fait le récit de son aventure sur l’île à ses camarades de camp. Léopold d’Auverney est alors un jeune noble, neveu d’un colon propriétaire de terres et d’esclaves. Or, selon la réalité historique, ceux-ci se rebellent et s’organisent autour de plusieurs individus importants (Boukmann, Biassou et Toussaint Louverture entre autres) afin de renverser le colonisateur blanc. Dans ce climat politique tendu, notre personnage est amené à sympathiser avec un homme noir, alors nommé Pierrot (qui se révèlera plus tard être Bug-Jargal, fils d’un roi africain), qui a sauvé sa fiancée des griffes d’un crocodile. L’auteur esquisse donc la possibilité d’une amitié entre homme noir et blanc, à tel point que les deux hommes s’appellent mutuellement “frère”, mais ne manque pas pour autant de reprendre, dans la bouche du personnage narrateur, de nombreux préjugés racistes d’époque. Si l’on peut noter l’intérêt précoce d’Hugo pour la révolte (il est alors légitimiste, en témoigne la note anti-révolutionnaire présente à la fin de l’ouvrage), il ne faut pas étendre le choix du thème à des pensées abolitionnistes ou anticolonialistes, qui à mon sens ne transparaissent pas dans le texte : décrire un personnage vertueux parmi une multitude d’êtres animalisés (l’expression “horde” est fréquemment utilisée pour qualifier les foules d’esclaves) ne structure pas un propos antiraciste, mais seulement la narration d’une destinée individuelle, d’ascendance royale qui plus est, qui pourrait rejoindre le préjugé du “bon sauvage”, assez unique parmi ses semblables. De même, l’intrigue convie des personnages qui sont peu travaillés, à l’instar de Marie, fiancée puis épouse de d’Auverney, qui n’a aucune caractéristique propre mais se contente de participer à des scènes typiques (être sauvée par un homme de la menace d’un crocodile, défaillir lorsque son amant lui annonce sa mort prochaine, ne pas remarquer l'intérêt qu’un homme lui porte…).
Pour autant, le roman permet tout de même la médiatisation d’un propos sur la domination vécue par les noirs, notamment à travers le personnage du bouffon Habibrah (à lire d’autres textes d’Hugo, on sait l’importance que revêt la figure du fou et du monstre dans son oeuvre littéraire), qui narre dans une scène saisissante l’humiliation vécue durant des années et infligée par son maître.
Le roman est donc intéressant en ce qu’il s’illustre comme une fenêtre sur le passé, qui s’ouvre sur la perception de tels événements dans le premier 19ème siècle, et les idéologies politiques qu’il convie, mais le choix du thème ne suffit pas pour autant à proposer un discours abolitionniste sérieux.