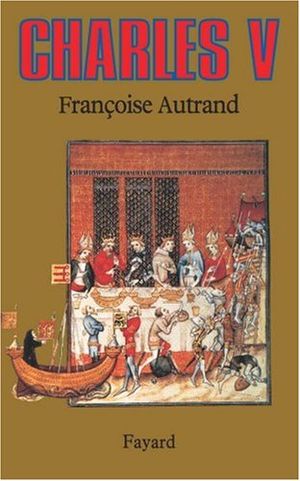Avec une plume élégante et captivante, dans ce style malheureusement disparu d'une histoire littéraire plutôt qu'uniquement scientifique, Françoise Autrand signe une très belle biographie de Charles V, règne aussi exceptionnel que méconnu, après avoir écrit celle de son fils Charles VI.
Charles est confronté pour la première fois à l'exercice du pouvoir alors qu'il n'a que dix-huit ans, dans des circonstances on ne peut plus délicates. En septembre 1356, son père, Jean II le Bon, est défait et capturé par les Anglais à la bataille de Poitiers. Défaite catastrophique, une des pires défaites de la France, ses conséquences sont lourdes qui précipitent le royaume dans le chaos. Le jeune Charles, alors duc de Normandie et dauphin de Viennois, est propulsé à la régence après avoir réuni les États généraux, afin de lever l'impôt nécessaire au paiement de la rançon exorbitante réclamée par les Anglais pour le roi.
Il était en effet admis à cette époque que l'impôt ne pouvait être levé qu'avec l'assentiment du peuple ou de ses représentants — c'est ce que théorise Nicolas Oresme, affirmant que la monnaie appartient au peuple et insistant sur le fait que les Francs ne pouvaient être que libres et non pas serfs (franc veut dire libre) et donc que leur roi ne doit pas être tyrannique à leur égard. Mais avec la réunion des États généraux, les ennuis commencent pour Charles : ils servent de tribune pour les députés du parti réformiste. Le mot parti n'est pas à prendre au sens moderne : il n'a pas de réalité en tant que tel au XIVe siècle. Il s'agit d'un ensemble de personnes qui réclament la réforme du royaume, c'est-à-dire qui veut revenir au bon temps de Saint Louis (réforme veut dire retour vers la forme antérieure, originelle) d'une monarchie contrôlée par la noblesse et le peuple ; il s'agit, en somme, de prôner une forme de monarchie parlementaire contre une tendance d'illimitation des pouvoirs du roi qui sera plus tard appelée absolutisme. Nous aurions tendance, selon notre grille de lecture, à voir l'idée réformiste comme une idée « progressiste », alors qu'il s'agissait concrètement d'un mouvement « réactionnaire », selon notre propre classification, puisqu'il s'agissait de revenir à des pratiques politiques anciennes et de « réagir » à la nouveauté introduite notamment par Philippe le Bel.
Les chefs de cette opposition sont Étienne Marcel, prévôt de Paris, idole de Jean-Luc Mélenchon, et homme le plus riche de la capitale, ainsi que Robert Le Coq, évêque de Laon et partisan de Charles de Navarre. Celui-ci, qu'on appelle aussi Charles le Mauvais en raison de ses innombrables manigances contre le trône de France, détient de fortes prétentions sur la couronne via sa mère qui avait écartée assez arbitrairement de la succession. Il est roi de Navarre mais surtout comte d'Évreux, et une bonne partie de la noblesse normande le soutient qui cherche une troisième voie entre les Plantagênets et les Valois puisque choisir les uns ou les autres revient à abandonner une partie des possessions qu'elle détient de part et d'autre de la Manche. Or, Charles de Navarre ne souhaite pas abandonner ses prétentions sur la couronne et il profite de la situation pour revenir sur la scène politique, de laquelle il était écarté depuis 1356 et son emprisonnement à Arleux, en Flandre, en raison de son implication dans l'assassinat d'un proche du roi Jean. Les États généraux le font libérer en novembre 1357 ; il entame donc sa marche vers Paris, multipliant les joyeuses entrées dans des villes acquises à cause. En fait, presque tout le monde l'était, y compris la plupart des chroniqueurs ayant écrit sur ces évènements : les idées réformistes sont consensuelles, elles ne divisent pas la population comme c'est par exemple le cas avec la droite et la gauche aujourd'hui.
Cette situation compliquée, le jeune Charles parvient à la surmonter avec brio, bien qu'il ne s'en sorte qu'in extremis. Le fait est que, bien qu'il soit pourtant destiné à devenir roi, il est lui-même acquis aux idées réformistes et à un idéal de monarchie limitée. C'est donc sans grandes difficultés qu'il accepte de mettre en place une série de réformes en ce sens avec les États généraux. Mais la situation dégénère. Étienne Marcel soulève la commune de Paris et les révolutionnaires assassinent les maréchaux du régent, voulant le protéger de ses « mauvais conseillers », c'est-à-dire, ceux qui font partie du parti royal (favorable à la toute-puissance du roi) de son père. Le régent trouve donc un prétexte pour quitter Paris et lève des troupes qu'il met en garnison dans des châteaux au nord de la capitale, afin de couper son approvisionnement vers la mer. Pendant ce temps, Charles de Navarre se rapproche de Paris avec les troupes levées par son frère Philippe parmi les soldats Anglais débauchés par la trêve de 1357, un ramassis de pillards sans foi ni loi qui ont préféré attendre le retour de la guerre en pillant le pays plutôt que de rentrer chez eux.
C'est dans ce contexte qu'éclate la Jacquerie de 1358 dont on a pas mal parlé durant les Gilets Jaunes. Jean-Luc Mélenchon avait sorti un vieux livre plus édité depuis belle lurette pour expliquer, dans la cuisine de François Rufin, les parallèles qu'il y a entre la Jacquerie et les Gilets Jaunes, à base de théories marxisantes passablement désuètes. La Jacquerie n'est pas un mouvement motivé par des intérêts matériels relevant de l'organisation du travail, comme le pensaient les marxistes. C'est un mouvement politique porté par la paysannerie aisée picarde, soutenue par les villes et certains nobles, qui conteste avant tout une situation politique et militaire : le fait que le pays soit livré au pillage des routiers anglais sans que les nobles ne parviennent à protéger la société, alors que c'est sensé être leur rôle. Il y a bien toutefois des idées révolutionnaires au sein des Jacques, qui estiment qu'on peut se passer de cette noblesse décadente qui ne sait plus se battre et qui a trahi la France — on imagine, en effet, qu'ils ont été payés par les Anglais pour avoir perd à Poitiers. Les Jacques se réunissent donc en compagnies armées et partent à l'assaut de plusieurs châteaux. Mais, en vérité, les Jacques étaient pilotés par Étienne Marcel qui s'en sert pour détruire les châteaux au nord de Paris où le régent pourrait installer ses garnisons. Or, c'est finalement l'allié du prévôt, Charles de Navarre, qui réprime les Jacques à Mello, le 10 juin, puisque ses soutiens viennent surtout de la noblesse.
La situation à Paris se débloque ensuite d'elle-même. Le siège de la capitale suit son cours et les troupes du Navarrais investissent à leur tour l'Île-de-France. Étienne Marcel fait entrer des soldats du roi de Navarre dans les murs de Paris afin de renforcer la défense de la ville. Mais la population est vite exaspérée par ces soudards qui causent des troubles : les Parisiens s'indignent qu'on ait fait entrer des « Englois ennemis dou royaume » dans les murs de la capitale et les massacrent. Les pillages orchestrés en représailles dans la campagne alentour par les autres routiers anglais du roi de Navarre finissent de porter le discrédit sur le prétendant à la couronne : Étienne Marcel tente à nouveau de faire entrer des troupes, la nuit, mais son projet est éventé et il est tué en pleine rue par ses anciens partisans. Les Parisiens implorent alors le pardon du régent qui peut faire sa joyeuse entrée dans la ville et se réconcilier avec Paris.
Durant cette rude année 1358-1359, le futur Charles V a amplement démontré son talent politique. L'année suivante, le roi mécontent des initiatives de son fils, détricote tout ce qu'il a fait et, parce qu'il en avait marre d'être captif en Angleterre, signe précipitamment une paix honteuse à Brétigny, cédant la moitié du royaume à l'Angleterre en pleine souveraineté — Guyenne, Gascogne, Quercy, Limousin, Saintonge, Périgord, Agenais, Rouergue, Bigorre, Ponthieu et Calaisis — alors que le régent venait de faire subir une défaite cuisante aux Anglais au siège de Reims, en adoptant une stratégie de la terre déserte parfaitement adaptée à la situation : les Anglais, en effet, ont pris l'habitude de chercher une bataille décisive loin derrière les lignes ennemies, en brûlant tout sur leur passage ; le régent, ayant appris des désastres de Crécy et de Poitiers, refuse de leur livrer bataille et les laisse simplement dépérir loin de leurs bases, sans ravitaillement.
Charles V succède à son père en 1364. À peine devenu roi, son futur et fidèle connétable, Bertrand Du Guesclin, impose une défaite décisive au roi de Navarre à Cocherel. En 1369, les seigneurs gascons refusent de payer un impôt décidé par Édouard de Woodstock, fils du roi d'Angleterre et prince d'Aquitaine, et font appel à la justice du roi de France. Le sage Charles V, soucieux de faire respecter l'État de droit, interroge longuement ses juristes. Ceux-ci remarquent que les clauses du traité de Brétigny n'ont pas toutes été respectées, ce qui l'invalide de facto. Après des préparatifs de guerre minutieux et patients, le roi rompt donc le traité : c'est le début d'une longue reconquête, jusqu'en 1378, sans grandes batailles, sans gloire, sans coups d'éclat, mais faite d'innombrables et prudentes escarmouches, afin de ne pas réitérer les désastres traumatisants de Crécy et de Poitiers. Charles V récupère ainsi, patiemment, tout ce que son père avait si légèrement cédé.
Roi dépeint par ses ennemis en avocat tatillon et spécieux, Charles V a su bâtir un type de gouvernement original et novateur : c'est un roi qui communique avec ses sujets, qui explique ses décisions, qui a construit un gouvernement bâti sur le dialogue avec le peuple, étant convaincu qu'on ne peut gouverner de façon pérenne sans l'assentiment du peuple. Intraitable avec le droit, son obsession demeure la souveraineté : c'est son maître mot, le roi de France doit être souverain sur ses terres qu'il ne doit pas abandonner à ses ennemis ou à des princes prenant leur autonomie, comme le trublion Gaston Fébus dans les Pyrénées qui s'autoproclame comte de Foix par la grâce de Dieu seulement. Confiant en ses sujets, croyant dans une monarchie fondée sur le partage des responsabilités et le contrôle du roi, il a mis en place un gouvernement décentralisé, accordant à ses frères, dont il était très proche, Louis d'Anjou, Louis de Bourbon, Philippe le Hardi et Jean de Berry, le gouvernement des différentes provinces du royaume. Confiance, cependant, excessive : Louis d'Anjou, en Languedoc, a provoqué un état de crise dont le roi ne s'est rendu compte que peu de temps avant sa mort, quand les émissaires du duc ont été tués par la population de Montpellier en 1379, provoquant un vaste soulèvement dans toute la province.
Charles V fut aussi un grand défenseur des lettres. Lui-même avait fait installer une vaste bibliothèque au palais du Louvre, dont les volumes traitaient surtout de philosophie politique, sa passion. À la fin de son règne, il impulsa un mouvement de renouveau intellectuel qui débute notamment par la réunion, à sa demande, d'un traité de droit et de philosophie politique par Évrart de Trémaugnon, un ancien capitaine de Du Guesclin qui était aussi docteur en droit : il s'agit du Songe du Vergier, traité stimulant, passionnant, intelligent (qualités rares au Moyen Âge, avouons-le !) qui affirme la légitimité du peuple conjointe à celle de Dieu dans la royauté ainsi que dans la noblesse. Mettant de côté l'idéalisme platonicien, Trémaugnon affirme que la noblesse constitue moins une essence supérieure qu'une convention sociale inscrite dans le droit et dans le regard du peuple. Promotteur de la langue française, Charles V fit également traduire plusieurs livres d'Aristote ; cet essor intellectuel allait surtout profiter à son fils Charles VI, qui y puisa nombre d'idées pour son court règne.
Charles V, en effet, meurt en 1380. Son fils étant trop jeune, un conseil de régence prend le pouvoir jusqu'en 1388. En 1392, le roi est pris de folie pendant qu'il se reposait avec son armée dans la forêt du Mans.
Alors que la France était au plus bas, Charles V a su lui redonner toute sa puissance et résoudre nombre de ses problèmes les plus graves. Charles VI avait commencé un règne brillant mais, sa folie, la rivalité entre Armagnacs et Bourguignons, et enfin le désastre d'Azincourt en 1415 allaient refaire sombrer à nouveau la France dans le chaos.
Une excellente biographie sur un règne passionnant mais peu connu. Françoise Autrand prend ce parti, peu en vogue quand elle écrivait, d'écrire l'histoire à hauteur d'hommes : ce ne sont pas des « systèmes », des « structures » ou des théories philosophiques qui expliquent l'histoire, mais les hommes qui en constituent la matière.