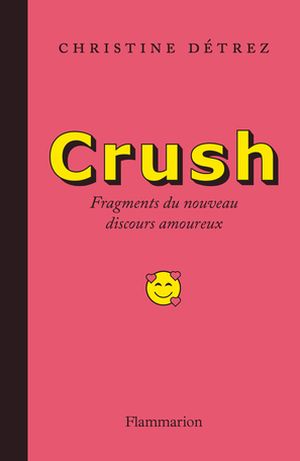Ce n’est pas un livre de sociologie. Ou plutôt, c’est un livre grand public de la sociologue Christine Détrez. Pas de partie méthodologique et épistémologique incompréhensible pour les non-initié·es aux arcanes de la discipline, assez peu de notes et de références, beaucoup d’extraits d’entretiens ; en somme, un dispositif assez light. L’autrice explique l’enjeu (très louable) du bouquin dès l’introduction : étudier scientifiquement, avec les moyens de la sociologie, un phénomène que le sens commun associe par excellence au naturel, à l’évidence, à l’inné, à l’allant de soi, l’amour. Isabelle Clair avait montré dans un livre plus académique (mais accessible), Les Choses sérieuses, que l’amour s’incarnait très concrètement dans des relations sociales dont la sociologie pouvait s’emparer. L’objet de Détrez est différent : en jouant du clivage générationnel qui la sépare de ses étudiant·es, elle met en scène sa découverte du « crush », un mot désignant des représentations et mises en pratique(s) de l’amour dont elle ignore l’existence et le sens.
Après une mise en regard heuristique avec le phénomène du flirt apparu au siècle précédent, rappelant que le crush est une mise en mots et en pratiques de l’amour historiquement située, l’autrice entre dans le vif du sujet : qu’est-ce que le crush ? Les étudiant·es et autres jeunes de son entourage sont bien en peine de lui donner une définition claire et unifiée ; il y a donc, comme on dit dans le jargon, une énigme (ou, comme avait dit Martine Aubry : « quand c’est flou, c’est qu’il y a un loup »). Sans répondre normativement – ce n’est pas le rôle de la sociologue – Christine Détrez explore des pistes, tente des définitions non pas à partir de mots, de figures de l’amour comme Barthes dans ses Fragments, mais d’entretiens avec des jeunes et une analyse de corpus.
Le crush, c’est à la fois cette attirance pour quelqu’un qu’on trouve beau ou belle, […] à qui on ne parlera jamais, et dont on n’espère rien. Le crush, c’est l’amour imaginaire, l’amour dans la tête – et peut-être que le mot « amour », déjà, est trop fort. (p. 82)
Le crush est une pratique sociale, c’est-à-dire socialisée et socialisante. Socialisée : le crush n’existe pas dans l’intimité intérieure et solitaire, il n’existe que sous le regard du groupe de pairs, d’ami·es (plus souvent d’amies, c’est aussi une pratique genrée, plus répandue chez les filles). Socialisante : il permet de faire vivre l’amitié grâce à un secret partagé, de s’intégrer au groupe de pairs – et à travers le groupe la société. Le crush est performatif, c’est un effet de langage : il n’existe que parce qu’on en parle aux autres.
Le crush existe par ces conversations avec des amies, mais, en retour, contribue aussi à renforcer les liens d’amitié. (p. 72)
Une fois qu’on a dit cela, le public de boomers de SensCritique n’a toujours aucune idée de ce dont on parle. Le crush se définit négativement :
Pour les jeunes du XXIe siècle, le crush, ce n’est pas l’amour, ce n’est pas le coup de foudre, ce n’est pas le béguin, ni le flirt ni la « target ». Ce n’est pas non plus tout à fait un amour imaginaire ni un amour dans la tête. Ou pas toujours. (p. 172)
Pour parler comme les interactionnistes, le crush est une étiquette, un label, c’est-à-dire une catégorie mentale souple, floue, indéfinie tout en étant partagée par un groupe social étendu, en l’occurrence une génération : c’est là tout son intérêt. Pour le dire comme l’autrice, c’est une pratique culturelle adolescente comme une autre, c’est-à-dire située dans un contexte historique et technologique particulier.
Mais là où le livre est bien construit et vraiment intéressant, c’est qu’il prend de la hauteur. Dans les deux derniers chapitres, Détrez se demande ce que le crush dit des mutations de la société contemporaine depuis sa jeunesse. Le crush, c’est aussi, et peut-être surtout une réinvention, sinon de l’amour, au moins des rapports de couple, des rapports de l’individu avec les injonctions à l’amour et la sexualité ; en fait, des rapports sociaux et des manières de faire société. C’est donc un objet sociologique. C’est passionnant.