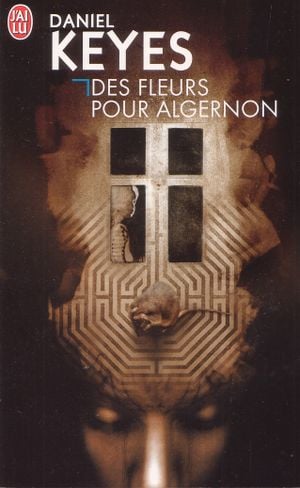Lorsque j’étais petite, mes parents m’ont expliqué que le QI c’était un truc pas pertinent. En général on dit ça à son enfant soit parce qu’il est intelligent (alors à quoi bon) ou bien parce qu’il est bête (dans ce cas c’est plus délicat). Charlie se trouve dans la seconde position (j’ose me situer dans la première).
J’ai d’abord été amusée, je dois l’avouer, par la stupidité de Charlie, mais cela n’a duré que pendant les trente premières pages puisque progressivement on commence à saisir le quotidien que subit ce jeune « adulte » de 32 ans à travers ses « contrendus ».
On peut distinguer dans ce roman l’intelligence matérielle, une certaine attente sociale notamment à travers la culture générale, d’une intelligence subjective, qui selon moi serait le rapport aux autres, aux choses, aux événements, comment entretenir son savoir sans trop en faire et devenir un pompeux surdoué (ce qui va d’ailleurs être reproché à Charlie).
Il y a aussi l’intelligence émotionnelle, où Charlie échoue complètement, à dissocier de cette intelligence subjective où à l’inverse il s’éveille au monde qui l’entoure ; il se rend compte de la réalité de ses relations. Ces supérieurs hiérarchiques n’aiment pas se sentir inférieurs (réaction purement humaine), ses amis ne font que rire de lui, sa famille, en particulier sa mère le renie, etc.
Ce livre met donc en avant la fraction sociétale, inévitable, dûe à différentes couches d’intelligence. On le voit de manière violente dans les rapports avec les docteurs ou à la boulangerie, ou d’une manière plus poétique dans la relation changeante entre Charlie et sa tutrice Miss Kinnian.
Le rapport aux femmes de Charlie est un aspect essentiel du livre. C’est ici que se manifeste le chaos de ses émotions. Tout ceci est bien évidemment dû au comportement de sa mère, subi par Charlie et égalable à de la maltraitance. Le roman traite de la figure maternelle comme la première et plus importante figure féminine d’un jeune garçon. La preuve en serait leurs retrouvailles : il ne lui fait aucun reproche malgré tous les affreux souvenirs, les traumatismes déterrés.
On pourrait débattre sur ce qu’a gagné ou perdu Charlie à se rendre compte de la réalité, de sa place dans son entourage : plus en marge qu’au centre. Comme il le dit lui-même il n’a pas l’impression d’avoir existé avant l’opération. Son entourage ne le considérait pas comme une personne, comme Charlie, mais comme un gros benêt toujours rejeté ou bien comme un poids à absolument changé. On peut donc considérer que cette opération lui a permis d’ouvrir les yeux en plus d’apprendre tant de choses. Mais à quoi bon ? si c’est pour tout oublier par la suite (il en va jusqu’à presque oublier l’opération) et pour que le résultat soit plus douloureux que la blessure initiale. Personnellement je comprends que Charlie ait été heureux de découvrir la vie avec le point de vue d’un homme intelligent mais cela l’a rendu malheureux sur la fin, déplorant ces amitiés passées, et il finit (même s’il n’en a pas forcément conscience) dans un état encore plus déplorable qu’au début. Finalement cette opération a été plus bénéfique pour les scientifiques qui l’ont orchestrée que pour lui car il ne lui en reste moins que rien.
J’ai trouvé la fin un peu trop tragique.
J’ai trouvé la forme du récit Intéressante. Entre première et troisième personne, Charlie établit une distance entre le Charlie déficient mental et celui qu’il est aujourd’hui, tout en insistant sur le fait que le véritable Charlie est celui d’avant, inchangé artificiellement. C’est alors pour ça que ce dernier reste à attendre patiemment de reprendre le contrôle de lui-même.
Enfin le titre, poétique, signe déjà la mort de Algernon, ce cobaye, cette souris à laquelle Charlie s’est tant attaché et qui par analogie annonce son futur. Charlie aura été un homme bête ainsi qu’une bête de foire laissée à l’abandon.