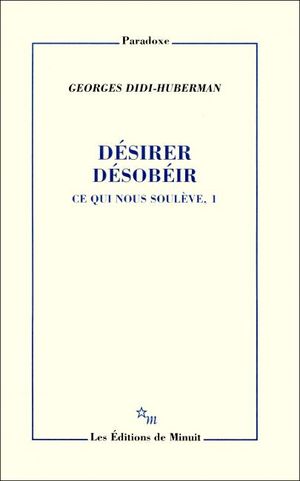Didi-Huberman est un théoricien et essayiste aussi prolifique qu'inventif. Prolifique, puisque cela fait plusieurs années que Didi-Huberman publie au moins un livre par an. Inventif, puisque Didi-Huberman, d’abord historien de l’art reconnu (ayant participé au renouvellement de l’iconologie picturale) n’aura pas hésité à franchir toutes les barrières disciplinaires, souvent avec succès : art contemporain, en tant que théoricien, mais aussi commissaire d’exposition ; photographie, en commençant avec un livre sur l’iconographie de l’hystérie, puis, notamment, un livre sur les photographies prises par un Sonderkommando (ayant donné lieu à de passionnants débats sur les images de la Shoah) ; cinéma, avec des ambitions aussi diverses qu’une réflexion sur l’usage des citations chez Godard, sur l’éthique du montage chez Farocki, sur la figuration des peuples au cinéma en général et chez Eisenstein en particulier.
Avec ce livre, Didi-Huberman se risque à une autre ambition : l’ouvrage de philosophie politique au sens le plus large (même s’il parle volontiers d’une phénoménologie et d’une anthropologie des gestes de soulèvements).
Ce livre est donc une nouvelle corde à son arc, quand bien même Didi-Huberman n’aura eu de cesse de traiter de sujets politiques. Si ce livre est néanmoins pleinement « Didi-Hubermanien », c’est aussi par ses excès et ses limites intrinsèques. Car il existe deux Didi-Huberman, si l’on accepte ce schématisme excessif qui servira uniquement mon propos, à défaut de correspondre à une réalité éditoriale. Le premier Didi-Huberman écrit des livres, certes longs, mais problématisés : l’érudition est éblouissante mais le propos est clair, avec un fil directeur net. J’inclus sa relecture de Fra Angelico, ses essais théoriques de méthodologie sur la peinture, même ses ouvrages colossaux sur Aby Warbug et Georges Bataille. En clair, la thèse des livres est énoncée et appréciable.
Le deuxième Didi-Huberman, qui me pousse à écrire aujourd’hui, est un Didi-Huberman plus tardif, peut être un Didi-Huberman « star », au sens de « connu », « apprécié », qui « vend des livres » et à qui l’on commande des expositions. Ce Didi-Huberman a décidé de ne plus écrire des livres problématisés mais une suite de chapitres qui se termine à un moment donné, sans que l’on ne sache vraiment pourquoi. Je m’explique.
Ce livre, Désirer Désobéir, est un livre passionnant quand Didi-Huberman énonce clairement ses thèses : par exemple, quand il conteste les résultats d’une certaine théorie critique étouffant toute possibilité de révolte (De Baudrillard à Debord), ou quand il analyse le rôle possible de la violence dans un projet de soulèvement, voire quand il est en désaccord avec certaines métaphores (les « essaims » de la multitude). Didi-Huberman prend alors position, il avance dans son argumentation, on le suit d’un point A à un point B.
Ce livre de 500 pages (dont 200 pages supplémentaires sont en réalité une énorme bibliographie) n’est pas jusqu’au bout une analyse de Didi-Huberman. Vous n’y trouverez pas une théorie des soulèvements, mais un « best-of » de toutes les théories existantes. Didi-Huberman a décidé de ne plus écrire de livres, mais de faire des fiches de lecture géantes. Didi-Huberman ne produit pas une pensée problématisée mais écrit sans relâche tout ce qu’il sait, au point de complètement perdre l’intérêt de son lecteur : car pourquoi lire un livre qui ne fait pas de tri, qui cite en moyenne 3 noms différents par page, qui passe d’un chapitre à un autre sans qu’un lien logique ne soit clairement énoncé. Il est très souvent impossible de comprendre ce que Didi-Huberman ajoute à l’auteur qu’il vient de résumer. Alors, bien entendu, Didi-Huberman est un chercheur sérieux : tout est sourcé, l’érudition est affolante, et quiconque s’intéresse au sujet pourra le lire avec profit puisque tout y est. Cependant, doit-on considérer qu’un livre non problématisé est digne de lecture, car uniquement porté par le nom de son auteur ? Car soyons clair, il n’y a aucun éditeur derrière ce livre : Didi-Huberman publie ce qu’il veut dans les conditions qu’il veut, car il me semble net que l’on n’accepterait jamais un tel gloubiboulga (700 pages mêlant aléatoirement prises de position théoriques et simples fiches de synthèse) de la part d’un autre auteur. Ce deuxième Didi-Huberman m’agace moins quand il assume son projet : les récents livres Faits d’affects s’annoncent comme des suites d’articles, et le lecteur est prévenu d’avance. Ce qui n’empêche pas de critiquer ce choix car une véritable problématisation permettrait parfois de faire émerger un puissant livre. Je pense à La Fabrique des émotions disjointes, miné par un début hors-sujet, alors que se dégage par la suite une série de questionnements pertinents. C’est d’autant plus énervant qu’un superbe livre existe « en puissance » avec Désirer Désobéir : si l’auteur avait supprimé quelques chapitres inutiles (car seulement composés de résumés d’autres auteurs), supprimé des chapitres à la limite de l’auto-plagiat (encore un chapitre sur Aby Warburg, le passage obligé de tous les livres de Didi-Huberman, alors même que deux monographies lui sont déjà consacrés par l’auteur) et proposé une ligne directrice claire à son propos.
Ce qui est étonnant c’est que les deux Didi-Huberman (le théoricien clair, capable de problématiser son propos et l’essayiste « résumeur » de livre) cohabitent dans le temps : les récents ouvrages de la série « l’œil de l’histoire » le démontre (courts, clairs et précis).
Le pire est que ce second Didi-Huberman écrase son lecteur de références sans jamais déplier la nécessité d’abattre une telle quantité de noms : certains noms sont seulement cités pour montrer au lecteur (pour impressionner le lecteur serais-je tenté de dire…) que Didi-Huberman connaît bien « tout », qu’il a bien travaillé. En bref, beaucoup de noms cités ne sont jamais commentés car seulement présents pour signaler que Didi-Huberman les connaît (pour nous signaler leur existence, selon une hypothèse généreuse, ou par manque d’esprit de synthèse, selon une hypothèse moins généreuse). J’ouvre une page au hasard, voici un exemple (p. 355) : « Après qu’Alain Brossat eut souligné le caractère « libertaire » d’une telle conception, il reviendra à Martin Beaugh de tirer de nouvelles conséquences théoriques de cette puissance ou « énergie plébéienne ». »
Qu’apporte ici la référence à Brossat ? Strictement rien. Cette citation est un exemple parmi tant d’autres d’une « nuance » purement gratuite qui permet à Didi-Huberman de surfer sur 4 auteurs par paragraphe sans jamais nous offrir la possibilité de comprendre leur pensée (nous ne saurons rien ici de cette conception « libertaire »).
Autre exemple (p. 247) : « les origines du fascisme, entre 1885 et 1914, se placent dans la perspective de ce que Zeev Sternhell a rigoureusement nommé une « droite révolutionnaire » qui en appelait […] à un soulèvement contre tout système démocratique, que ce soit sous la forme d’un coup d’État […] ou de ce que Ernst Jünger nommera bientôt la « mobilisation totale », fondement de cette « révolution conservatrice » bien analysée, entre autres, par Enzo Traverso. »
Ici, une seule phrase (!) comporte 3 noms différents, résumés en une formule mise entre parenthèses, qui n’apportent aucune compréhension du phénomène étudié par Didi-Huberman. Je précise que la phrase suivante débute par un quatrième nom, seulement mobilisé pour une unique phrase. Comme si chaque début de phrase devait débuter par un nouvel auteur à commenter, mais si succinctement que nous devons croire Didi-Huberman sur parole de la nécessité de sa présence ici.
Didi-Huberman prend constamment son lecteur en défaut de connaissance : soit il résume 10 auteurs différents pendant 30 pages (sa capacité de synthèse de chaque livre est impressionnante, mais est contrebalancée par la multiplication ahurissante d’auteurs), pour énoncer une thèse finalement pas si originale ; soit il se contente de signaler, comme ici avec Brossat, l’existence d’une position théorique, mais sans jamais nous la résumer, et sans qu’elle ne serve son propos. Un tel système d’écriture oblige à une nouvelle contrainte éditoriale. En citant autant d’auteurs, absolument tout le temps, Didi-Huberman ne peut plus faire de simples notes de bas de page (cela prendrait au moins la moitié de la page). L’auteur met donc la poussière sous le tapis (la poussière étant l’aspect indigeste de son écriture référencée) en évacuant les notes en fin de livre. Mais le segment final du livre, celui des notes, ne suffit pas à situer les références. En effet, il faut ensuite retrouver l’auteur dans la bibliographie finale : il faut donc pas moins de 3 opérations pour retrouver la source originale (sachant que plusieurs sources sont citées par page!) : rencontrer le nom d'un auteur dans le texte (1), retrouver l’auteur et la date de publication dans le segment dédié (2), puis retrouver la référence, à partir du nom et de la date, dans la bibliographie finale (3).
Terminons en rappelant à quel point la recherche de Didi-Huberman s’avère audacieuse et originale, mais surtout sérieuse. Ce livre se doit d’être lu. Nous sommes néanmoins probablement nombreux à ne pas avoir du temps à perdre avec des livres de 700 pages sans problématique, sans thèse claire, et constituée principalement de résumés d’autres penseurs. Mon avis est clair : je vais faire l'impasse sur les prochains livres du second Didi-Huberman, au profit de ceux du premier, en espérant que son éditeur l'oblige à faire du tri, car à vouloir étaler au grand jour l'intégralité de son savoir, Didi-Huberman ne fait que diluer le potentiel de ses livres.