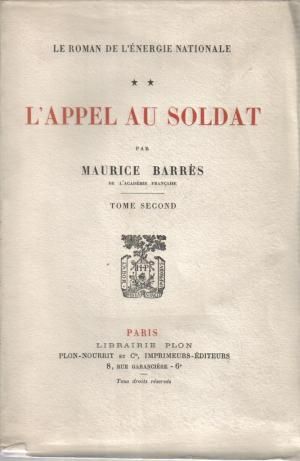Je me lance dans cette critique car personne ne l’a encore faite sur ce site. Deuxième tome de la trilogie de L’Énergie nationale, Appel au soldat prolonge la réflexion de Barrès sur l’identité, l’enracinement et le destin collectif. J’ai trouvé ce volume plus réussi que Les Déracinés.
Le roman s’articule autour de la figure du général Boulanger, perçu comme l’homme providentiel capable de sortir la République de son opportunisme et de sa stérilité parlementaire. Pour Barrès, seule la guerre est capable de fusionner les intérêts d’un peuple, de canaliser ses énergies et de l’unir. Cette exaltation de l’élan national, que Boulanger incarne sans toujours le maîtriser, annonce déjà le rôle que Barrès jouera lui-même pendant la Grande Guerre.
À travers les personnages, notamment Sturel, idéaliste naïf, Romeascher, analyste lucide mais inactif, ou Saint-Phlin, catholique traditionaliste, Barrès met en scène différents visages du nationalisme. La jeunesse projette son énergie dans l’aventure boulangiste, espérant enfin être dans l’action. Mais l’affaire se révèle une leçon de maturité : les retournements d’alliance, les ambitions personnelles et l’instabilité politique dévoilent les faiblesses d’un mouvement davantage porté par une ferveur affective que par une doctrine solide.
La force du texte réside aussi dans ses digressions : ode à la Lorraine et au retour aux racines, réflexion sur l’identité nationale, parallèle entre Boulanger et Louis XVI, ou encore méditation sur la germanisation des esprits par le changement de langue. Barrès développe une vision de la nation fondée sur le sol, les morts et les ancêtres, une idéologie affective et organique qui sacralise l’enracinement, mais qui se heurte à ses limites. Ces développements permettent de comprendre l’idéologie de Barrès, sans forcément y adhérer : ils éclairent à la fois son obsession pour la reprise de l’Alsace-Lorraine à l’Allemagne et son attitude résolument nationaliste dans les journaux pendant la Grande Guerre.
Bien que Maurice Barrès propose une vision profondément enracinée de la nation, celle-ci repose sur une idéologie affective, où le territoire, les ancêtres et l’identité sont sacralisés. Or, la nation, dans sa réalité contemporaine, est avant tout une construction politique et historique, souvent mouvante, parfois artificielle.
En ce sens, la pensée barrésienne, bien qu’intellectuellement cohérente, s’appuie sur un mythe national : celui d’une unité naturelle, homogène et immuable, qui ne résiste pas toujours à l’analyse sociologique ou historique. Elle devient alors une idéologie de l’enracinement, plus émotionnelle que rationnelle.
On peut ici rappeler Ernest Renan, qui disait que la nation est une volonté de vivre ensemble, et non une donnée biologique ou territoriale. Barrès essentialise la nation, là où d’autres la relativisent ou la réinventent. Nietzsche lui-même mettait en garde contre le danger de ces communautés :
« Le danger de ces communautés (les peuples), fondées sur des individus caractéristiques d'une même sorte, est l'abêtissement peu à peu accru par hérédité, lequel suit d'ailleurs toujours la stabilité ainsi que son ombre. »
En somme, Appel au soldat est un roman plus abouti que Les Déracinés, mais aussi un texte idéologique. Il illustre avec force la pensée de Barrès, tout en montrant ses limites et les dangers d’un nationalisme fondé sur l’illusion d’une unité organique et éternelle.