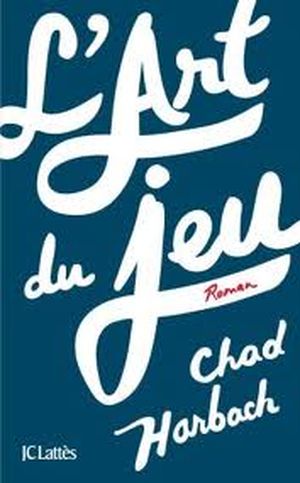Non, L'Art du jeu n'est pas un manuel théorique sur le game design ni le titre français du dernier billet d'humeur d'un éditorialiste d'Edge sur la mouvance actuelle du marché free-to-play. C'est un roman, c'est même un roman dans un roman, traduit de l'américain « The art of fielding » faisant plus explicitement référence au baseball – un bouquin que se passent les personnages, le chérissant comme une Bible, en apprenant par cœur les passages les plus forts, où il est question de technique de jeu ultime et de dépassement de soi. Nous sommes chez les Harponneurs, une équipe de baseball universitaire haute en couleurs qui, après des décennies de défaites, voit enfin le vent tourner grâce à l'enrôlement d'un bleu particulièrement doué. Nous sommes dans leur campus, à Westish, où se croisent (et parfois plus si affinités) étudiants et professeurs. Nous sommes dans leur réfectoire, dans leur bus, dans leur chambre. Bienvenue en Amérique, où l'on est étudiant, jeune, beau, hétéro ou homo, systématiquement nerveux et égoïste – chacun pour soi, chacun pour son bonheur, chacun pour son accomplissement personnel. Le roman de Chad Harbach fait penser à un « American beauty » version baseball : même environnement upper class fatigué, mêmes jeunes et moins jeunes en recherche d'identité, mêmes imbroglios sexuels abordant l'homo ou le pédo (bear), même structure filmique pourrait-on dire aussi.
Car oui, le souci de ce roman est qu'il a un peu trop une gueule de scénario. Ecrit dans un style simple pour ne pas dire pauvre, il est comme engoncé dans l'égalité de sa propre humeur, multipliant intrigues et personnages sans jamais vraiment parvenir à donner de la consistance ni aux uns, ni aux autres. Le rythme est mécanique, les chapitres fonctionnent comme autant de scènes indépendantes qui s'emboîtent sans réelle grâce. Très visuel, le récit s'en tient aux apparences, rechignant à explorer plus avant des psychés potentiellement intéressantes. Un catalogue de gentils névrotiques s'y déploie avec indifférence, dont on connaît les actes à défaut de connaître les pensées, exprimées en surface, sans sous-texte, exactement comme s'il s'agissait d'images... Il faudrait à ce synopsis détaillé l'amplitude de la vision d'un Sam Mendes pour lui donner corps ; à défaut, et en l'état, on reste aux portes de Westish malgré tout ce qu'il s'y passe. A moins que là soit précisément le propos d'Harbach : montrer toute la vanité de ces égos perdus et boursouflés, si étriqués dans leur vision du monde, dans ce « jeu » (sportif mais aussi, et surtout, social), que même leurs pires folies semblent n'être dictées que par la volonté de faire parler d'eux. Ce n'est d'ailleurs peut-être pas un hasard si l'un des seuls personnages charismatiques du titre, Henry au talent immense et mystérieux, est aussi l'un des plus sommairement esquissés – laissant, enfin, un peu de place à l'imagination au milieu de ces photos si précieusement cadrées, aux couleurs si ternes et si téléphonées. Malheureusement, on devine que tout cela n'est bien souvent pas maîtrisé, et que, loin d'atteindre l'excellence de ses contemporains auxquels il fait parfois référence (l'Owen du livre de John Irving, ici victime au lieu de bourreau), L'Art du jeu ne sonne guère que comme un produit formaté pour une exploitation télévisuelle. Avec les bonnes personnes à la barre, ça pourrait marcher ; en un roman de quatre-vingt sections coupées à la hache, c'est nettement plus dur d'atteindre la fin sans bâiller.