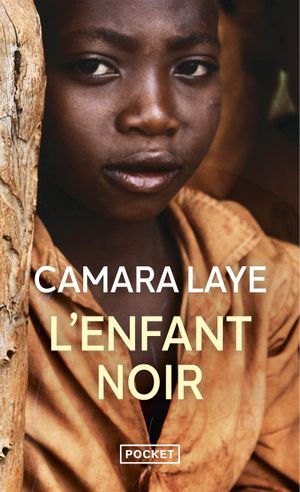Ce court récit autobiographique publié en 1953 par Camara Laye s'inscrit dans un contexte personnel et historique particulièrement significatif. L'auteur, ayant quitté sa Guinée natale pour poursuivre ses études en France, traverse alors une période de désillusion : ses ambitions d'ingénieur se heurtent à la réalité et le mal du pays le ronge. Cette œuvre naît donc dans l'exil, à quelques années seulement de l'indépendance guinéenne (1958), dans une époque charnière où les consciences africaines s'éveillent progressivement aux enjeux de la décolonisation.
Il s'agit donc d'un récit d'enfance et de jeunesse rédigé au début de la période des décolonisations, qui met en exergue les dilemmes personnels d'un jeune Guinéen déchiré entre la modernité potentiellement libératrice du pays oppresseur et les traditions de son ethnie malinké aussi étouffantes que rassurantes.
La plume de Camara Laye est maîtrisée et élégante, mais n'a rien de révolutionnaire. En réalité, elle résonne avec le fond du récit et correspond à l'image de "bon élève" qui semble caractériser ce jeune homme qui, par intelligence et sagesse, tente de s'élever socialement par tous les moyens, à commencer par l'école républicaine et les opportunités qu'elle lui propose, dans une quotidien qui en propose finalement assez peu.
Ces lignes autobiographiques transpirent la sincérité. On devine le soulagement de Camara Laye lorsqu'il couche sur papier ses souvenirs d'enfance, qu'il évoque sa relation fusionnelle avec sa mère, le respect que lui inspire son père forgeron, sa rencontre avec la belle Marie, ses amitiés avec des camarades de classe au destin parfois tragique. Cette authenticité émotionnelle constitue sans doute la plus grande force du récit.
Certaines thématiques du livre sont assez spécifiques au contexte dans lequel a évolué Camara Laye. On pourrait aujourd'hui s'étonner du caractère presque complaisant du regard porté sur le rôle émancipateur de l'école républicaine de la puissance colonisatrice. Il ne faut pas oublier qu'au moment de la publication de ce livre, la Guinée est encore une colonie française et que les ouvrages décoloniaux ne sont encore qu'anecdotiques et peu diffusés. Camara Laye traverse une période difficile où il est partagé entre désillusion et mal du pays. Ces éléments permettent de comprendre son état d'esprit au moment de la rédaction et son besoin de se replonger dans un passé regretté et rassurant plutôt que de conspuer les travers de la puissance coloniale. Cela rend le livre d'autant plus crédible et émouvant qu'il semble véritablement adopter le regard du jeune Camara enfant puis adolescent, sans le filtre critique que pourrait y apposer l'adulte désabusé.
Mais ce qui rend le livre de Camara Laye touchant et agréable à lire, c'est également sa capacité à transcender les spécificités culturelles pour atteindre l'universel. C'est là, je crois, la qualité principale de la grande littérature. Le déchirement entre modernité et tradition, entre ambition émancipatrice d'une part et attachement viscéral à son milieu d'origine et aux êtres chers d'autre part, résonne bien au-delà du contexte colonial africain. La douleur de la séparation avec la mère, magnifiquement rendue dans les dernières pages, les premiers émois amoureux, l'angoisse de l'adolescent face à l'avenir, autant de thèmes qui parleront à tout lecteur et toute lectrice, quelle que soit son origine, son âge ou sa culture. Cette dimension universelle explique probablement le succès durable de l'œuvre et sa capacité à émouvoir encore aujourd'hui, près de soixante-dix ans après sa publication.
En dépit de sa tendresse, de sa mélancolie et de sa mesure, "L'Enfant noir" n'en porte pas moins les germes d'un regard lucide sur la colonisation et le racisme qui l'imprègne. Le titre du livre témoigne à ce sujet d'une conscience aiguë de la différence de traitement et des perceptions induites par la couleur de peau. Plus subtilement, certains épisodes - comme la description des cérémonies traditionnelles ou l'évocation de la sagesse ancestrale du père - révèlent une fierté culturelle qui constitue déjà une forme de résistance face à l'assimilation coloniale.
"L'Enfant noir" demeure un témoignage précieux sur une époque de transition, un récit intime qui éclaire les contradictions d'une génération prise entre deux mondes. Si l'œuvre peut parfois sembler naïve dans son rapport à la colonisation, cette apparente innocence constitue paradoxalement sa force : elle nous livre le regard authentique d'un enfant puis d'un adolescent africain des années 1930-1940, sans artifice ni reconstruction idéologique a posteriori. C'est cette sincérité brute qui fait de ce livre un classique de la littérature africaine francophone, un pont jeté entre les cultures et les générations.