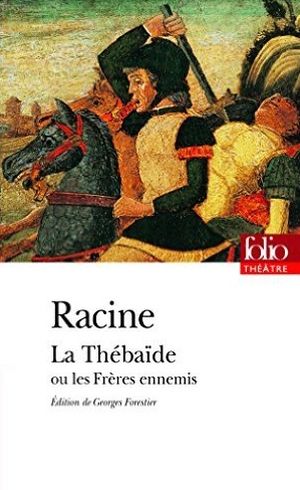Après avoir dévoré une grande partie de l'œuvre de Racine, je me suis laissé intriguer par sa tragédie la plus décriée, y compris par Racine lui-même qui demande l’indulgence de ses lecteurs sur cette œuvre de jeunesse.
Au final, loin du désastre annoncé, j’y vois un cas intéressant qui illustre comment une belle plume et de beaux vers peuvent sauver une pièce qui autrement serait en effet plutôt médiocre.
Je reproche principalement à cette pièce une action qui manque de progression, autant sur le plan de l’intrigue que des personnages. Pour ce qui est de l’intrigue, Racine montrera plus tard avec Bérénice qu’il peut la réduire au strict minimum, et consacrer cinq actes aux états d’âme de ses personnages sans être ennuyeux une seule seconde. Mais ici ce n’est pas le cas : une partie non négligeable du texte consiste à rabâcher la position de chaque personnage sur le conflit en cours.
Ces positions antagonistes de Jocaste/Antigone, Etéocle, Polynice et Créon sont certes très intéressantes, mais n’évoluent pas assez pour ne pas être rébarbatives. Les tirades plaintives de Jocaste, par exemple, sont magnifiques. Mais on pourrait facilement interchanger celles de l’acte IV avec celles de l’acte II, et ça ne changerait pas grand-chose.
Ensuite, une des caractéristiques les plus attrayantes de la tragédie Racinienne manque à l’appel : le déchainement de passions contradictoires qui tiraillent les protagonistes et les mènent à leur perte. Ici les personnages sont discordants entre eux, et certes avec violence, mais ne le sont pas vraiment avec eux même.
A ce titre, cette pièce est donc à rapprocher de Britannicus, qui ignore aussi un peu cette convention, mais dont l’intrigue politique et le traitement du personnage de Néron ont bien assez de substance pour remplir une excellente tragédie. C’est moins le cas ici.
L’auteur essaye de masquer le manque de substance du récit en y ajoutant du superflu. Par exemple l’amour de Créon pour Antigone, qui à ma connaissance est une pure invention de Racine et n’est présent dans aucune autre version du mythe des Labdacides. Ce ne serait bien sûr pas un problème si cela servait le récit de façon appropriée, mais ce choix semble sorti de nulle part et n’a d’autre intérêt que de diaboliser davantage le personnage de Créon, dont Racine veut faire l’incarnation de l’égoïsme. Sauf que ce trait de caractère était déjà bien assez marqué par son rapport au pouvoir, sans qu’on ai besoin d’y ajouter une intrigue amoureuse déconnectée de l’action de la pièce : c’est très artificiel.
Malgré tous ces défauts j’ai passé un bon moment avec cette lecture.
D’abord car le mythe est passionnant en lui même, et l’interprétation faite ici de chaque personnage rend une dynamique particulière qui provoque la réflexion, et ce fameux malaise face au déroulé tragique des évènements.
L’affrontement idéologique des deux frères est loin d’être inintéressant, et ils sont habilement rendus ambigus par leur manque de moralité, qui les rend indignes des idéaux qu’ils portent.
Même si je trouve le personnage de Créon plus subtil chez Sophocle, l’idée d’en faire un égoïste qui s’assume comme tel n’est pas mauvaise. Il se construit en opposition à Eteocle et Polynice, car il s’avoue criminel et ambitieux sans ambages, contrairement à eux qui prétendent représenter respectivement le peuple et la Justice, et rechercher la meilleure issue pour Thèbes, mais sont en réalité surtout mus par la haine.
Ces personnages forment donc un trio réussi, et face à eux, Jocaste et Antigone éplorées sont très touchantes. En plus d’incarner des valeurs pieuses et belles sur le plan humain, j’ai bien aimé qu’elles y ajoutent de réels arguments politiques en faveur de l’issue pacifique qu’elles prônent.
Mais surtout, j’ai été surpris de voir que la plume de Racine est aussi belle qu’à l’accoutumée, y compris dans cette première pièce. Évidemment sur ce point il ne s’agit pas de son chef d'œuvre, loin de là. Mais l’émotion poétique est là, et suffit amplement à donner envie de lire.
Petit florilège :
Dites, dites plutôt, cœur ingrat et farouche, / Qu'auprès du diadème il n'est rien qui vous touche. / Mais je me trompe encor, ce rang ne vous plaît pas, / Et le crime tout seul a pour vous des appas. / Hé bien ! puisqu'à ce point vous en êtes avide, / Je vous offre à commettre un double parricide, / Versez le sang d'un frère : et si c'est peu du sien, / Je vous invite encore à répandre le mien.
Quand je devrais au ciel rencontrer le tonnerre / J'y monterais plutôt que de ramper à terre. / Mon cœur jaloux du sort de ces grands malheureux / Veut s'élever, Madame, et tomber avec eux.
Voilà de ces grands Dieux la suprême justice, / Jusques au bord du crime ils conduisent nos pas, / Ils nous le font commettre, et ne l'excusent pas. / Prennent-ils donc plaisir à faire des coupables, / Afin d'en faire après d'illustres misérables ? / Et ne peuvent-ils point quand ils sont en courroux, / Chercher des criminels à qui le crime est doux ?
Au final une pièce sympathique, qui aurait tout gagné à se jouer en trois actes plutôt que cinq, et à moins user d’artifices. Mais quand le mythe est grand et que le langage est beau, la tragédie mérite toujours mon attention.