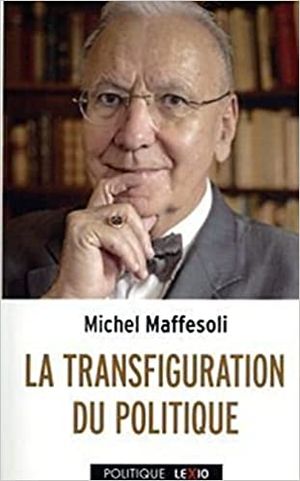La pensée de Michel Maffesoli est sans aucun doute de prime abord étrange, déroutante et ses conclusions inhabituelles et pour le moins inattendues. On peut voir l'ensemble de son œuvre comme une vaste tentative de comprendre notre époque pour ce qu'elle est et, surtout, pour ce qu'elle commence à ne plus être et ce vers quoi elle semble se diriger. Il me semble bien qu'il ne se trouve plus grand monde pour ne pas trouver que notre époque a quelque chose d'effarant, voire d'assez désespérant. Tout l'intérêt du travail de Michel Maffesoli consiste en ceci qu'en lieu et place des habituelles déplorations sur le déclin généralisé des sociétés occidentales, qu'il ne nie pas, il tente de mettre au jour de nouveaux critères qui permettent de la comprendre de façon non plus seulement négative, c'est-à-dire par rapport à un modèle antérieur déclinant, mais aussi affirmative : par rapport à ce qui l'anime de façon distinctive. Or, voici sa thèse principale : la modernité est en train de prendre fin. Et donc avec — c'est problématisé ainsi dans la nouvelle préface que ce livre a été réédité en début d'année — la forme politique qu'elle a prise chez nous, à savoir la démocratie représentative.
Comme il aime lui-même à le répéter, citant Hannah Arendt, chaque auteur n'a dans sa vie qu'une seule idée. Cette idée, Michel Maffesoli l'articule autour de mots-clefs ou de formules martelées régulièrement dans un mouvement spiralique qui emporte avec lui les observations les plus variées et les références les plus diverses, passant du petit fait quotidien le plus anodin aux hautes sphères du mythe qui, dans une herméneutique qui ne manque pas de finesse, l'éclaire sous un jour nouveau, quand ce n'est pas quelque philosophe médiéval ou quelque savant du XIXe siècle qui, dans un infini jeu de correspondances, vient accoler son idée à l'ambiance de l'époque. L'ambiance, voilà ce que tente de cerner Maffesoli, cette chose invisible, indicible, qui pourtant dit tout. Il y a deux idées sous-jacentes au cœur de l'approche maffesolienne : l'édifice spirituel (c'est-à-dire l'ensemble des produits de l'activité de l'esprit) d'une société provient dans son ensemble dans une affectivité particulière, dans un rapport déterminé aux choses, et l'histoire des sociétés est une succession cyclique d'états affectifs qui mutent progressivement les uns dans les autres. Dans cette histoire, nous serions ainsi à un moment de décadence : au sens étymologique, ça tombe. Ça tombe, mais cela devient-il pour autant mauvais ? « La fin d'un monde n'est pas la fin du monde » répète l'auteur.
Michel Maffesoli se réclame du réalisme, au sens de la philosophie scolastique, c'est-à-dire qu'il prône une expérience concrète, sensorielle et immédiate du réel. En tant que « renifleur social », il tâche de cerner les mouvements de fond qui animent la société, parfois minoritaires ou, en tout cas, ne disposant pas de représentations officielles les rendant compréhensibles pour ce qu'ils sont. Alors que la société se conçoit toujours à l'aune des valeurs de la modernité, à savoir le travail, l'effort, l'économie, la raison, l'individualisme, elle s'exprime en partie au moins selon une affectivité différente, presque opposée. Les sociétés occidentales seraient ainsi en proie à un nouvel hédonisme qui s'exprime tout particulièrement dans les villes, dont le nœud se situe dans une attention renouvelée au corps, au sensoriel, à la présentéité, aux choses dans leur immédiateté. Il me semble qu'un journaliste vaguement marxiste (et sans grand intérêt) l'exprimait bien, toujours sur le mode de la déploration, lorsqu'il dénonçait les pratiques du développement personnel comme un renoncement « individualiste » aux grands projets collectifs, où le but n'était plus de promouvoir une modification sociale bénéfique pour tous mais un effort porté sur un bien-être personnel immédiat, attentif d'abord à soi. Voilà bien une ligne de fracture qui en dit long.
Car tel est bien l'enjeu. La modernité s'est conçue comme un travail collectif sur la nature et sur l'humain afin d'œuvrer à un avenir radieux et lointain, qu'on ne connaîtra même pas soi-même. Il s'agissait alors de maximiser l'effort, de valoriser le travail, et de promouvoir ainsi un type humain susceptible d'accepter de fortes contraintes (excessivement névrotique aurait dit Christopher Lasch). Une telle société était conduite par une avant-garde d'intellectuels déterminant a priori le destin auquel la société devait se conformer, et tâchant de mobiliser les masses en ce sens, portées par un idéal de modification volontariste du monde. La modernité se conçoit donc dans un rapport transcendant aux choses : elle poursuit un idéal qui porte l'humanité vers l'avant, vers un mieux radicalement nouveau, vers une forme de sur-nature. Tout au contraire, Maffesoli voit dans la post-modernité un principe d'immanence concentré dans une attention présente aux choses telles qu'elles se présentent à nous. Pour reprendre cet exemple, le développement personnel ne repose effectivement pas sur une croyance en une mobilisation collective vers un mieux à venir ; il se contente tout simplement de chercher une sagesse ou une règle de vie par laquelle la personne trouve une harmonie avec ce qui est, et ce de façon concrète, là et maintenant. Il s'agit, en quelque sorte, de négocier avec la nature, avec le présent, et de trouver un moyen d'y acquérir une certaine sérénité, un certain bien-être, même précaire. Les choses telles qu'elles sont s'imposent, on ne tente pas de les corriger. C'est bien sous ces principes que l'historien des idées Pierre Hadot distinguait la philosophie antique et la philosophie moderne, l'une étant un art de vivre, l'autre une tentative d'agir sur le réel, ou à tout le moins de le décrire.
Les sectes philosophiques antiques : nous y sommes. Prenons « secte » au sens originel n'impliquant pas la connotation négative qu'elle a prise dernièrement, c'est-à-dire comme un groupe de personnes adhérant à une philosophie de vie commune. Le cœur du lien social n'est plus situé dans la forme surplombante dans l'État-nation qui donne corps, selon un principe d'indifférenciation relative, aux individus qui en sont membres ; le lien social post-moderne, d'après Michel Maffesoli, se noue dans la communauté locale, dans la communion émotionnelle manifestée concrètement depuis le bas. Le monde post-moderne serait ainsi une mosaïque de « tribus » rassemblées autour d'identités variées. L'individu post-moderne passerait d'une persona (un masque) à une autre à mesure qu'il passe d'une identité communautaire à une autre, qui n'est par exemple pas la même lorsqu'il est au travail au bureau et lorsqu'il se rend à un concert de tel sous-genre musical dans un bar spécialement dédié à la réunion d'une communauté déterminée d'aficionados. Tous enjeux qui interrogent sur l'essence du politique. Michel Maffesoli y voit une sorte de coagulation, une capacité à rassembler bon an mal an, tant bien que mal, une collection indéterminée d'individus autour de quelque chose de commun qui est plus ou moins accepté. Ce lien nécessite des rites qui le réaffirme, le renouvelle et le confirme régulièrement, qui en manifeste un bref instant la réalité émotionnelle, par exemple, sous la forme d'une victoire de l'équipe nationale de football ou d'élections présidentielles. Les Anciens avaient bien compris la nécessité du rite religieux dans le maintien du lien politique : le mystère du sacré manifeste le mystère du lien politique. Dans le monde moderne, le religieux ne s'est pas détaché du politique, il s'est dissous dedans, comme l'a bien vu Marx. Il faut souligner l'intérêt du travail anthropologique de Michel Maffesoli, qui donne d'innombrables clefs de lecture pour comprendre les sociétés, surtout anciennes.
Car la post-modernité, selon lui, c'est un retour de l'archaïsme dans un monde dominé par la technique. Ce qui est archaïque, c'est étymologiquement ce qui fait principe, ce qui commande à quelque chose en tant qu'il en est l'origine et le commencement. La modernité s'est conçue dans une lutte contre la nature, y compris contre la nature humaine. Dans le monde post-moderne, la nature revient au galop. À bien des égards, sous des formes aberrantes dont on peut à juste titre s'affliger. Mais n'est-ce pas le refus de l'animalité en l'homme qui conduit à la bestialité, comme Heidegger a pu être amené à le dire, constatant les désastres du XXe siècle ? La modernité, en voulant domestiquer l'homme à tout prix n'a-t-elle pas fait pire que mieux ? Il s'agirait de parvenir à concilier l'irrépressible violence de la nature humaine et le principe tout aussi nécessaire d'un ordre social à peu près pacifié. C'est là que se noue, selon Maffesoli, tout le drame du politique : une tension entre le social, « sa vitalité, son désordre fondateur » et l'État, « son ordre mortifère, et sa raison monovalente. » Un drame où jouent deux irrépressibles pulsions : celle de domination et celle, plus étrange mais toute aussi puissante, sinon plus, de soumission. La violence est ainsi le principe-même de la politique, non pas seulement parce que celle-ci l'exerce et qu'elle la réprime, mais plus généralement parce qu'elle se présente comme l'instance où se déploient, sont gérés et se dénouent les conflits (cf. Julien Freund). Or, le conflit n'est dans sa banalité rien de moins que rationnel : il est une animosité de principe, intrinsèque à l'altérité, par exemple lorsque votre voisin vous voue une détestation féroce sans raison apparente. La politique n'est in fine rien d'autre qu'une gestion des passions et, à ce titre, ne repose sur rien de rationnel : toute forme de constructivisme est ainsi largement voué à l'échec. Et c'est donc sur quelque chose d'irrationnel que se fonde, de façon positive, le politique : sur une idée, sur quelque chose qui relève de l'imaginaire, une réalité immatérielle dans laquelle l'individu peut se dépenser, c'est-à-dire se dissoudre, ne serait-ce qu'un instant, dans une unité surplombante, dans une forme qui organise le multiple. La politique consiste ainsi en la sécurisation d'un principe d'unité dans un ensemble social essentiellement divers.
Cette dualité induit un permanent balancement entre la prédominance du divers, qui est pour Maffesoli synonyme de richesse et d'effervescence, et la prédominance de l'unité, qui tarit la vitalité propre au corps social. Or, la modernité consiste bien en une domination de l'Un. L'Un, en ce qu'il est synonyme de perfection, en ce qu'il offre l'espoir d'une pacification aboutie du social, est de longue date auréolée de vertus mystiques. On sait ce que la Raison est censée être Une, cette même Raison au nom de laquelle s'est élaboré le projet moderne : un projet d'arraisonnement, c'est-à-dire de rassemblement à l'unité. La modernité est de ce fait intrinsèquement totalitaire, y compris dans la forme affaiblie d'État-nation, en ce sens où elle vise à totaliser l'existence. Ce totalitarisme peut être dur, imposé brutalement par la force, comme il peut être doux, imposé de façon plus perverse par la contrainte morale inscrite dans la banalité du quotidien, dévitalisant un corps social uniformisé, responsabilisé, où l'altérité individuelle peine à s'exprimer. Dans tous les cas, le totalitarisme s'impose au nom de la science et de la morale : il détermine un devoir-être anticipant une détermination a priori des êtres et des choses. La société moderne est dominée par la figure de l'éducateur-savant qui enseigne ce qu'il faut être et corrige ceux qui s'en écartent, et ce au nom de la raison qui, partant du postulat selon lequel elle est critère du réel (Hegel), aboutit à la conséquence selon laquelle ce qui n'est pas rationnel ne peut pas être, et doit donc le devenir... s'il le peut. « C'est à partir d'un tel présupposé que l'on va justifier toutes les aberrations possibles et imaginables. Je l'ai dit pour les camps de concentration européens, opération rationaliste de bout en bout, et qui devraient être analysés comme le modèle paroxystique de l'organisation sociale contemporaine. Ce n'est pas la liberté et la démocratie qui ont triomphé des camps, ce sont ceux-ci qui ont contaminé l'ensemble du corps social. Le système policier peut avoir perdu de son acuité, il s'est capillarisé, sous une forme adoucie, dans tous les domaines de l'existence : sexualité, loisirs, consommation, tout est soumis à l'injonction de régularité, aucun écart à la norme n'est permis, et cela bien sûr au nom des meilleures intentions du monde. »
Ce règne des technocrates et des bureaucrates tend inévitablement à se refermer sur une petite élite susceptible de comprendre et de connaître le bien ou le vrai vers lequel diriger la société. Pour Machiavel, la vertu était ce qui animait et rassemblait l'ensemble vivant du corps social ; pour Robespierre, elle n'est plus que l'apanage des purs qui doivent commander au reste du monde en vue du bien. Ce qui a pour conséquence, observe Maffesoli, que « ceux qui ne sont pas Jacobins ne sont pas tout à fait vertueux. » Même au sein de cette petite République des sages, l'humaine nature reprend ses droits : sectarisme, comportements tribaux, népotisme, opportunisme, démagogie, toutes choses qui deviennent la norme, toutes choses qui accusent l'éloignement du politique du corps social. Comme dans un puissant retour du refoulé, le social se manifeste brutalement dans une vitalité renouvelée en marge des instances officielles, phénomène que Maffesoli s'attache à décrire tout au long de ce livre.
C'est là que la dernière préface du livre prend tout son intérêt en ce qu'elle place son propos à l'aune de la situation de plus en plus critique dans laquelle nous sommes. Alors que les élites ont fait sécession d'un mauvais peuple refusant de reconnaître le bien-fondé de son projet (Christopher Lasch), comme le prophétisait Maffesoli dans ce livre, la plèbe, elle aussi, tend à se retirer sur l'Aventin... les ronds-points ? L'abstentionnisme grimpant, le désintérêt massif, même, qu'il y a eu pour les dernières élections présidentielles, témoignent d'un désintérêt du social pour le politique, précisément car celui-ci s'est déconnecté de la vitalité du premier. Le petit monde politique n'est-il pas devenu plus rien d'autre qu'une petite sphère qui tend à se refermer sur elle-même (par exemple, en excluant certains candidats indésirables via des procédés à tout le moins non prévus par la Constitution), jalouse d'un moralisme qui sature les ondes médiatiques, brandi comme unique critère de légitimité de représentants politiques n'osant même plus afficher leur réel programme, ne jouant plus que sur une démagogie éhontée devant tant bien que mal maintenir une forme d'adhésion populaire ? Mais cette adhésion — qui est surtout résignée — ne repose-t-elle pas que sur un mensonge dont, d'ailleurs, personne n'est dupe ? Pas plus qu'il ne sert de contester la dernière mise à jour de Sens Critique, pas plus ne porte la désapprobation populaire à l'égard des politiques officielles, et ce pour la simple et bonne raison que le sens de l'histoire est déjà écrit par des élites technocratiques pour lesquelles « il n'y a pas d'alternative » (Margaret Thatcher) : pas d'alternative entre le bien de l'humanité que celles-ci promeuvent et ce qui lui est contraire, et donc qui est nécessairement mauvais. Or, la démocratie représentative, analyse Maffesoli reprenant une observation d'Hannah Arendt, repose bien sur d'une part la détermination par un parti politique d'une représentation philosophique à laquelle, d'autre part, adhèrent les électeurs. Ce lien représentatif est donc pour le moins rompu car aucune des deux parties n'y croit plus. La démocratie décadente se mue en théâtrocratie (Platon), un empire du mensonge, du faux semblant, de l'illusion, où la petite élite des sages, individus dont la dépravation des mœurs ne cesse de s'étendre dans la presse et qui, pourtant, affichent avec une foi renouvelée les vieilles rengaines sur les vertus rédemptrices de l'austérité du travail et de la Raison, ne maintient plus son pouvoir que par la stratégie de la peur — du fascisme rampant, des complotistes, du covid, de Poutine, de la variole du cancrelat ou de la tomate. Réaction lugubre tentant d'étouffer l'effervescence d'une société en proie aux soulèvements — ZAD, Gilets jaunes, grèves multiples et variées...
Toutes choses qui signalent l'inéluctable fin de la démocratie, en tout cas sous la forme qu'elle a prise au XIXe et au XXe siècle. Disparition grave, dont il faut mesurer l'importance et qu'on peut à bon titre regretter puisque s'en vont avec elle les évidents bons côtés de la modernité, souligne Maffesoli, mais disparition nécessaire dans l'économie de l'histoire, promettant une époque riche et vivante comme le sont toujours les époques de décadence, en tout cas d'après la perspective de l'auteur. Reprenant l'idée de Thomas d'Aquin, Maffesoli estime qu'en tout état de cause, le pouvoir provient essentiellement du peuple : c'est la puissance du peuple qui institue le pouvoir institué. Lorsque le pouvoir se détache de la vitalité du peuple, les soulèvements deviennent de ce fait inévitables. En tout cas, telle est la prédiction de l'auteur.