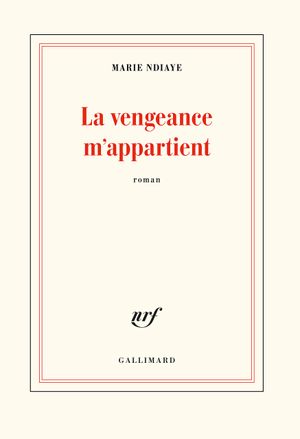Trois femmes impuissantes, pour paraphraser un précédent opus de la romancière. Ou plutôt, à la fois puissantes et impuissantes, tant le roman explore la notion d'indétermination, de flou, d'ambiguïté. Examinons-les tour à tour.
Me Susane
Il y a d'abord Maître Susane, le personnage principal, en relation avec les deux autres, qui ne sera jamais nommée autrement que par cette froide appellation : ainsi Marie NDiaye la réduit-elle à sa profession. Il faut dire que notre héroïne est une transfuge de classe et que sa position acquise fait la fierté de ses parents, dans la très bourgeoise Bordeaux. Mais l’avocate ne réussit guère à percer. Aussi se trouve-t-elle fort étonnée le jour où un dénommé Principaux vient lui demander de défendre son épouse dans un dossier médiatisé : un double infanticide. Pourquoi moi ? est la première question que se pose Me Susane. Or le nom de cet homme lui dit quelque chose. Il évoque un camarade qu'elle eut dans l'enfance, d'un milieu social plus élevé que le sien. Un jour, les deux se retrouvèrent enfermés dans la chambre du garçon, de quelques années plus âgé qu'elle. Et il se passa quelque chose. Quoi ? Impossible de s'en souvenir. Ne subsiste qu'une vague sensation de bien-être. Ses parents, eux aussi constamment nommés d'une façon distanciée M. et Mme Susane, proposent des versions contradictoires : M. Susane prétend qu'il y eut agression sexuelle, Mme Susane que Principaux n'est pas le bon nom. Mme Susane était femme de ménage. Or c'est l'unique jour où celle-ci alla chez "ces gens de Caudéran" (les parents de Gilles Principaux ?), qu'elle y emmena sa fille et que la mystérieuse scène se produisit. Ses employeurs d'un jour se comportèrent de façon exemplaire. Page 32 :
Elle avait repassé le linge dans la cuisine, des vêtements élégants et doux très peu froissés comme de par leur propre volonté de courtoisie à son endroit, et la cuisine lui avait paru être une réplique gracieuse de la sienne, non qu'elle lui ressemblât mais parce que la pièce, douée elle aussi de ses propres intentions généreuses, l'avait accueillie avec chaleur et civilité, lui avait dit : Tu es ici chez toi, et Mme Susane avait acquiescé dans l'ombre d'une arrière-pensée sarcastique [belle formule], elle qui, travaillant chez les autres depuis l'adolescence, avait l'habitude d'évoquer ses employeurs sur un ton de dérision amère.
Pour exprimer le souvenir qu'en garde Mme Susane, celle-ci use d'une formule poétique, page 31 : "j'ai pénétré dans cette maison comme dans un bois lacté". Le mot déplaît à son mari : il considère que c'est enrober de joliesse l'acte terrible qui, selon lui, s'y déroula. Leur fille tente de se mettre du côté de ce père qu'elle aime, sans pouvoir accorder le moindre crédit à la thèse qu'il défend, en se fiant à ses souvenirs.
Sa mère lâche différents noms de famille, Majuraux, Ravalet, des noms qui n'ont rien à voir entre eux. Débloque-t-elle ? La défense de la mère est savoureuse. Page 168 :
- Maman, Ravalet, vraiment ?
- Oui, je le sais à présent, comme je te l'expliquais j'ai, en quelque sorte, mis ma mémoire en demeure d'être exacte.
- Tu l'as mise en demeure, mais, maman, ta mémoire ne risquait rien ! Quel était l'enjeu ? Quand on exige, quand on enjoint, il faut que l'autre ait peur de quelque chose ! De quoi avait peur ta mémoire, franchement ?
Apprécions la façon dont sa fille reprend le vocabulaire juridique de Me Susane. Le roman fourmille de subtilités de ce genre.
Résumons : pour son père, Gilles Principaux l'a violée, pour sa mère, ces gens se distinguaient par leur humanité, mais elle n'est pas sûr qu'il s'agisse des Principaux. Le tout forme un écheveau bien difficile à démêler, d'autant que l'intéressé, questionné maladroitement par l'avocate, semble ignorer de quoi il s'agit. Page 133 :
- Je ne vous comprends pas, je ne sais pas de quoi vous parlez, dit Principaux d'une voix épuisée. Ce qui compte là, c'est Marlyne, c'est ma femme. Pourquoi devrais-je me souvenir de vous ? Je ne comprends vraiment pas.
- Essayez quand même, faites un effort !
Me Susane, se sentant affreusement lâche, émit un petit rire, pour dénaturer et dépraver l'intense sérieux de son propos [belle formulation].
Face à Principaux, Me Susane est plus occupée par son histoire personnelle que par le dossier qu'est venu lui confier le mari de Marlyne.
A travers cette histoire, c'est tout le déni lié aux cas d'agression sexuelle qui est évoqué : difficulté à se souvenir, à établir des faits ; soupçons que fait peser l'entourage ; "zone grise" du consentement (car Me Susane se souvient de ce moment comme extraordinaire tant elle fut flattée de l'élévation sociale qu'il constituait) qui rend les choses complexes.
Sharon
Me Susane emploie chez elle notre deuxième femme puissante et impuissante, Sharon. Une migrante, sans papiers, que Me Susane a décidé d'aider, d'une part en la payant pour des taches ménagères dont elle ne ressent guère le besoin, d'autre part en prenant en charge les démarches pour qu'elle obtienne des papiers en règle. Mais Sharon n'y met pas du sien : elle botte en touche à chaque fois que Me Susane la relance sur ce certificat de mariage exigé par la Préfecture. Ce précieux sésame serait resté au pays, son frère refusant de l'envoyer parce que furieux que Sharon ait décidé de s'exiler en France. Ce sera à l'avocate de faire le déplacement à Port Louis. Ce n'est pas tout : Sharon, découvre Me Susane, va travailler chez d'autres pendant les heures que lui paie l'avocate. Et ces autres se comportent plutôt mal. Ce n'est toujours pas tout : Sharon oscille entre servilité, voire zèle lorsqu'elle confectionne à son employeuse des plats sophistiqués, et hostilité, lorsqu'elle décline froidement les propositions de Me Susane. Celle-ci voudrait être aimée de Sharon. La déception de ne pas y arriver altère le goût des mets délicieux de Sharon, ainsi que l'exprime très bien Marie Ndiaye page 20 :
[la veille encore...] Elle aurait avalé de l'amertume, de la tristesse, un plat de larmes, les siennes, honteuses et humiliantes, incapable alors de savourer les aliments que Sharon savait accommoder de façon exquise, trop bouleversée même pour se consoler en songeant que Sharon n'aurait pu cuisiner semblablement pour quelqu'un qu'elle haïssait - Sharon ne devait donc pas la haïr et Me Susane était sotte et sensible à l'excès.
Sharon, pourtant pauvre, va même jusqu'à acheter de la vaisselle précieuse. J'apprécie toujours le procédé faisant parler les objets, qu'utilise par exemple Nabokov dans Lolita. Ici page 84 : "Les assiettes la hélaient gentiment, lui demandaient poliment d'approcher". Cette vaisselle va même au-delà du standing de Me Susane qui a gardé, de son enfance en milieu populaire, des goûts simples :
Jamais Me Susane ne se serait offert une aussi belle vaisselle.
Elle n'aurait pas osé, par chasteté [j'aime le mot], et du reste n'y eût pas songé, de sorte qu'elle n'aurait renoncé à rien [j'aime l'idée].
Et voilà que les bols azurés, les assiettes iridescentes l'avisaient de leur esprit [belles allitérations].
Nous vivons quand vous nous regardez et nous touchez, alors contemplez-nous, appréciez-nous comme nous le méritons ! disaient à Me Susane les bols de Sharon.
Eveillez-vous, sortez-nous de la torpeur où nous plongent les regards ignorants ! clamaient mutuellement les bols.
Délicieux passage. Enfin, Sharon va nouer une relation intime avec la petite Lila. Qui est Lila ? La fille d'un ex de Me Susane, Rudy, fille qu'il a eu avec une autre, mais que Me Susane aime comme sa propre fille. Or Sharon va, en la gardant régulièrement, entrer en concurrence avec l'avocate.
Voilà ce qu'on peut nommer des relations ambigües, telles qu'en génère le passé colonial de la France, et plus encore cette ville de Bordeaux qui participa à la traite négrière et où, par parenthèses, Marie NDiaye a choisi de s’installer. Un autre écheveau sur les bras de notre héroïne. Me Susane se rebelle fréquemment contre le culot ou l'indolence de son employée, lui trouvant ensuite sans cesse des excuses qui la ramènent vers elle. Effet de la mauvaise conscience, accentuée par le job de Sharon qui résonne par rapport à la mère de Me Susane. Cette relation est faite de non-dits. Exemple page 16 :
Sharon, il n'est pas nécessaire d'allumer toutes les lumières de l'appartement, ne disait pas non plus Me Susane, car cette marque de respect à mon égard, cette sollicitude que vous pensez devoir témoigner à votre patronne qui rentre tard et fatiguée en éclairant de mille feux son apparition ne conviennent pas à mon esprit de frugalité, d'économie, de tempérance dans les menus actes de la vie quotidienne, non, Sharon, vraiment, n'allumez que les lampes indispensables à votre travail, ne lui dirait jamais, au grand jamais Me Susane.
Le procédé est savoureux. L'autrice le pousse parfois très loin, en imaginant ce qu'aurait répondu Sharon, ce qu'elle aurait alors dit ensuite, etc. Quant aux pensées de Me Susane, elles sont souvent transcrites en italiques, selon le fameux flux de conscience qui fit la célébrité de Virginia Woolf.
Dans le passage ci-dessus, on voit que Me Susane est fort occupée de l'image qu'elle offre à autrui dans la société, signe d'un évident manque de confiance en soi souvent caractéristique des transfuges de classe. Un autre exemple nous en est donné page 23 :
Me Susane ne détestait pas que ses amis l'imaginent ainsi : libre, folâtre, indépendante d'esprit - espérant en son for intérieur que de telles appréciations finiraient par la modeler, par la contraindre de s'y ajuster et qu'elle deviendrait réellement une femme au charme discrètement excentrique.
Marlyne
C'est la meurtrière, dont Me Susane va s'employer à élucider le geste. Troisième cas complexe : cette mère au foyer exemplaire a un jour cédé à une pulsion destructrice, en noyant ses trois enfants, Jason, John et la petite Julia, dans la baignoire familiale. Se mêlent dans sa psyché, entre autre, l'obligation qui lui fut faite de quitter son métier d'enseignante au profit d’une existence de fée du logis, et une relation à son mari faite d'attachement et de répulsion. Marlyne fut également empêchée dans ses projets de vie, impuissante à se libérer. Son geste reste malgré tout un mystère.
Gilles Principaux est tout aussi étrange dans sa réaction, défendant celle qui a commis cet acte monstrueux car il continue de l'aimer. Marie NDiaye trouve des mots très justes pour décrire ce que peut être une relation qui a pris de l'âge, notamment la question du désir, alors que, à la ménopause, Marlyne a pris du poids. Page 131 :
J'aimais le corps de ma femme quel qu'il soit car c'était son corps à elle, ma femme, et que j'aimais l'amour avec Marlyne, avec cette femme là précisément qui s'appelait Marlyne et dont le ventre avait abrité mes enfants. Je ne demandais pas à ce corps de Marlyne de me plaire davantage que le mien ne me plaisait. Je ne le regardais pas, cela ne m'intéressait pas. Mais quand nous nous enlacions, chacun ayant ôté son pyjama, tous les deux nus sous notre couette remontée jusqu'au cou, nous étions bien et qu'importait alors la forme ou l'aspect de nos chairs respectives. Nous étions bien car nous nous connaissions bien.
Et pourtant Gilles adorait ses enfants : sa réaction interpelle donc, dans la lignée de tout le roman qui interroge les motivations complexes des personnages.
Le mot de Marlyne c'est "mais" : oui j'aimais mon mari et mes enfants, mais... Celui de Gilles c'est "car" : ma femme a fait ça car... Marie Ndiaye choisit l'anaphore pour le dire, dans des logorrhées interminables, qui tranchent avec les paragraphes très courts qu'utilise l'écrivaine le reste du roman. Ceux-ci prennent alors tout leur sens : l'essentiel du roman, ce sont des faits courts juxtaposés, qui semblent se heurter comme autant de paradoxes. Parfois, la parole se libère et c'est le déferlement.
Dans la psyché de Me Susane, Marlyne, représente le passage à l'acte, le retour du refoulé. Les paroles empêchées de l'avocate, vis-à-vis de ses parents et de Sharon, se libèrent dans un accès de violence. C'est pourquoi la criminelle fascine et attire l'avocate. Ainsi, lorsqu'elle la rencontre au parloir, page 111 : "La Marlyne Principaux qui entra dans le parloir, Me Susane la scruta avec une telle acuité que, d'abord, elle ne la vit pas". Belle formule.
* * *
On le voit, on a affaire à un véritable objet littéraire, ce qui n'est pas majoritairement le lot de la production contemporaine. C'est véritablement écrit. Pour en apprécier le fond, il faut goûter l'ambigüité, l'indétermination, le mystère. Rien ne sera, en effet, résolu.
Sur la fin, le roman s'épuise un peu : la partie à Port Louis, chez le frère Ralph et sa femme Christine, m'a moins passionné. Un léger bémol à l'impression très positive que me laisse cet opus de Marie NDiaye.
Dans sa plaidoirie finale, expédiée en deux pages, Me Susane laisse transparaître les enjeux du roman. Elle charge Principaux, tout en prenant le soin de conclure par une fin ouverte :
Car que savons-nous de ce qui s'est passé dans cette maison (...) ? La maison sait tout et n'oublie rien. (...) Gilles Principaux exploite l'obscurité, il nourrit son obsession, travaille son plan : que Maryline soit environnée de solitude... Qu'il se retrouve être l'unique adulte dans l'entourage de Marlyne... (...) Elle doit être séquestrée mais cantonnée, recluse de son propre chef... (...) La maison avoue aujourd'hui... (...) elle avoue, la maison qui collabore aux crimes, elle avoue et dit : J'ai été le suppôt de cet homme-là... Qui est-il donc ? Nous croyons le savoir à présent, nous nous disons cependant : et si je me trompais ?