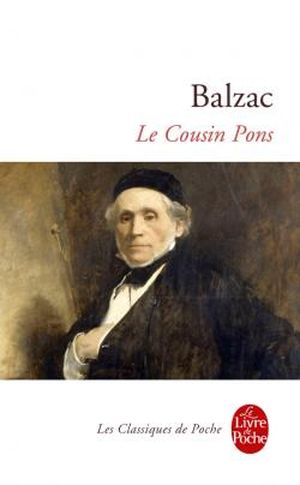Le Cousin Pons répond à La Cousine Bette. Au roman de la vieille fille qui répand le mal autour d’elle succède le roman du vieux garçon dont la bonté foncière (1) semble aimanter les haines : les mécanismes des deux romans ne sont pas exactement symétriques. Et est-ce parce que la bonhomie du personnage est communicative, toujours est-il que Le Cousin Pons m’a paru beaucoup plus alerte, plus enlevé, et pour tout dire plus réussi que son pendant.
Le personnage, quoique le narrateur lui donne « la valeur d’une croche antédiluvienne » (p. 489) me semble aussi beaucoup plus riche, narrativement parlant : Bette a cet aspect systématique, caricatural, qui la transforme en machine – « la Bette », l’appelait parfois le narrateur, autre façon de la déshumaniser. Au contraire, Sylvain – oui, c’est le prénom de Pons –, est foncièrement, désespérément, mollement mais typiquement humain. Ainsi, au début du roman, de nombreuses pages sont consacrées aux deux passions du bonhomme (2). L’une d’elles, la manie de la collection, aura de l’importance dans la suite, mais l’autre ne tiendra aucune place dans l’intrigue : la gourmandise de Pons, à mon sens, n’a d’autre fonction que de l’humaniser, de l’identifier au lecteur, de le rendre attachant. Peut-être ridicule, car non dépourvu d’une forme de médiocrité, mais attachant : bref, humain.
Flaubert ne s’y prendra pas autrement, plus férocement mais pas autrement dans la démarche, quand dans Un cœur simple sa Félicité s’entichera d’un perroquet. Et pendant qu’on est avec Flaubert, on est tout à fait en droit de voir dans le duo formé par Pons et Schmucke, « ces deux âmes fraîches, enfantines et pures » (p. 501) un embryon de Bouvard et Pécuchet. Le Cousin Pons compte de fort belles pages sur l’amitié, on peut fort bien lire Bouvard et Pécuchet comme un roman d’amitié.
Autre trait qui pourrait expliquer, peut-être paradoxalement, la légèreté de ce roman : Balzac y est régulièrement méchant. « Cette Allemande aimait les différents vinaigres que les Allemands appellent communément vins du Rhin. Elle aimait les articles-Paris. Elle aimait à monter à cheval. Elle aimait la parure. Enfin la seule chose coûteuse qu’elle n’aimât pas, c’était les femmes » (p. 534) : voilà qui ne met en valeur ni l’Allemagne, ni les femmes – et qui rabat par ailleurs le caquet à quiconque nie à Balzac tout style. L’éditeur du roman en « Pléiade » lie ceci au « pessimisme profond qui envahit l’imagination et la vie affective de Balzac dans les dernières années de son existence » (p. 455), tout cela relevant du « fantasme de la mauvaise mère (p. 467) qui parcourt La Comédie humaine. De fait, on pourrait dire que la dernière œuvre majeure publiée par Balzac avant sa mort a été pour lui l’occasion de se lâcher, si cela n’impliquait pas d’oublier qu’il n’avait jamais fait preuve d’une véritable retenue auparavant.
Remarquons tout de même que dans Le Cousin Pons, Pons n’est que la victime principale : victime de la calomnie d’une femme puis de plusieurs, victime de la cupidité d’une femme. Il y a un autre mort : un homme, mort empoisonné par une femme. Il y a une troisième victime, certes un peu différente : Schmucke, le bon Allemand, « le fils, le frère, le père du défunt […] dout cela, et plis… […] son ami ! » (p. 731), celui qui finira en enfant entouré d’enfants, victime de sa propre inadaptation à une société dans laquelle les morts sont des ressources. Et l’on pense à ce cortège final d’embaumeurs, d’entrepreneurs de pompes funèbres, de sculpteurs, de prêtres, etc., cortège qui serait simplement une variation comique sur le thème des créanciers de don Juan, ou une illustration du motif de la conspiration du Mal (3) qu’on trouve çà et là dans La Comédie humaine, s’il n’avait pas quelque chose d’intemporel. C’est presque une danse macabre.
Parce qu’il faut bien le dire aussi, malgré la légèreté dont je parlais en ouverture, Le Cousin Pons propose aussi une méditation sur l’art – création artistique chez Schmucke, réception de l’œuvre chez Pons – et sur la mort. « C’est là la poésie de la Mort. Mais, chose étrange et digne de remarque ! on meurt de deux façons différentes. Cette poésie de la prophétie, ce don de bien voir, soit en avant, soit en arrière, n’appartient qu’aux mourants dont la chair seulement est atteinte, qui périssent par la destruction des organes de la vie charnelle. Ainsi les êtres attaqués, comme Louis XIV, par la gangrène ; les poitrinaires, les malades qui périssent comme Pons par la fièvre, comme Mme de Mortsauf par l’estomac, ou comme les soldats par des blessures qui les saisissent en pleine vie, ceux-là jouissent de cette lucidité sublime, et font des morts surprenantes, admirables ; tandis que les gens qui meurent par des maladies pour ainsi dire intelligentielles, dont le mal est dans le cerveau, dans l’appareil nerveux qui sert d’intermédiaire au corps pour fournir le combustible de la pensée ; ceux-là meurent tout entiers. Chez eux, l’esprit et le corps sombrent à la fois. Les uns, âmes sans corps, réalisent les spectres bibliques ; les autres sont des cadavres » (p. 696) : en peinture, ce passage serait une vanité, d’autant plus marquante que le peintre fera un cadavre, non un spectre.
Le Cousin Pons propose par ailleurs quatre remarquables derniers mots.
P.S. : Le titre de cette critique vient d’un mot de Gaudissart à Mme Camusot de Marville : « C’est naïf, c’est allemand, c’est à empailler, à mettre sous verre comme un petit Jésus de cire !… » (p. 761).
(1) Cette bonté rapprocherait Pons du Mychkine de Dostoïevski, avec certes moins d’envergure. Du reste, il a « quelque chose au foie », comme le narrateur des Carnets du sous-sol. Pour rappel, Dostoïevski a traduit Balzac. A-t-il lu Le Cousin Pons ?
(2) Ces deux passions entrent aussi dans le cadre d’une réflexion plus large de Balzac sur l’énergie et sa dissipation. Je n’y reviens pas ici.
(3) Il y a (p. 664) une scène au cours de laquelle Fraisier, avocat malhonnête, répond à voix haute à une pensée de son interlocutrice : « Si cela est, se dit à elle-même la présidente […] / “Non, madame, car sans cette rupture », etc. On peut lire cela comme une inadvertance de Balzac. On peut aussi, ce qui n’est pas incompatible, y voir une illustration plus fantastique que réaliste de ce thème de la coalition des médiocres qui court lui aussi dans La Comédie humaine.