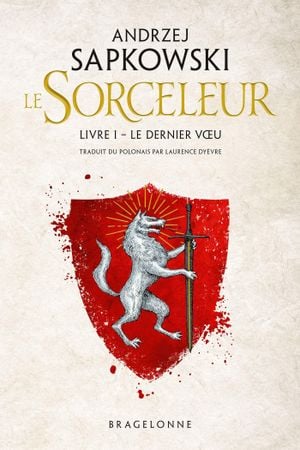Avec Le Dernier Vœu, premier recueil de nouvelles consacré au sorceleur Geralt de Riv, Andrzej Sapkowski inaugure l’une des œuvres les plus marquantes de la fantasy moderne. Loin des codes anglo-saxons de l’heroic fantasy traditionnelle, ce texte hybride, profondément européen, propose une réécriture savante du conte, un questionnement sur la nature du héros et un art de la narration qui place la parole au cœur du mythe. Dans ces récits, l’imaginaire cesse d’être une simple échappatoire ; il devient un instrument de lucidité, un miroir ironique tendu au réel.
Dès les premières pages, le ton se distingue radicalement des canons du genre. Sapkowski ne cherche ni la démesure épique ni l’émerveillement naïf. Son univers, rude et charnel, s’enracine dans la fange des villages, les intrigues des cours, la brutalité des marchés et la poussière des routes. Le Dernier Vœu n’a rien d’une épopée chevaleresque : c’est une série de contes revisités, tissés d’une érudition ironique et d’une noirceur teintée de compassion. Le surnaturel y est traité non comme un prétexte à l’évasion, mais comme une extension poétique du réel. Chaque monstre, chaque malédiction, chaque sortilège devient une métaphore de la nature humaine, de ses pulsions, de ses ambiguïtés et de ses contradictions.
Geralt de Riv, figure centrale et déjà mythique, se tient à la lisière de l’humain et du monstre, entre l’ordre et le chaos. Mutant façonné pour tuer les créatures qui menacent le monde, il incarne la figure du héros tragique par excellence : conscient de son altérité, fidèle à un code moral qu’il sait pourtant sans valeur dans un monde corrompu. Sapkowski déjoue ici la figure classique du sauveur. Geralt n’agit pas au nom d’un idéal supérieur, mais par nécessité, par loyauté personnelle ou parfois par simple résignation. Sa neutralité revendiquée, ce refus d’intervenir politiquement dans un univers où tout est politique, devient l’une des ironies majeures du recueil : c’est précisément cette volonté de retrait qui l’entraîne sans cesse dans les dilemmes les plus vertigineux.
Le dispositif narratif du recueil participe de cette complexité. Le Dernier Vœu n’est pas un assemblage de nouvelles isolées mais une construction subtilement circulaire où les récits enchâssés se répondent et se complètent. Le chapitre-cadre, dans lequel Geralt se remet de ses blessures dans un temple dédié à la déesse Melitele, crée un fil rouge où chaque récit surgit comme une réminiscence, une confession ou un souvenir fragmenté. Ce tissage donne au texte une cohérence interne rare et une tonalité méditative. Sapkowski y déploie un art du rythme et de la structure qui relève presque du théâtre : la voix, la mémoire et la parole constituent les véritables leviers de la narration.
Chacune des nouvelles revisite un mythe ou un conte fondateur. Le Sorceleur reprend les motifs de la Belle et la Bête, Un grain de vérité renverse la symbolique de la malédiction et de la monstruosité, Le moindre mal pose la question du libre arbitre à travers une variation sur Blanche-Neige, Une question de prix explore la fatalité du mariage royal, Les limites du possible confronte le héros à l’absurdité du destin, tandis que la nouvelle éponyme, Le Dernier Vœu, scelle la rencontre fondatrice entre Geralt et Yennefer, pivot de tout le cycle à venir. Dans chacune de ces variations, Sapkowski emprunte aux archétypes pour mieux les subvertir. Le merveilleux devient dialectique : les monstres ne sont plus des figures du mal absolu mais des métaphores de la condition humaine.
La réussite majeure du recueil tient à la richesse de son écriture. Sapkowski conjugue un humour narquois à une sensibilité poétique d’une grande finesse. Sa prose, à la fois dense et vive, marie le trivial et l’érudit, le grotesque et le sublime dans une tension constante. La traduction française, selon l’édition consultée, réussit pour sa part à restituer cette musicalité changeante : une langue à la fois archaïsante et moderne, nourrie de réminiscences bibliques, de proverbes paysans et d’élans lyriques. Sapkowski manie la rupture de ton avec une virtuosité qui rappelle Cervantès ou Rabelais : derrière chaque éclat de rire affleure une amertume, derrière chaque geste héroïque une dérision lucide.
Le rapport au sacré, omniprésent, confère au texte une dimension métaphysique. Le monde du sorceleur est un univers désacralisé où les dieux se sont tus et où la magie, jadis divine, s’est réduite à une technique. Et pourtant, partout, perce une nostalgie du sens, une quête d’un absolu disparu. Geralt, malgré son cynisme, agit comme un dernier témoin d’un ordre moral en voie d’extinction. En cela, il est à la fois héritier des chevaliers médiévaux et figure pré-nietzschéenne : un homme sans transcendance mais fidèle à l’idée du bien, fût-elle illusoire.
Sur le plan symbolique, Le Dernier Vœu s’impose comme une méditation sur la parole et le lien. Le vœu n’est pas seulement promesse ou contrainte magique ; il est acte de langage créateur, performatif. En prononçant son dernier souhait, vœu qui lie son destin à celui de Yennefer, Geralt scelle le passage du mythe à la légende, du héros solitaire à l’homme engagé dans une relation qui dépasse la volonté. Cette scène d’une puissance rare condense tout l’esprit du livre : la magie véritable n’est pas dans le sortilège mais dans le mot, dans l’engagement du sujet à travers la parole.
Ce que Sapkowski accomplit avec Le Dernier Vœu dépasse la simple réussite narrative. Il y instaure une nouvelle éthique du récit de fantasy. Loin des batailles titanesques et des prophéties manichéennes, il propose une fantasy morale, ironique, profondément européenne, où l’ambiguïté devient la norme et la sagesse se niche dans la lucidité. Ses personnages ne sont pas des symboles figés mais des consciences en devenir, traversées de doutes et de contradictions.
Enfin, il faut souligner la portée culturelle de l’œuvre. Par son ancrage dans la tradition slave et par son refus des modèles anglo-américains, Sapkowski redonne à la fantasy une saveur régionale, presque ethnographique. Ses récits évoquent la rugosité des ballades polonaises, la sagesse populaire, la méfiance paysanne envers le pouvoir et la religion. Dans ce monde où la corruption politique rivalise avec la superstition, la figure du sorceleur prend une valeur universelle : celle de l’homme juste dans un univers injuste, du sceptique intègre au milieu des croyants fanatiques.
Le Dernier Vœu est donc bien plus qu’une introduction à la saga du Sorceleur. C’est un manifeste littéraire, une œuvre de transition entre le conte et le roman, entre le mythe et le réalisme, entre l’héroïsme et le désenchantement. À travers Geralt, Sapkowski réinvente la figure du héros non comme porteur d’espérance mais comme gardien du doute. Son monde est celui d’un crépuscule, mais un crépuscule habité, vibrant, traversé par la lumière fragile de l’ironie et du désir.
Points forts
- Une réécriture magistrale des mythes fondateurs du conte européen
- Une écriture ironique et poétique, alliant trivialité et profondeur
- Un héros d’une complexité morale rare, entre lucidité et compassion
- Un univers profondément ancré dans la culture slave, crédible et vivant
- Une réflexion métaphysique sur la parole, la foi et la condition humaine
Conclusion
Avec Le Dernier Vœu, Andrzej Sapkowski ne se contente pas de créer un univers : il redonne à la fantasy sa vocation première, celle de penser le monde à travers la fiction. Là où tant d’auteurs se perdent dans la démesure et la surenchère, lui choisit la mesure, l’ironie et la conscience. De cette tension naît une œuvre rare, à la fois érudite et populaire, tragique et drôle, violente et tendre. Le premier vœu du lecteur, une fois refermé le livre, sera d’y revenir, car peu de récits dans la fantasy contemporaine parviennent à dire avec une telle justesse la fragilité de l’humain au cœur du mythe.