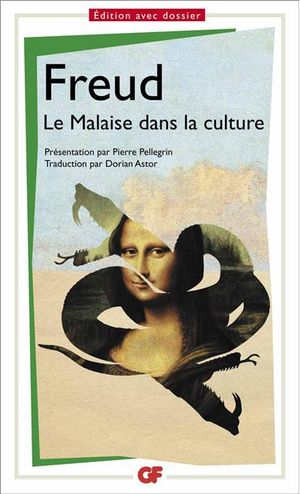Pour moi, lire Freud est toujours difficile. Je suis en effet toujours coincé entre ses thèses séduisantes - l'inconscient, la psychanalyse, les pulsions, etc. - et une méthode des plus douteuses - rien de quantifiable, de l'observation, pas d'expérimentation possible, etc. Ce constat était déjà présent dans Introduction à la psychanalyse qui balançait des conclusions avec un ton péremptoire sans jamais vraiment pouvoir démontrer quoi que ce soit en présentant des méthodes qui n'avaient pour fondement que les conclusions qu'elles apportaient. Psychopathologies de la vie quotidienne n'avait d'ailleurs que cela pour but : noyer le lecteur sous un flot ininterrompu d'exemples de tocs, de troubles, de névroses, de lapsus... pour l'amener sans résistance possible à l'induction selon laquelle, si Freud est capable de saisir tout cela, c'est parce que sa méthode est la bonne. L'avenir d'une illusion, enfin, se donnait pour tâche d'interpréter le phénomène religieux à l'aune de cette pensée psychanalytique.
On le voit donc, et c'est tout là la beauté et la fragilité du travail de Freud : sa thèse séduit par l'interprétation qu'elle donne de résultats qui n'ont d'abord de sens et de réalité que pour sa thèse. Freud vise juste, mais c'est d'abord parce qu'il est le seul à être tout à fait certain qu'il y a une cible à cet endroit.
Le malaise dans la culture n'est pas exempt de ce reproche. On ne peut être que séduit par cette interprétation de l'existence de la violence sous-jacente de notre civilisation. La délinquance, la criminalité, les incivilités, les guerres, persistent dans le temps malgré le développement de la science, de l'éducation et de la civilité. Et si cela était dû à la fois à la nature même de notre psychisme, et à celle du concept même de civilité ? Et si l'élaboration de l'autorité, de l'éducation et des règles n'avait pas pour effet de développer un sur-moi qui n'aurait que pour unique tâche de contraindre nos pulsions qui finiraient par se réaliser dans une violence secondaire, sublimée, et donc sociale. Ainsi, le garant même de la paix serait la condition même de la violence.
On le voit : c'est fort, c'est séduisant, et, comme toujours, c'est même profondément attractif. Il y a un côté magnétique devant cette explication sombre, reposant sur l'inaccessibilité même de notre inconscient. Et c'est bien cela d'ailleurs, qui, tel un aimant, attire autant qu'il repousse. Car comment le prouver ? Comment le démontrer ? Comment démontrer ce qui par nature échappe à l'expérimentation quantifiable ?
En partant de l'état de nature ? Hobbes et Rousseau le font, et arrivent à des conclusions opposées. L'état de nature ne prouve rien.
En partant de l'effectivité de la violence ? Elle est factuelle, et ne prouve en rien par elle-même son origine psychique.
En partant de la difficulté humaine à côtoyer son prochain ? Hobbes, Rousseau, Kant, Schopenhauer en ont tous parlé en en donnant des raisons différentes.
Freud reste coincé, et ne peut que signer une sorte de pétition de principe, partant du principe que sa thèse est juste, ce qui lui permet d'expliquer les phénomènes de violence et au passage de justifier sa thèse de départ qui devait l'être.
Je ne peux que saluer son génie. Mais je ne peux réprimer une légère et constante réticence en le lisant.
Il faudrait peut-être que je consulte face à une attitude si bivalente.