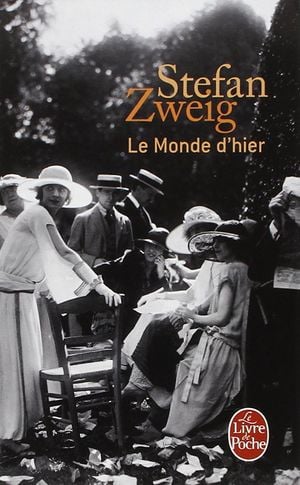« Ainsi chacun d’entre nous, même le plus humble de notre génération, en sait aujourd’hui mille fois plus sur les réalités de l’existence que le plus sage de nos aïeux. Mais rien ne nous a été donné gratuitement. Ce que nous avons acquis, nous en avons payé le prix entier dans la monnaie qui a cours aujourd’hui. » (I, Le monde de la sécurité)
C’est peut-être un lieu commun de le dire, mais la force du Monde d’hier est avant tout sa modernité, sa résonnance si frappante, et peut-être dérangeante, avec notre monde d’aujourd’hui ; au-delà, c’est surtout un récit plein d’entrain autant que de nostalgie, mais qui refuse la passivité. Ces Souvenirs d’un Européen sont aussi un manifeste.
Écrite alors que Zweig se trouve au Brésil, dépossédé de tout ce qui a pu compter dans sa vie, cette chronique de la disparition d’un monde, à comprendre comme unité temporelle, géographique, culturelle, et spirituelle trouve dans le nôtre des échos troublants. Parce qu’il s’emploie, dans les premiers chapitres, à ne pas nommer le nazisme et la Seconde Guerre mondiale, mais simplement à faire planer « cette sombre silhouette dans bien des pages de ce livre » (XVI, L’agonie de la paix), libre au lecteur d’investir certaines remarques d’une nouvelle signification, à l’aune d’une nouvelle destruction, climatique, ou des menaces politiques et militaires grandissantes.
Oui, Le Monde d’hier est un message envoyé sans destinataire précis, et que pourtant le lecteur moderne se retrouve à lire comme s’il lui avait été destiné (précisément). Comme une invitation à ne pas commettre encore les mêmes erreurs, à manquer de voir les signes évidents, à ne pas voir « les signes de feu inscrits sur le mur […] sans jeter vers l’avenir des regards anxieux » (II, L’école au siècle passé). Et le tour de force de Zweig est de ne pas faire de son livre une leçon didactique expliquant que le nazisme, que la haine ou l’intolérance sont mal : certes parfois des remarques théorisent une réflexion sur ce qui est mauvais, mais c’est bien plutôt l’amertume qui point en filigrane dans ces lignes qui nous émeut à la lecture, lecture guidée par le sentiment si terrible d’une ironie tragique. On lit Le Monde d’hier comme on va voir Œdipe Roi : on a beau connaître la fin, on aimerait que les personnages y échappent. Zweig en joue, bien sûr, à plusieurs reprises, comme lorsqu’il va rendre une visite à Gorki en exil, et qu’il devise avec lui de cette condition d’exilé qu’il pense ne jamais devoir connaître ; lorsqu’il apprend qu’Adolf Hitler est son voisin et que de sa maison à Salzburg il peut voir celle de celui qui n’est encore personne ; à l’insu de l’écrivain, lorsqu’il salue la démocratie brésilienne et la considère à l’abri des aberrations dictatoriales de l’Europe ; ou alors, quand, à la fin du chapitre XIV, Soleil couchant, il formule le souhait de recommencer sa vie à zéro. Sans jamais sombrer dans le pathos, c’est la description clinique, désabusée et sans amour d’un monde que pourtant il a aimé qui est sans doute le plus déchirant. Ce sont ces constats, sobres et amers :
« Mais refuser à une vieille femme ou à un vieillard épuisé de reprendre haleine quelques minutes sur un banc, cela était réservé au XXe siècle et à l’homme que des millions de gens adorent comme le plus grand de ce temps. » (XVI)
Ce sentiment de tragédie réelle est renforcé par la construction par Zweig du Monde réel. Les seize chapitres du récit sont organisés en véritable pyramide symétrique : les huit premiers chapitres construisent le monde d’hier, l’« enfance de l’Europe » (VIII, Les rayons et les ombres sur l’Europe), la jeunesse et les débuts heureux de l’auteur, dans un mouvement d’ascension continu que vient interrompre le chapitre IX, Les premiers jours de la guerre de 1914, à l’exact milieu du livre (page 254 sur 506). Au récit de la guerre (quatre chapitres) succèdent deux chapitres de retour inquiet à une forme de normalité factice, et qui s’effondre dans les deux derniers, « Incipit Hitler » et L’agonie de la paix. Ce dernier titre souligne d’ailleurs fort justement la dimension agonisante d’une Europe qui a grandi très vite, trop vite, au point en fait d’agoniser de son propre suicide.
Mais Le Monde d’hier est d’abord un livre extrêmement agréable, qu’on lit presque sans s’en rendre compte tant la narration (et l’excellente traduction de Serge Niémetz – Livre de Poche) est fluide, légère, reflet de l’art de la conversation et de la langue : il n’y a nullement besoin de recourir à des effets de manche pour obtenir une fausse authenticité, on sent dans toutes les anecdotes que raconte Zweig qu’il dit vrai. C’est un livre vraiment drôle par moments, qui sait l’être et sait qu’il l’est, parce que c’est aussi un moyen de rappeler la légèreté perdue du monde d’hier. On s’amuse, on rit parfois, des histoires de voleurs parisiens, ou encore de la malédiction qui semble planer sur les acteurs des pièces de Zweig. On saisit la finesse de l’emploi du discours indirect libre : c’est quand il s’efface le plus que l’on voit le mieux la distance entre le narrateur et les propos tenus dans la narration. Le livre se fait véritablement une chronique, des souvenirs faussement disparates et joyeusement ordonnés.
Ces « souvenirs d’un Européen », comme le met en relief le sous-titre, on les apprécie aussi justement pour cette européanité au centre du récit. C’est elle, bien plus que la vie de Zweig en elle-même, qui n’apparaît que pour servir un propos (rien sur sa vie amoureuse, sur sa femme, sur sa famille, sinon pour une illustration), qui intéresse le lecteur. Et d’ailleurs, l’auteur lui-même dans la préface signale qu’il n’est pas le « personnage principal » du Monde d’hier mais qu’il en est le « centre ». Un centre à partir duquel c’est une idée cosmopolite et tolérante de l’Europe qui va se construire, une ouverture idéaliste qu’il serait trop simple de railler et qui réalise pleinement le rêve anthropologique kantien de la Weltbürgerschaft, la citoyenneté du monde. Et l’art de l’auteur est de postuler sans jamais, pour le coup, la thématiser, cette existence de citoyen européen qui n’est ni le Juif errant ni l’apatride, qui a ses racines (en l’occurrence autrichiennes) mais sait passer l’épreuve de l’étranger et en cela accomplir pleinement le modèle germanique traditionnel de la Bildung : ce sont les « détours sur le chemin qui me ramène à moi » qui donnent leur titre au chapitre VI. De là toute l’érudition extrêmement plaisante déployée par l’auteur : de citations en passant en références concrètes, c’est tout l’imaginaire occidental qui est remotivé, l’héritage grécoromain comme judéo-chrétien, ce dernier nourrissant d’ailleurs une très belle réflexion sur une judéité, que jamais il ne cache ni n’exhibe, mais qu’il interroge et dont il parle avec une grande intelligence et une finesse immense.
L’amour que porte Zweig à la culture et sa croyance en un humanisme européen, érasmien en fait (Érasme étant un modèle qu’il convoque à de nombreuses reprises) le conduit à un apolitisme qu’il professe comme doctrine. Il assume en effet une mise à distance complète de la politique, mise à distance parfois méfiante, d’ailleurs :
« Même chez les hommes auxquels on pouvait se fier, je m’ennuyais de la stérilité des éternelles discussions et de les voir opiniâtrement divisés en groupe radicaux, libéraux, anarchistes, bolchévistes et sans parti. Pour la première fois j’appris à bien observer le type éternel du révolutionnaire professionnel qui, par son attitude de pure opposition, se sent grandi dans son insignifiance, et se cramponne aux dogmes parce qu’il ne trouve aucun point d’appui en lui-même. Rester dans cette confusion bavarde, c’était s’embrouiller, cultiver des camaraderies peu sûres et compromettre la sécurité morale de ses propres convictions. Je me retirai donc. » (XI, Au cœur de l’Europe)
Reste que ce refus jusqu’au-boutiste de la prise de position de la part des intellectuels est aussi en partie responsable de la situation de l’Europe que déplore Zweig : et n’avoir « jamais exercé son droit de vote », ce qu’il dit avoir été son cas, aussi.
Du reste, l’auteur en est bien conscient, et regrette sans concession une position dont il a d’ailleurs fini par se départir en menant, sans qu’il ne s’en vante le moins du monde, une action politique de « lanceur d’alerte » (dirait-on aujourd’hui), dès les années 1930, et qu’il a subi de plein fouet l’inexorable montée du nazisme, la lâcheté des démocraties européennes, l’exil.
À cet égard, le tableau qu’il fait de sa découverte des chemises noires sur la place Saint-Marc en 1920 est saisissant d’effroi, parce que l’on pressent avec le narrateur ce qu’elles contiennent en puissance et parce que l’on sait avec l’auteur ce qu’elles ont libéré sur l’Italie. Ainsi l’aspect politique du récit n’est-il renié qu’en demi-teinte, et ce sont bien les partis et les querelles conjoncturelles que Zweig rejette, plutôt que les « convictions » et l’action, culturelle dans son cas.
C’est d’ailleurs souvent par des tableaux, qui sonnent comme autant de fables, de paraboles, d’exempla que Zweig fait avancer son livre. Des petits récits dynamiques, mais qui contiennent une forme de moralité ou qui trouvent leur justification au regard plus surplombant de la structure générale. Ainsi en est-il, par exemple, de la réflexion sur la prostitution dans le chapitre III, « Eros matutinus », mais aussi et surtout des nombreux portraits qui émaillent le récit. C’est là que Zweig, à mon avis, est le meilleur, par toutes ces petites biographies résumées en quelques paragraphes : le portrait de Verhaeren, le portrait de Rodin, celui d’Ensor ou de Masereel, qui consacrent la puissance de l’art, auquel il n’était pas tout à fait ridicule de croire. C’est lorsqu’il parle de ces hommes, de ces « héros de l’esprit » (à propos de Freud), comme Hofmannsthal, Romain Rolland ou Gorki, que Zweig est le plus témoin, qu’il est le plus touchant. À propos de Rodin dans son atelier, voici ce qu’il écrit :
« Durant cette heure, j’avais vu à découvert le secret éternel de tout grand art et même, à vrai dire, de toute production humaine : la concentration, le rassemblement de toutes les forces, de tous les sens, la faculté de s’abstraire de soi-même, de s’abstraire du monde, qui est le propre de tous les artistes. J’avais appris quelque chose pour la vie. » (V, Paris, la ville de l’éternelle jeunesse)
Cette conception d’un travail à la fois patient, intelligent et mesuré irrigue toute l’œuvre. Cette mesure, qui reconnaît ses échecs comme ses succès sans se taire ou s’humilier au sujet des premiers, sans s’enorgueillir ou jouer les faux modestes pour les seconds, fait de notre lecture un véritable bonheur. La facilité avec laquelle la réussite vint à Zweig le déconcerte, des dizaines d’années après, toujours autant que le lecteur, qui clôt le livre avec l’envie d’en faire autant : c’est l’émulation dans sa plus pure visée humaniste.
Cette émulation se trouve d’autant plus renforcée par la croyance que l’auteur semble placer dans la jeunesse, cette jeunesse plus au fait des réalités du monde que ses parents. Évoquant le Bonaparte de Balzac et des écrivains français, Zweig écrit qu’il incarnait dans ces romans « la victoire de l’idée de jeunesse » (II) : c’est exactement cela. Et c’est à cette jeunesse que revient, à la fin, la chronique si juste de Zweig. Peu importe la lecture que l’on peut faire aujourd’hui des considérations pessimistes de l’auteur : guerre, fascisation, catastrophe climatique, il faut agir, et peu importe si cela a déjà été dit mille fois.
Zweig nous avertit de la facilité avec laquelle un monde disparaît. À nous de l’entendre.