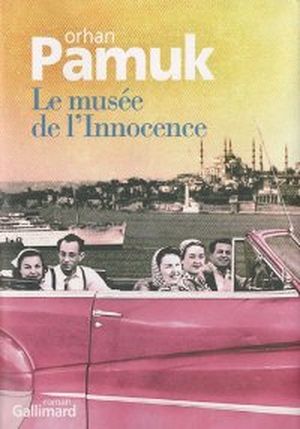Orhan Pamuk est un véritable amoureux de son pays, pas de surprise à ce sujet.
Plus que ça, l’écrivain aime tellement son nid d’enfance, ses coutumes, ses manières, ses paysages, ses rues, ses pancartes, ses immeubles, ses fêtes, sa bourgeoisie et sa pauvreté, sa misère et sa gloire, son histoire et sa politique, sa culture et sa langue, qu’il a voulu exposer des bout de son pas et de ses souvenirs au monde, artistiquement comme concrètement.
La poétique de l’objet
Il est important de commencer avec cette alliance farfelue et originale que Pamuk entreprend entre le roman et le musée. Déjà, je n’aimerais pas tomber dans les critiques faciles : le livre ne se suffit pas à lui-même, le concept est plus grand que la technique, le romanesque ne tient que sur les artifices stylistiques, ou bien d’autres défauts, qui d’ailleurs, me sont venus à l’esprit pendant la lecture. Personne n’est parfait.
Il s’agirait d’accepter une oeuvre pour ce qu’elle a à offrir, et en l’occurrence, elle offre quelque chose de plus qu’elle-même. J’apprécie la générosité, mais maintenant, je voudrais bien un billet d’avion, car ce livre est un véritable objet marketing pour ce musée situé à Istanbul.
La dualité roman-musée est remarquablement présente, puisque tout au long du récit, et dans presque chaque chapitre, reposent un ou des objets qui portent l’odeur de l’évènement en cours : son sens et son déroulé.
Comment ne pas ressentir l’ambiance de la scène d’amour sensuel en observant la boucle d’oreille de Füsun ? Comment ne pas entendre sa tombée par terre ? Comment ne pas revivre l'obsession insatiable de Kamel à la vue de toutes ces cuillères, ces fourchettes, ces tasses et ces mouchoirs ramassés après que sa bien aimée les ait touchés ? Comment ne pas se sentir inviter face à la carte de mariage de Sibel et Kamel ? Comment ne pas éprouver dans sa chair, toutes les émotions et les espoirs d’une histoire d’amour vouée à l’échec quand au milieu de leur chambre, nous sommes en face du lit, de la table de chevet et de la fenêtre au rideau blanc et fin ?
Il vous appartient alors de ressentir ces choses là. Pour ma part, Pamuk a réussi à me convaincre que les objets donnent une dimension supplémentaire à l’émotion qu’il voulait transmettre à travers ce livre : une dimension plus tangible.
Le je-ne-sais-quoi d'intellectuel
Il est vrai que de la vraie littérature, ça se remarque, ça se sent, ça se donne des airs ostentatoirement cérébraux. Le roman réfléchi sur le roman, il est son propre object de réflection, c’est vite plié. Alors Pamuk ne fait pas dans la dentelle pour ce qui est de ses intentions, il les dénonce clairement et rapidement : l’auteur est un personnage secondaire du roman, qui devient d’ailleurs à la fin un personnage principal ; le narrateur est permutable, il est un personnage puis l'auteur lui-même ; le narrateur ne se préoccupe pas du quatrième mur, il parle directement au lecteur, comme un guide de musée ou un guide du récit. Ces intentions littéraires sont grossières, écrites en gras, mais tellement osées que cette ostentation devient en elle-même un courage et un style rare. Un style littéraire qui se camoufle, je trouve, derrière une volonté de faire genre intellectuel. Parfois, je sentais qu’il y avait trop d’idées à traiter à la fois et le lecteur (du coup moi et ma mauvaise fois) se retrouve enseveli par un trop plein de données littéraires à prendre en compte, qui ne laissent pas de place à l’histoire.
Les coquilles vides que sont ces personnages
Il semble que l’auteur apprécie tellement les objects qu’il transforme ses personnages en objets, car autre que Kamel et (étonnamment) Sibel, les personnages sont vides de caractère et de volonté. Pauvres personnages secondaires érigés en simples observateurs. Que ce soient les parents et le mari de Füsun, les parents et les amis de Kamel, ses connaissances, etc. Tous y passent, à la trappe des personnages vides. Même sa chère Füsun, qui devrait être au centre de son histoire. Mais non. Celui qui est le plus complexe et construit dans cette histoire d’amour et d’obsession, c’est l’homme, oh que ça me surprend dis donc… Ceci dit, l’amour et l’obsession de Kamel est très bien décrite, à travers sa jalousie et son égoïsme comme à travers sa gentillesse et sa générosité. L’homme est un être complexe, la femme est un être joli.
Même Sibel, qui est pourtant celle qui empêche d’abord au couple de s’inscrire dans la durée (en plus du poids des normes sociales), est développée, certes pas sans clichés, mais avec une couche de complexité appartient aux femmes qui portent sur leur dos une misogynie millénaire, qui l’ont appropriée et intégrée dans une compétition malsaine entre elles. Cette Sibel est un personnage très intéressant et aurait le mérite d’avoir à elle seule une histoire à part entière.
Bien sûr une autre histoire et un autre contexte.
Cette femme est caractérisée par l’hypocrisie : elle a perdu sa virginité, mais parle de toutes les autres femmes qui l’ont perdu, elle est à la fois européenne et turque, à la fois assez courageuse pour aimer mais trop peureuse pour l’assumer pleinement. Tout à fait représentant le mélange des valeurs européennes et turques que veut dépeindre Pamuk.
Sans parler des autres personnages, focalisons nous sur Füsun, parce que mes doigts se fatiguent à cette heure.
La coquille vide.
Une belle coquille vide selon Kamel. Car quel autre qualificatif prendre, si rien n’est mis en évidence d’autre que les lèvres, le cou, la poitrine, les tétons, le ventre, les cuisses de sa chère Füsun ? Rien, puisque Füsun n’est rien qu’une figure et n’a rien d’humain. Elle est jolie et naturelle, elle n’est pas comme les autres qui veulent resembler aux européennes.
En revanche et après tout ce bavardage que j’apprécie beaucoup car il est écrit par moi (j’ai une grande affection pour moi meme), j’aime bien cet auteur qui aime bien son pays, franchement. Et ça fait du bien.
Un roman qui fait voyager dans les recoins banals d’Istanbul et les méandres terribles de l’amour.
Je le recommande aux âmes les plus heureuses.