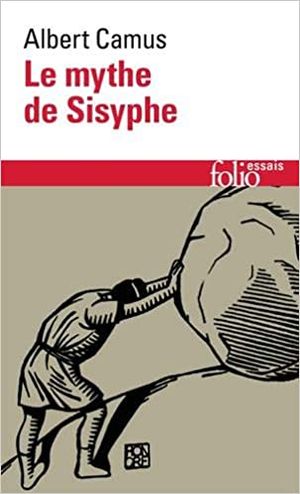Il y a bien des choses à dire de ce court essai de Camus mais je m’efforcerai de faire simple. Dans l’imaginaire collectif et, je pense, du fait de sa mort prématurée, Camus a cette aura presque indiscutée d’écrivain/philosophe accompli. Il maniait les mots et la pensée de manière virtuose, c’était un de nos grands penseurs du XXe, à nous, les Français. J’avais pour ma part bien aimé la lecture de l’Etranger au lycée et je tenais Camus pour une personne sérieuse.
Vient donc le moment de la lecture du Mythe de Sisyphe et force est de constater que ce n’est pas grand-chose de plus que de la philosophie de supermarché… Mais enfin rendez-vous compte, il avait compris tous les questionnements philosophiques à moins de 30 ans et les a résumés dans cette phrase : « Il n’y a qu’un problème philosophique vraiment sérieux : c’est le suicide ». Et puis arrive l’explication du pourquoi du comment.
Le suicide est une question philosophie hautement importante car c’est finalement le choix entre la vie et la mort et ce choix sous-tend une réflexion sur la valeur de la vie. Ce questionnement sur la valeur de la vie met en avant toute l’absurdité du monde à laquelle fait face l’individu : l’appel humain n’est confronté qu’au silence des espaces infinis du monde. Cela peut l’effrayer, et il se réfugiera dans ce que Camus appelle des « sauts » existentiels (la religion en est un exemple) mais il peut choisir d’affronter ce silence et en prendre toute la mesure, voici venu le temps de l’homme absurde. Celui-ci en comprenant que finalement rien n’a grande importance dans ce monde, ne choisira pas d’abandonner lâchement son poste comme le suicidé ou alors de trouver un refuge bien confortable dans la nostalgie de l’absolu, non, il affrontera sa condition par sa prise de conscience, il fera rouler son rocher jusqu’au sommet de la montagne, indéfiniment. Mais attention, lui, il saura ! Haha prend garde absurdité du monde !
Blague à part, l’ouvrage de Camus est quand même intéressant pour ce qu’il révèle de la pensée et des tendances bourgeoises de son époque. Tout d’abord, il montre bien la tendance de la bourgeoisie à naturaliser sa condition pour en faire un universel indépassable. C’est visible dans l’essentialisation de l’expérience humaine, tout au long de l’ouvrage Camus croit décrire une vérité anthropologique (la quête du sens de la vie) quand il ne fait finalement que le compte-rendu de la forme vécue du désenchantement bourgeois. Le bourgeois est en effet pris entre deux feux : l’individualisme idéologique de sa classe et les structures capitalistes bourgeoises contraignant ses ambitions idéologiques. Le bourgeois n’a pas de prise individuelle sur le monde qui l’entoure alors qu’il a été collectivement créateur de la seconde nature du monde. On le raconte démiurge mais il se voit mortel. Cette dissonance le désole, pire elle le fait penser. La division sociale du travail et son arrachement au monde matériel l’emporte dans le monde des idées où il va se charger de tout ramener à lui.
L’homme camusien, en fuyant le réel social, ne cherche plus à combattre ses formes dominatrices, il esthétise son malheur et pense l’impuissance. Il aura d’ailleurs comme références principales des œuvres littéraires (Dostoïevski, Kafka) et des penseurs poético-philosophiques, déjà en retard à leur époque (Nietzsche). Camus ne pense pas en système, ne pense pas avec rigueur mais pense avec des belles formules. Chez lui, la littérature fait office de système, puisque de toute façon la littérature est le sommet de l’absurde. Pensée par-là, d’ailleurs, comme un absolu qui ne se dit pas… entre l’absurde et l’existentiel, il n’y a qu’un pas (ou qu’un saut).
La pensée individualiste est d’autant plus visible dans l’absence de totalité chez Camus. Il pense son homme absurde comme une sorte de surhomme nietzschéen moralisé. Seuls quelques individus sont en mesure de prendre conscience de leur condition et de résister à l’appel du saut. Il y a donc nous, les lecteurs éclairés de Camus, et les autres, pauvres aliénés plébéiens accrochés à leurs rêves et leurs illusions. En ce sens, il bâtit une forme d’aristocratie intellectuelle cachée sous le pudique voile de l’humanisme.
Le silence des espaces infinis a effrayé notre tortueux auteur, bien trop pour qu’il puisse songer à transformer cet état de fait. C’est que sa position ne doit finalement pas être si inconfortable que ça. Cependant, il faut quand même qu’il trouve un moyen de se tourmenter sans trop bousculer les choses, pour cela rien de moins simple que de se présenter comme le sage sur sa montagne qui a percé les secrets du monde. Il a les réponses et figurez-vous que le monde ne peut pas changer : il faut l’accepter tel qu’il est et vaille que vaille.
Solution bien peu attrayante somme toute. Mais esthétiser son impuissance politique est plus efficace individuellement que penser ses conditions de dépassement et donc sa résolution.