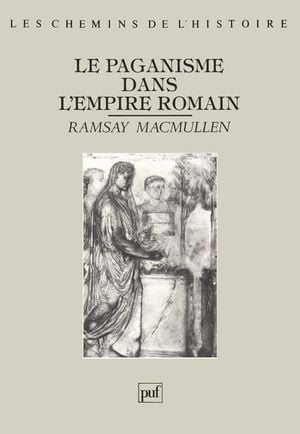Armé de milliers d'inscriptions gravées dans la pierre (ce que l'on nomme l'épigraphie) patiemment recensées dans tout l'Empire romain par d'assidus érudits, le grand historien américain Ramsay MacMullen tente un réexamen de la religion romaine à l'époque impériale, du Ier au Ve siècle après J-C.
Son travail se divise tout simplement en deux parties : les aspects manifestes et les aspects problématiques.
Les aspects manifestes, c'est-à-dire ce qui s'offre à nous sans difficulté particulière. Égrenant les sources et les descriptions, c'est un monde insoupçonné qui s'ouvre à nous, peuplé de centaines, sinon de milliers, de dieux et autant de rites et de cultes. La vie religieuse, s'épanouissant dans un désordre le plus total, est au centre de la vie sociale.
Les sanctuaires, généralement édifiés à l'extérieur des villes et ceints de murs, rassemblent des dizaines de temples mais aussi des bibliothèques où l'on peut se renseigner sur les dieux et les cultes, des théâtres pour les représentations cultuelles, des chambres pour passer la nuit, des salles de festin, des cuisines. Les prêtres sont là pour orienter le fidèle, lui raconter les histoires des dieux selon leurs différentes variantes. Sur les murs des temples, on trouve des partitions musicales avec les paroles des hymnes. Des musiciens jouent durant les cérémonies, l'on déclame des poèmes en l'honneur des dieux. Le temple, avec ses chambres, est aussi le refuge des sans-abris et des mendiants. Il est souvent, selon la divinité qu'il accueille, agrémenté de jardins, d'un bois sacré ou d'un verger où, à l'ombre des arbres, l'on peut pique-niquer dans les espaces dédiés.
Les croyants font des voyages parfois très longs pour se rendre dans certains sanctuaires, quelques uns ayant une réputation dans tout l'empire. On s'y rend pour prier, pour solliciter un oracle, dormir la nuit afin de faire un rêve significatif, et aussi pour se soigner, en particulier dans les temples dédiés à Asclépios.
L'empire, en son immensité, a dû accueillir peu à peu d'innombrables divinités, dont le culte de certaines, comme Isis, Cybèle ou Mithra, ont trouvé de nombreux fidèles dans tout l'empire. MacMullen réfute l'idée du paganisme comme religion d'Etat ; il remarque au contraire un dynamisme fondé sur les initiatives locales, publiques et surtout privées. La marque du paganisme romain est la tolérance, tout y cohabite dans le plus grand désordre. La persécution des chrétiens, remarque l'auteur, se fait encore par excès de tolérance : par intolérance de l'intolérance, pour lutter contre l'athéisme, c'est-à-dire, le refus de croire en l'existence de tous les dieux.
La deuxième partie aborde des aspects plus controversés, ayant traits en particulier à la vitalité du paganisme à l'époque impériale. Les lettrés donnent la sensation d'une profonde mutation dans la pensée religieuse, influencée par la philosophie, qui tend vers la croyance en un dieu unique s'exprimant par les multiples facettes que sont les différents dieux. Néanmoins, armé de ses sources épigraphiques, MacMullen insiste bien sur la nécessité de distinguer la religion des lettrés et la religion populaire, cette dernière étant souvent dénigrée par les premiers. L'auteur s'attaque en particulier à l'idée d'un « paganisme à l'agonie ». L'historien doit écarter l'idée d'une nécessité historique inéluctable, où le présent explique le passé ; il doit également éviter les généralisations abusives donnant une explication unique pour caractériser le comportement de milliers de personnes sur plusieurs siècles.
Les sources épigraphiques montrent au contraire une vitalité continue du paganisme, même au-delà la chute de Rome... jusqu'au XXe siècle, peut-être ? La religion ne cesse d'évoluer. Il n'y a d'ailleurs pas réellement de « paganisme », mais plutôt un ensemble éclaté de cultes et de pratiques excessivement individuels. Les fidèles servent les dieux de leur choix. Pour susciter des « conversions », les miracles demeurent la clé. Les chrétiens n'innoveront pas sur ce point ! Si de nouveaux dieux, dont le célèbre Mithra (ou Sol, ou encore Sol Invictus), mais d'autres plus obscurs, apparaissent dans des territoires qui ne les connaissaient pas à l'origine, la masse documentaire témoignant d'une fidélité inébranlable aux textes classiques d'Hésiode et d'Homère écrase par son nombre toute idée d'une modification profonde de la religiosité, de ses besoins et de ses ressorts, sinon par une mode s'accentuant pour les mystères et une piété moins « rationnelle », attribuant plus aisément le mérite de n'importe quel fait à un dieu, durant le Bas-Empire. De même, les sources attestent d'une conservation insoupçonnée des cultes locaux en dépit de la fameuse romanisation. Il est usuel de livrer à la pierre des noms communs, comme Mars ou Mercure, mais ceux-ci cachent souvent une divinité locale à laquelle on l'assimile en jouant sur la cohérence des symboles. Zeus comme Thor devinrent Jupiter, et jeudi devint thursday lorsque les Germains adoptèrent la semaine de sept jours des Romains.
Qu'en est-il donc de cette « agonie » du paganisme ? Il s'agit d'effets documentaires. Le nombre des sources épigraphiques atteint un sommet puis décroît. En conséquence, les mentions des dieux deviennent moins nombreuses avec le temps. Mais ce sont les graveurs qui ont cessé de graver ! Par ailleurs, graver la pierre n'était pas une habitude propre à tous les peuples ni familière à tous les cultes de l'Empire. Les textes et les fouilles archéologiques attestent de temples en construction, que l'on a compris comme étant délabrés ou à l'abandon. De fait, comme la construction des cathédrales au Moyen Âge, l'édification et l'agrandissement permanent des temples s'est fait sur plusieurs siècles. Surtout, le monde romain connaît une crise économique s'accentuant avec le temps. Or, les formes visibles du culte dépendent toutes des sommes colossales allouées par les personnes privées ou les municipalités (un bœuf, nécessaire pour les sacrifices sanglants, coûte plusieurs années de salaire pour l'homme modeste). Ces cultes déclinent naturellement quand l'argent vient à manquer. Mais il reste toute cette religiosité moins gourmande matériellement que l'historien ne peut réellement connaître.
Le paganisme est-il donc mort à la fin de l'empire romain ? L'auteur répond par la négative. On le voit ici ou là survivre plusieurs siècles après encore. Ses formes usuelles et les plus manifestes disparaissent parce que l'Etat, ayant adopté, fait inédit, une religion officielle, finance son Eglise en dépouillant les temples de leurs biens. L'argent public se tarit. Les cultes ne peuvent plus être célébrés. En dépit de la terreur et des persécutions, les fidèles subsistent vaille que vaille. Justinien devait encore prendre des mesures importantes pour sévir contre les païens. Et à la même époque, tel concile en Gaule dénonce les survivances diaboliques du paganisme, comme ces étrennes de fin d'année que nous faisions encore il n'y a pas si longtemps.
L'explication des conversions au christianisme demeure cependant peu détaillée ; c'était, semble-t-il, à cette époque un sujet qui n'était pas encore abordé par l'historiographie. L'idée de vie après la mort n'était pas nouvelle ; depuis l'époque classique, l'on se pressait aux mystères d'Eleusis pour obtenir l'assurance d'une vie meilleure dans l'autre monde. C'est la résurrection des corps (jugée comme une mauvaise compréhension de la métempsychose par les philosophes) qui apparaît comme une idée novatrice — et séduisante. De ce fait, le christianisme n'aurait pas répondu à des besoins spirituels que la religion traditionnelle n'assouvissait pas : elle en a créé de nouveaux.