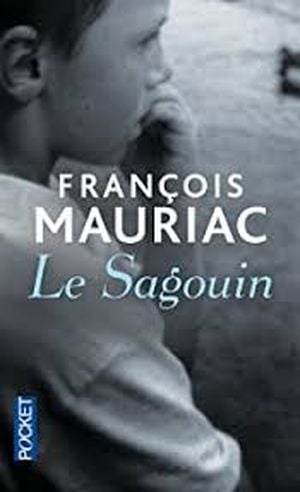Je n’avais jamais lu François Mauriac. Pas vu au Collège. Pas vu au Lycée. Et son nom, dans les années 70, est associé au catholicisme et au journal « Le Figaro ». « Il n’appartient pas à mon camp ». S’y ajoutent ses hésitations au sujet de la guerre d’Espagne, son côté girouette et « Saint-François-des-Assises » au sujet du procès Brasillach. Ça fait beaucoup pour le bête et inflexible adolescent que j’étais, il y avait mieux à lire. Et puis le temps passe, et passe à la trappe François Mauriac comme beaucoup d’autres.
En 2025 (! comme le temps passe en effet, et que la trappe est profonde !), me tombe dans les mains ce court roman « Le sagouin ».
« Le sagouin, c’est un pauvre enfant d’une dizaine d’années : un petit dégénéré de bonne famille, affreux, cagneux, morveux, bavant, la lèvre pendante, terrifié entre un père avachi et une mère furieuse, toujours grondante, la gifle prompte et l’injure sans cesse à la bouche. » (Emile Henriot, Le Monde, 18 juillet 1951)
« Pourquoi me soutenir que tu sais ta leçon ? Tu vois bien que tu ne la sais pas !... Tu l’as apprise par cœur ? Vraiment ? Une gifle claqua. Monte dans ta chambre. Que je ne te voie plus jusqu’au diner. »
C’est la mère qui parle, rongée par ses frustrations et la haine qu’elle porte à son mari et qu’elle déverse sur son « avorton ».
« Comme on dit "faire l'amour ", il faudrait pouvoir dire "faire la haine" ».
Cette mère est un monstre. En face d’elle un autre monstre, la baronne, sa belle-mère, aristocrate rigide enfermée dans ses principes, le dédain toujours au bord des lèvres.
« Si la chambre de Mamie lui assurait un refuge plus inviolable que la cuisine, en revanche, son instinct l’avertissait de ne pas se fier à Mamie, ni à la tendresse de ses gestes, de ses paroles. »
Il y a, chez François Mauriac, une vraie détestation des femmes… (Seule, Fräulein, la bonne manifeste quelque affection au garçon baveux)
Si Mauriac dénonce aussi bien l’aristocratie décatie et la bourgeoisie jalouse de celle-ci, il n’épargne pas pour autant la classe montante, la classe moyenne, ici représentée par l’instituteur et sa femme. Car si le sagouin avait une chance de s’en sortir et de s’élever (étymologie du mot « élève ») c’était par l’éducation. Or le maître d’école, celui qui aurait pu instruire, même lui, guidé par son épouse (Oh ! les mauvaises femmes chez Mauriac…), embrouillé dans et par son idéologie, même lui renonce et bafoue l’idéal pédagogique. Comme une faillite de l’école (déjà ?).
François Mauriac, par une écriture sèche, concise, en une centaine de pages, nous raconte la noire destinée de ces cinq personnages en route vers l’abîme. Et au bord de l’abîme, celui qui aurait pu :
« Il aurait pu, il aurait dû s’émerveiller d’entendre cette voix fervente de l’enfant qui passait pour un idiot ; il aurait pu, il aurait dû se réjouir de la tâche qui lui était assignée (…). »