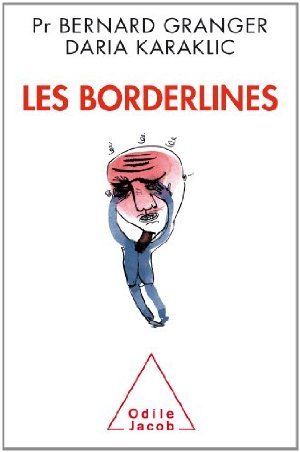Le trouble de la personnalité borderline (TPB) est caractérisé par un schéma omniprésent d’instabilité dans les relations, l’image de soi, les humeurs, le comportement et l’hypersensibilité à la possibilité du rejet et de l’abandon. (Manuel MSD)
Les deux auteurs, psychiatres et professeurs à Paris-Descartes, ont écrit ce livre pour les personnes atteintes, leurs proches, et pour les professionnels qui méconnaitraient souvent ce trouble. Il s’agit donc d’un ouvrage informatif, vulgarisant les connaissances médicales et faisant le point sur les aspects thérapeutiques.
J’ai trouvé la démarche très bien menée : le propos est clair, suffisamment détaillé, sourcé, illustré, sans être rébarbatif. L’ensemble représente 180 pages, d’une lecture plutôt facile. D’autant plus que les informations étant bien thématisées, on peut aussi passer la conscience tranquille les chapitres ou sections pour lesquelles on a moins d’intérêt. Pour ne rien gâcher, le propos est plutôt optimiste et nuancé, ce qui évite de se manger des propos caricaturaux ou désespérants.
Une réserve : je trouve la partie sur l’entourage des borderlines un peu courte.
C’est une acquisition utile, soit pour les professionnels de la santé mentale, soit pour les personnes confrontées à ce trouble (directement ou indirectement). Avant de vous lancer dans la lecture, voyez par exemple cette page qui présente rapidement le trouble. Si vous reconnaissez suffisamment de traits chez vous ou un proche, il peut être intéressant de se plonger dans le livre de Granger & Karaklic.
⇒ 8 sur 10, parce que c’est un bon tour d’horizon du sujet et qu’il peut rendre service, non pas 9 sur 10 car ça n’a pas d’intérêt pour un lecteur lambda qui ne serait pas touché par le sujet, et parce que la concision du propos implique qu’il soit aussi incomplet.
Livre dont je résume les grandes lignes et certains enseignements :
Chapitre 1. Une maladie à l’histoire mouvementée & Chapitre 2. Qu’est-ce que le trouble borderline ?
Ces 25 premières pages expliquent la formation du concept de « personnalité borderline » au cours du dernier siècle, d’abord à partir d’intuitions psychanalytiques, ensuite raffinées (ou contredites) par des études empiriques et des tentatives de formalisation dans les différentes éditions des fameux manuels DSM. Les auteurs posent dans le chapitre 2 des éléments de définition retenus par la communauté médicale, précisent le concept de « trouble de la personnalité » et le distinguent d’autres troubles mentaux (la dépression par exemple). Le TPB est donc un mode durable de conduite, constitué de différents traits que l’on retrouve dans la population « normale » (impulsivité, colère…) mais dont l’intensité et la fréquence en font une source de souffrance psychologique. On apprend également que le TPB touche (au moins) 2 % de la population générale, et qu’il semble être plus courant chez les femmes.
Chapitre 3. Quels symptômes ?
Les auteurs les regroupent en plusieurs axes :
▶ Humeur changeante et émotions intenses
- Les borderlines sont souvent hypersensibles, leurs émotions devenant rapidement intenses, mais s’atténuant lentement. Parmi les événements qui peuvent susciter une réaction forte, voire « excessive » : des signes, même minimes ou imaginaires, de désapprobation de leur entourage. Ou bien la perception des émotions négatives des autres qui peut les bouleverser profondément (même si ce ne sont pas des proches : un film, un article de journal, un SDF dans la rue…). Un borderline est susceptible à la fois de s’imprégner de la détresse des autres, ou à l’inverse de projeter chez eux sa propre souffrance refoulée.
- Il vit dans un « état de tension quasi-permanent », entraînant une angoisse « floue », pouvant l’envahir rapidement pour des raisons en apparence anodines, et pouvant culminer en crises d’angoisse.
- Gestion compliquée de la colère, qui peut selon les sujets être inhibée et réprimée (et tournée contre soi-même dans des comportements autodestructeurs), ou exprimée de façon excessive et inappropriée. Chez certains, l’agressivité est exprimée de façon détournée, par des sarcasmes, des provocations répétées au conflit… Les proches finissent donc par « marcher sur des œufs ».
- Un sentiment de manque, de vide, plus flou et durable que dans la population normale qui connaît aussi des passages à vides circonstanciés et transitoires.
- Envahi par ces émotions, le sujet borderline tolère moins bien le stress, et voit ses perceptions et son raisonnement altérés, ce qui peut le pousser à prendre des décisions irréfléchies, ensuite regrettées.
▶ Les troubles du comportement
- Impulsivité : la frustration étant mal tolérée, le passage à l’acte immédiat est vécu comme seule solution pour neutraliser le mal-être. Il peut être autodestructeur, quand il s’agit de consommer de l’alcool ou des drogues, ou s’exprimer en boulimie, achats compulsifs… Cette impulsivité peut aussi avoir des conséquences relationnelles, quand les éruptions de colère entraînent disputes, ruptures et réconciliations.
- Manque de limites, qui peut s’exprimer dans la gestion du temps, de l’argent, un rapport conflictuel à l’autorité, l’intolérance au fait que des proches leur disent non, la difficulté à aller au bout de ses projets et capacités par sentiment d’inaptitude…
- Automutilations, que les auteurs expliquent diversement : pour apaiser leurs émotions fortes, se punir, rendre la détresse émotionnelle plus concrète et « justifiée », retourner l’agressivité sur soi, atténuer le sentiment de vide et d’irréalité…
- Tentatives de suicide : 75 % des patients borderlines auraient présenté au moins une tentative de suicide. Ce n’est pas tant par sentiment que la vie ne vaut pas d’être vécue (suicide dépressif) que pour échapper à un état de tension insupportable, ou comme stratégie d’appel au secours.
▶ Les troubles de l’identité
- Une image de soi « extrêmement fragile et instable […] Même une critique bienveillante peut susciter des doutes profonds […] Encore plus que les critiques, les expériences de rejet et de séparation déclenchent le sentiment insupportable d’être extrêmement mauvais et sans valeur ». Cette dévalorisation est constante chez certains, alors que d’autre oscillent avec l’idéalisation excessive.
- Parfois, des difficultés d’engagement à long terme dans une voie, même si certains trouvent justement au travail une stabilité rassurante dans leur vie.
- Des difficultés à être authentiques dans les relations sociales : ils « changent d’opinions, d’attitudes et d’intérêts en fonction des personnes qu’ils rencontrent […] Le sentiment subjectif d’être perdu, vide et différent des autres les conduit à adopter une attitude d’hypernormalité de surface », qu’on appelle aussi parfois « faux-self ».
▶ Les perturbations des relations interpersonnelles
- Des relations instables, parce que conflictuelles. Il semble que plus le borderline s’attache à une personne, plus la relation devient tumultueuse. En effet, le sujet est pris entre son besoin de fusion et ses angoisses d’abandon.
- Le borderline vit une quête d’amour où la méfiance initiale (par crainte du jugement de l’autre) est rapidement remplacée par une confiance aveugle si l’autre se montre chaleureux et attentionné. « Toujours à la recherche d’un sauveur », il peut idéaliser ses proches et s’abandonner sans réserve.
- Toutefois, les autres sont perçus « en noir et blanc ». Il lui est difficile de tolérer leurs incohérences ou ambiguïtés, bref, le fait qu’ils puissent être bons et mauvais à la fois. C’est donc l’instant présent qui détermine la vision que le borderline aura d’autrui, plutôt que de prendre en compte l’ensemble des expériences partagées pour se faire une image globale nuancée.
- Le borderline a une peur de l’abandon envahissante, renforcée par sa faible estime de soi, qui le pousse donc à chercher partout des indices que les autres vont le quitter. Possessivité, jalousie, requêtes servent à tester l’attachement du partenaire, et parfois le borderline anticipe l’abandon en provoquant lui-même l’éloignement et la rupture.
En conclusion du chapitre, les auteurs soulignent que « tous les borderlines ne sont pas pareils » : certains ont des formes graves, qui affectent même leur vie amicale, professionnelle, et les met à risque d’automutilation ou de suicide. D’autres ont des formes légères, les symptômes s’exprimant surtout avec les proches (famille et partenaires amoureux).
Le chapitre s’achève sur une liste de troubles avec lesquels il ne faut pas confondre le TPB : dépression, bipolarité, addiction, PTSD, schizophrénie, autres troubles de la personnalité (paranoïaque, évitante, narcissique…).
Chapitre 4. Des causes multiples
Ici, les auteurs ne prennent pas trop de risques et soulignent que des causes génétiques (à la marge), psychologiques (famille négligente ou maltraitante, traumatisme) et sociales (changements propres à la société contemporaine, accentuant l’inadaptation des personnalités fusionnelles et impulsives) sont à prendre en compte. C’est un court chapitre, notamment parce que le sujet devient technique et controversé, les recherches médicales n’étant pas encore très concluantes.
Chapitre 5. La psychothérapie, traitement par excellence & chapitre 6. Les traitements médicamenteux
Ici les auteurs évoquent différentes psychothérapies, qui sont apparemment le meilleur moyen d’obtenir une amélioration durable du TPB. Les approches psychanalytiques seraient peu efficaces, à moins d’être adaptées aux sujets borderlines. En revanche, les thérapies cognitives et comportementales ont inspiré plusieurs approches : approche d’Aaron Beck visant à déconstuire les schémas de pensée négatifs et invalidants, « thérapie dialectique comportementale » de Marsha Linehan (elle-même borderline), thérapie des schémas de Jeffrey Young.
Après cela, les auteurs abordent les conditions nécessaires pour une thérapie efficace : motivation du sujet à changer, qualité de la relation thérapeute-patient, respect du cadre thérapeutique…
Dans le chapitre 6, on apprend que des psychotropes peuvent être donnés en appoint, mais qu’il ne faut pas en attendre une amélioration durable. D’ailleurs, le TPB n’est pas, comme le diabète, la bipolarité ou l’hypothyroïdie, une condition nécessitant une médicamentation ininterrompue. Il n’existe pas de traitement spécifique contre le TPB, selon les symptômes à traiter, on aura donc recours à des antidépresseurs ou antipsychotiques, parfois à des anxiolytiques… Selon l’avis circonstancié du du médecin psychiatre.
Chapitre 7. L’évolution dans le temps
Apparaissant le plus souvent à l’adolescence ou au début de l’âge adulte, le TPB est susceptible d’évolutions. Il semble que la plupart deviennent plus stables dans leurs relations dans la trentaine ou la quarantaine. Avec l’âge, des symptômes transitoires (impulsivité, automutilations…) s’atténuent ou disparaissent, d’autres symptômes chroniques (peur de l’abandon, dépendance affective) persistent mais peuvent être apprivoisés (on retrouve l’intérêt d’une psychothérapie).
Hormis le suicide qui est une évolution évidemment défavorable, les auteurs relèvent que des événements ponctuels peuvent entraîner un déclic : devenir parent, être confronté à la mort, rencontrer un partenaire bienveillant et compréhensif, capable de s’adapter aux difficultés affectives…
Conclusion du chapitre :
À partir de quel moment moment le sujet borderline devient-il prêt à accueillir une expérience relationnelle positive en résistant à la tentation de détruire ce lien, par exemple, en mettant sans cesse à l’épreuve les limites de la tolérance du partenaire ? […] C’est grâce à la fois à la psychothérapie et à une autre relation proche (sentimentale ou amicale) que [les sujets d’une étude des auteurs] ont évolué le plus.
Chapitre 8. En pratique, que faire ?
Ce dernier chapitre, qui me semble un peu court, insiste évidemment sur l’importance de se faire aider, en commençant par s’adresser à un psychiatre, si possible spécialisé dans ce trouble. Ils soulignent aussi qu’il existe des associations de patients.
Il y a aussi 4 pages sur le comportement que devrait adopter l’entourage. C’est une partie qui aurait méritée d’être développée.