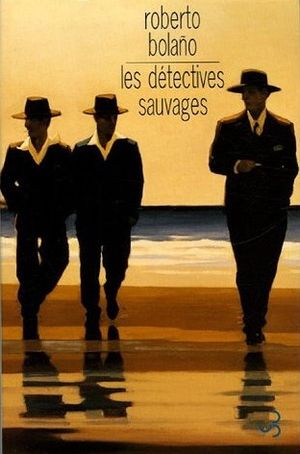Roberto Bolaño eut une idée originale : raconter comme Arturo Belano et son ami Ulises Lima, jeunes fondateurs beatniks d’un mouvement poétique vite abandonné et oublié, appelé réal-viscéralisme, marquèrent une multitude de personnages dont les témoignages rassemblés permettent de reconstituer leur biographie polyphonique, composée ainsi de subjectivités souvent égocentriques et parfois contradictoires. Ces deux hommes, enquêtant eux-mêmes sur l’existence d’une poète qui a presque disparu des mémoires, sont les « détectives sauvages » du titre – et toute leur « sauvagerie » tient de leur mode de vie nomade et sans objectif net –, et cependant ils sont, du point de vue du lecteur, ceux sur qui reposent l’investigation principale, à savoir: la quête d’un certain ordre caché, peut-être d’une portée supérieure en cet erratisme apparent.
Cet enchevêtrement un peu inutilement intellectuel des narrations, semble surtout fait à la Faulkner pour la pâture des critiques et amateurs de « pistes de lecture » : un auteur capable d’écrire, comme la quatrième de couverture le rapporte : « Mon roman comporte autant de lectures qu’il contient de voix. Il peut se lire comme une agonie. Mais aussi comme un jeu. » L’artiste sincère et véritable se mesure à la fiabilité de ses propres critères qu’il est apte à expliciter pour se les être beaucoup expliqués à lui-même, et il ne se contente pas de dire indéfiniment, pour complaire à tous : « Chacun peut trouver en mon œuvre ce qu’il veut », au même titre que s’il l’avait écrite sans intention particulière, un peu par hasard et sous un grand nombre d’inspirations inconscientes et floues, comme s’il n’existait pas une vérité de son projet initial qu’un lecteur plus perspicace pouvait déceler, et sur laquelle l’un et l’autre étaient en mesure de s’accorder franchement. Rien de plus lâche qu’un écrivain qui, pour satisfaire le plus grand nombre, refuse de donner tort à quiconque et qui se contente d’insinuer, face aux questions et aux remarques, que toutes les interprétations sont possibles et également bonnes.
L’idée – l’argument du récit – est fabuleuse, mais son traitement m'a parût catastrophique. Le style est plat, factuel, sans détail, si l’on excepte les interminables énumérations de noms propres dont l’auteur se fait une spécialité : aspire-t-il à exhiber une érudition patente, ou s’agit-il pour lui d’une prestation de poésie par effet de pures sonorités ? La narration donne l’impression paradoxale d’une poursuite à vive allure dans une existence oisive où rien d’important n’a lieu, façon d’excitation compulsive au cœur de l’ennui et du néant. Il ne se passe à peu près rien, ce qui a lieu est sans psychologie, sans beauté particulière même au figuré, c’est presque du point de vue externe, même si des êtres racontent, sans beaucoup d’affects ni de vraisemblance. On ne sait pas pourquoi ils racontent, on ne sait pas où ils racontent (sur quel support, par exemple), on ne sait pas ce qu’ils trouvent d’intéressant à raconter. Le roman fait une vie avec rien, monte une vie d’artifice, une agitation frénétique qui ressemble aux spasmes des presque-morts mais sans saveur cordiale.
C’est beaucoup de pages, et c’est pour beaucoup, j’en jurerais, de la page: Bolaño ne choisit guère ce qu’il raconte, ne pratique pas la sélection; il se laisse emporter, ajoute des morceaux superflus parce que, certainement, ce morceau est "d’un intérêt arbitraire comme la vie même". Il faut lire un siècle de papier pour avoir progressé dans l’intrigue. Il n'y a rien à admirer de cette écriture sans beauté, souvent sans pittoresque ni personnalité. L’intrigue ne relate que des rencontres banales aux conversations ébauchés presque sans scène (ce qui est parfois relaté avec exactitude semble fait pour exaspérer le lecteur : souvenir d’un passage où le narrateur n’ose rentrer chez lui de nuit parce qu’il a perdu ses chaussures chez son amie, où il s’inquiète longtemps de cet égarement qui va l’obliger à errer à tâtons dans la maison et à y rester dormir, et où, le jour venu, il regagne la rue sans indiquer qu’il a récupéré ses chaussures ni où ni comment).
Le lecteur indulgent se laisse au mieux étourdir, dans l’espérance d’une énième scène de sexe, mais là aussi, l'espoir périclite sur-le-champ: les rapports sexuels sont dénués d'amour, de sensualité et s’enlisent dans une représentation dégradante des femmes, réduites à des partenaires privées d’intériorité et de désirs propres. Ces scènes donnent l’impression d’être greffées au récit pour lui conférer artificiellement un ton racoleur. Mais si le lecteur se réserve la possibilité de ne pas achever un livre (ce qui n’arrive aujourd’hui qu’à condition que le texte pose difficulté, ce qui n’est pas le cas ici), alors il ne voit dans Les Détectives Sauvages pas la matière pour se contraindre à terminer. Lire ce livre m'a donné la sensation de me vautrer dans une activité passive, un désœuvrement irréfléchi, une monotonie aliénante.
Tous les narrateurs s’expriment à peu près de la même manière, sans distinction de tonalité ni de présentation du texte, usant de tournures orales un peu négligées, inutilement prolixes en style de parataxes interminables, aux psychologies rudimentaires, et avec une forme d’insensibilité négligente et de rudesse bizarre, comme revenus sans atteinte des difficultés les plus certaines, attachés exclusivement aux faits et aux successions comme s’il était universel de raconter des événements de son existence en n’insistant sur rien, en ne mettant en relief aucun sentiment, mais d’une façon qui interroge sur la raison d’être de ces synthèses rédigées en manque patent de paragraphes (sur le modèle de Kerouac, sans doute). Comment, pourquoi, dans quel dessein, peut-on dresser de tels rapports spontanément et d’une seule traite en ayant si peu d’intentions à communiquer ? Cela passe la vraisemblance.
En outre, tous les récits gravitent autour d’hommes, tandis que les femmes font seulement figures de silhouettes qui défilent en arrière-plan. Lupe, par exemple, n’apparaît que comme un simple point de fuite : une prostituée à arracher, excitateur d’un récit manifestement peu concerné par ses désirs. Et Cesárea Tinajero — femme, poétesse, mémoire perdue — reste sans voix : elle n’est qu'un vide offert aux protagonistes masculins, dont les vaines aventures viennent le combler, comme si l'obsession de Bolano à voir les femmes au lit comme des cavités sans paroles se prolongeait dans la structure même du récit.
Enfin, il est pour le moins ironique qu’un roman où la poésie occupe un rôle central ne prenne jamais la peine de donner au lecteur un seul exemple des poèmes de ses protagonistes. L’impression qui s’en dégage est double : non seulement l'auteur ne semble pas avoir mené sa démarche jusqu’au bout, mais il exclu le lecteur de l’univers même qu’il prétend lui faire partager.
Post-Scriptum : après lecture brève d’une synthèse sur la vie de Bolaño, il semble bien que l’auteur se soit mis à la rédaction d’un roman surtout dans un intérêt alimentaire et sous la sollicitation insistante d’éditeurs, constatant que la poésie ne lui offrait pas d’assurer le confort de sa famille. Un homme qui se trouve dans la nécessité presque vitale de vendre quantité d’ouvrages dispose à la fois d’une raison et d’une excuse pour dire : « Mon roman comporte autant de lectures que etc. » ; oui, mais c’est alors un homme qui, sans avoir cessé d’être écrivain, ne peut plus prétendre à l’artiste.