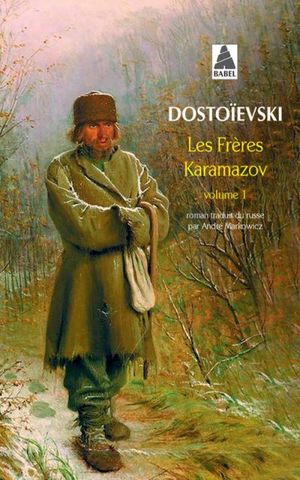Cette courte critique reprend et condense rapidement les points importants de l'analyse de Stephane Lojkine. L'analyse porte sur certaines étymologies cruciales et le rapport institutionnel de la foi orthodoxe dans le début du second volume des Frères Karamazov. J'ai apporté de légers ajouts dans certaines étymologies qui dénaturent nullement l'analyse et ai apporté une interprétation finale basée sur son analyse.
Pour ceux qui souhaitent voir la série de vidéo :
https://amupod.univ-amu.fr/video/4202-dostoievski-les-freres-karamazov-une-odeur-de-decomposition-1/
https://amupod.univ-amu.fr/video/4203-dostoievski-les-freres-karamazov-une-odeur-de-decomposition-2/
https://amupod.univ-amu.fr/video/4208-dostoievski-les-freres-karamazov-une-odeur-de-decomposition-3/
Dans Les Frères Karamazov, on a d'un côté l'institution monastique dirigée par les higoumènes qui sont concurrencés par l'institution populaire des Starets.
Celle-ci se greffe littéralement au sein de l'institution monastique et devient une sorte de religion sectaire. Cette greffe est caractéristique de la nature même du starets : il y a d'un côté les moines appartenant à l'ordre régulier et les prêtres à l'ordre séculier, le starets étant hiéromoine il aura un statut particulier. Aussi bien régulier que séculier le starets court-circuite la logique institutionnelle du monastère : il reste au monastère tout en étant un point de contact avec l'extérieur où il reçoit ses fidèles, leur fait des confessions. Les fidèles ne viennent pas pour le monastère mais pour voir le starets.
La nature du starets préfigure la profondeur de la tempête qui se déroule au début du second volume.
L'orthodoxie russe étant issue de l’Église byzantine, Dostoïevski puise nécessairement son étymologie dans la langue grec.
L'étymologie grec de Zosime (zosma) signifie à la fois "vivant" au sens de vigueur et "ceindre" au sens de lier quelque chose, quelqu'un.
Dans le roman le père Théraponte représente l'idéal de la foi orthodoxe : simple d'esprit, il est tellement pur dans son ascèse qu'il en devient involontairement comique, c'est l'idiot du village, un fol-en-christ relativement admiré par les moines. Il représente une sorte d'antagonisme, un adversaire symbolique à Zosime et tient l'étymologie grec dans thérapon qui signifie serviteur dévoué à Dieu.
Il y a deux autres termes cruciaux à décortiquer pour se rendre compte de la complexité du souffle cataclysmique du second volume, à savoir "esprit" qui en russe se traduit par "doukh", terme bivalent car il signifie à la fois esprit mais aussi odeur qui nous ramène à la décomposition corporelle de Zosime.
Le second terme est "soblazn" qui est tout aussi difficile à traduire, il signifie tentation, mais on a du mal à comprendre le rapport qu'entretient la tentation dans le contexte du roman qui est plus de l'ordre du scandale. Si on remonte au vieux slavon, il s'avère qu'il conserve le sens originel évangélique du terme grec "scandalon" qui veut dire obstacle, faire obstacle mais dont les conséquences de l'achoppement auront dans le nouveau testament le sens bivalent de tentation et de scandale.
Dans soblazn, il y a blazn, dans les langues slaves blazn signifie bouffon, polisson. Si on rapproche Blazn du haut allemand (blazen), on dérive rapidement vers des termes comme bêler, dire des bêtises, du "bla bla". Brasser du vent, souffler de paroles vaines (blow en anglais et blazen en néérlandais : souffler).
Et en russe on traduit souffler par ... dout' (doukh).
Ainsi une jonction entre deux idées antinomiques se fait par le biais du souffle qui aboutira à un double renversement :
Le souffle de la foi et de l'esprit plein de vigueur de Zosime contre le souffle de la rumeur et du scandale de Théraponte.
Le renversement consiste en ceci que le premier souffle qui lie ses fidèles, censé être plein de vigueur, entraine la corruption, la puanteur, la décomposition tandis que le second est un rappel à la vraie foi par l'intermédiaire de procédés profanateurs.
L'enjeu peut se voir à trois niveaux : d'abord à l'échelle de l'institution religieuse où s'opère une confrontation indirecte et symbolique entre deux rapports à la foi (confrontation qui se dédouble tacitement si nous incluons l'institution monastique des higoumènes) qui ont pour point commun la greffe (le starets, en tant que religion populaire, sectaire se greffe à l'institution monastique officielle tout comme Théraponte qui se greffe à celle-ci en vivant presque en autarcie dans une petite demeure afin de préserver la pureté de sa foi).
Le second réside à une échelle plus large touchant l'ensemble des personnages du roman qui se verront imposer symboliquement une grande épreuve existentielle due aux conséquences contingentes de la mort de Zosime : les moines s'attendaient à une espèce de miracle, or cet état d'attente constitue un péché, Dostoïevski écrit au début du premier volume "ce n'est pas la foi qui naît du miracle, c'est le miracle qui naît de la foi". Ainsi, ce souffle putréfié, obstacle paradoxalement tentateur, en tant qu'il est capable de renforcer les esprits de ses fidèles (comme Aliocha) et les confronter à la dure réalité, peut être considéré paradoxalement plein de vigueur. Mais nous pouvons aussi interpréter ce souffle comme le signe d'une foi velléitaire (Zosime se laissait avoir par des plaisirs gustatifs auprès de compagnies féminines) dont le fol-en-christ, Théraponte (qui cèle un paradoxe redoutable pour l'orthodoxie puisque si sa simplicité se rapproche de l'idéal de la foi orthodoxe, sa propension au scandale qui découle de l'idiotie l'en éloigne toutefois), ne pouvait s'empêcher de l'expliciter (par des moyens qui desservent son idée) auprès des moines du monastères et de rappeler à l'ordre, à la vraie foi.
De manière encore plus large, ce fait tragique au sein du monastère nous éclaire sur un autre fait tout aussi tragique qui constitue la majeure partie du roman et où l'enjeu consiste à rendre compte de l'implication collective au meurtre du père, lui-même fautif.