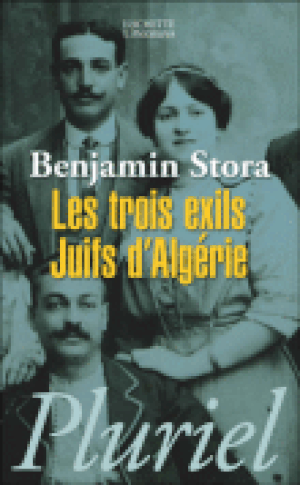Les trois exils, Juifs d'Algérie par Yananas
Benjamin Stora, Professeur des universités, éminent spécialiste du Maghreb, et plus particulièrement de l’Algérie contemporaine, a consacré nombre de ses recherches au nationalisme algérien et à l’immigration algérienne en France. De Messali Hadj : pionnier du nationalisme algérien (1987) aux Immigrés algériens en France : une histoire politique (1912-1962) (2009), l’historien de Constantine n’a eu de cesse de réfléchir à l’histoire de sa terre natale. Utilisant à la fois sources orales et visuelles pour pallier la déficience ou la difficulté d’accès aux documents écrits, il a grandement contribué à l’élargissement de l’éventail documentaire pour l’histoire de l’Algérie contemporaine. Son ouvrage Les trois exils, Juifs d’Algérie, publié en 2006, s’inscrit largement dans le sillon de ce renouvellement documentaire dans la mesure où il s’attache à mettre au service de son étude des sources privées – à l’image de ces trois photographies qui introduisent chacun des chapitres de l’ouvrage – et des documents jusqu’alors peu exploités. N’est-ce d’ailleurs pas le cas du Bulletin de la Fédération des Sociétés juives, corpus inédit rendant compte de l’activité des principales associations juives d’Algérie, civiles ou religieuses, et venant compléter les archives sur l’Algérie au temps de la colonisation conservées au Centre des archives d’outre-mer (CAOM) à Aix-en-Provence ? Par ailleurs, Benjamin Stora fait la part belle aux témoignages oraux, qu’il s’agisse de ceux émanant de sa famille, ou des interventions de rabbins lors de colloques consacrés à la question des juifs en Algérie – notons au passage l’emploi de la minuscule à « juifs », permettant ainsi de saisir la communauté dans sa dimension sociologique. Mais au-delà de ces considérations matérielles sur les sources, l’originalité de cet ouvrage est qu’il se situe à la croisée de l’histoire générale et de l’histoire personnelle. L’idée d’écrire ce livre n’a-t-elle pas éclos lorsque l’historien revint au bercail en 2004 en compagnie de son fils, dans ce pays qui avait vu naître son père à Kenchela, dans les Aurès ? D’où le statut aporétique de cet ouvrage : est-il un essai historique sur la population juive en Algérie, ou bien en filigrane l’expression d’un devoir mémoriel ? Représente-t-il un témoignage de la riche histoire d’une population aujourd’hui quasiment disparue des rives algériennes, ou encore le support écrit d’une catharsis personnelle ?
Quoi qu’il en soit, la thèse de ce livre considère que les juifs ont connu trois exils depuis l’arrivée des Français sur le sol algérien : un premier exil qui les a coupés des « indigènes musulmans », en adoptant, par le décret Crémieux de 1870, la nationalité française ; un deuxième exil au moment du régime de Vichy, se retrouvant cette fois-ci bannis de la communauté française par les lois discriminatoires dont ils ont été victimes ; et enfin un dernier exil, qui a conduit les juifs sur les routes de l’exode consécutivement à l’indépendance algérienne. Les juifs se sont donc déplacés trois fois : hors de la tradition juive, hors de la nation française, et hors de l’Algérie.
Alors que depuis les années 1990, l’heure est au regain de l’islamisme radical, des séparatismes et des dérives communautaristes en tous genres, où crispations et incompréhensions ont la part belle dans les médias, Benjamin Stora a voulu, a contrario, souligner cet héritage séculaire de « connivences plurireligieuses » (p. 181), d’ententes et de séparations entre communautés, et plus fondamentalement, de coexistence. Cette invitation au voyage intérieur de l’historien a aussi été l’occasion de nouer les fils du métissage, de redonner sens à l’hybridation des identités, car « cet héritage historique des trois exils a réveillé en moi une mémoire longue de l’identité. Et la certitude obstinée qu’il est possible d’être à la fois juif et français, républicain et comprenant les rites religieux, tourné vers l’Occident et marqué à jamais par l’Orient, par l’Algérie » (pp. 182-183). Cet ouvrage nous invite également à questionner le lien, manifeste ou latent, qui unit l’historien à son travail de recherche. La nécessaire réflexivité de l’historien ne consiste pas nécessairement en l’éclaircissement des racines de sa vie « ou le contexte de cette vie », comme l’évoquait Carlo Ginzburg dans un entretien au Monde en 1980, mais elle peut passer par une psychanalyse ou une socioanalyse de la recherche historique. Cette démarche invitant à interroger les conditions d’exercice de la pratique, dans le but de saisir les mécanismes et les conditions sociales de production du discours historique, n’était pas, pour Pierre Bourdieu , un artifice, mais un préalable nécessaire à toute recherche. Et il semble que sur ce point, Benjamin Stora nous permette de nous interroger sur les liens ténus entre l’historien et ses objets.
Cependant, cet ouvrage soulève d’autres questions, d’ordre lexical. L’emploi du terme d’exil est-il employable univoquement pour décrire des processus assez différents ? En l’occurrence, nous pouvons nous demander si le décret Crémieux a généré un exil, tant l’assimilation des juifs avait commencé dès les années 1830, et tant elle fut accueillie favorablement par les populations mêmes. L’arabité des juifs fut-elle abandonnée dès 1870 ? Nous pouvons le mettre en doute, car le processus d’assimilation commença bien en amont, et André Chouraqui, entre autres, montre bien que la marche à l’occidentalisation fut extrêmement rapide. La métaphore – que Benjamin Stora file tout au long du livre – de l’exil est probablement moins appropriée dans le premier cas du décret Crémieux que dans la configuration de l’exclusion des juifs par Vichy.
Il n’en demeure pas moins que ce livre constitue une belle introduction à l’histoire contemporaine de la présence juive en Algérie, à la lecture à la fois agréable et stimulante, parsemé de photographies et d’annexes judicieusement choisies, bien qu’il ne révolutionne en rien l’historiographie sur cette question. A cet égard, nous pouvons aussi regretter qu’il n’évoque pas – ne serait-ce qu’en introduction – la tradition historiographique sur le sujet des juifs algériens à l’époque contemporaine. Mais là n’était pas, manifestement, l’intérêt de cet ouvrage par bien des aspects passionnant.