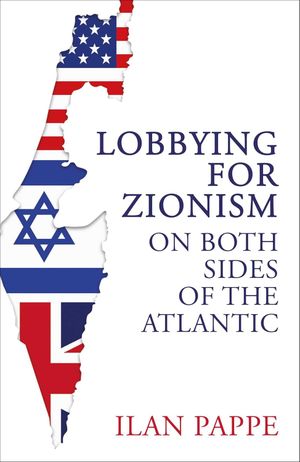"Parmi ces « sionistes gentils » figurait également Laurence Oliphant (1829–1888), un restaurationniste actif qui tenta même de promouvoir la création de la première colonie juive en Palestine. Membre du Parlement et disciple de Lord Shaftesbury, il estima que le meilleur moyen de défendre son idée était de publier un livre, qu'il envoya aux parlementaires et aux ministres. Intitulé The Land of Gilead (La Terre de Galaad), cet ouvrage exhortait le Parlement britannique à soutenir la « restauration » des Juifs d'Europe de l'Est en Palestine. Il fut le premier « lobbyiste » à prendre en compte l'existence d'autres peuples déjà présents en Palestine, mais il proposa d'adopter le « projet » colonial de peuplement américain, consistant à refouler la population autochtone dans des réserves – une approche qu'il jugeait adaptée comme « solution » face à la présence des natifs en Palestine.
...
Mais Herzl ne se contenta pas de vanter l'Empire britannique. Il suggéra ensuite qu'un État juif pourrait servir non seulement les intérêts britanniques en Asie, mais aussi ceux du monde occidental dans son ensemble, affirmant qu'il était dans « l'intérêt des nations civilisées » d'avoir une « station culturelle » en Asie. En somme, il flattait les préjugés de son auditoire. Le Manchester Courier, qui relata son discours, alla jusqu'à affirmer qu'un État juif apporterait « un élément de stabilité à la politique asiatique ».
Les raisons pour lesquelles Balfour se tourna vers le sionisme n'étaient en rien évidentes – il n'éprouvait certainement aucune sympathie particulière pour le sort des Juifs. En 1905, l'année même où il rencontra Weizmann pour la première fois, il soutint l'Aliens Act, la première loi britannique restreignant l'immigration, destinée à endiguer l'afflux de Juifs fuyant les pogroms en Europe de l'Est. Certains chercheurs soupçonnent que l'antisémitisme le motivait, tant dans son soutien à ces restrictions que dans son enthousiasme à établir des colonies juives en Palestine. Mais ce n'était rien d'autre que ce que les sionistes juifs eux-mêmes promettaient : Herzl répéta aux Britanniques et aux Allemands que la colonisation sioniste de Palestine détournerait les redoutés Ostjuden (Juifs de l'Est) vers la Palestine, les éloignant ainsi de l'Europe occidentale.
...
Pourtant, en Grande-Bretagne, des membres de la famille [Rothschild], comme Walter Rothschild, se révélèrent être des sionistes enthousiastes. Il aurait dû rester dans les mémoires pour ses réalisations en tant que naturaliste exceptionnel et fondateur de ce qui est aujourd’hui le Natural History Museum de Tring, où il rassembla la plus grande collection d’espèces d’histoire naturelle jamais constituée par une seule personne. Mais il est surtout connu aujourd’hui pour son rôle dans la Déclaration Balfour.
Walter et d’autres membres de la famille Rothschild étaient des alliés proches de la classe dirigeante britannique. La branche britannique de leur banque devint une force politique puissante en finançant une partie des dépenses de l’Angleterre pendant les guerres napoléoniennes. En 1875, elle finança à la fois l’achat britannique du canal de Suez et les entreprises de Cecil Rhodes en Afrique. « Notre » Rothschild était le visage public de la famille en Grande-Bretagne. Il devint plus tard président du Board of Deputies of British Jews pendant un an, en 1925.
Étonnamment, la principale opposition aux aristocrates pro-sionistes vint de leurs propres proches. Le principal adversaire de Herbert Samuel était son cousin, Edwin Samuel Montagu (1879–1924), qui faisait partie du triangle amoureux mentionné précédemment, impliquant Asquith et Stanley. Homme politique libéral, il était considéré comme membre de l’aile « radicale » du Parti libéral.
Montagu voyait dans le sionisme une « doctrine politique pernicieuse » et, après la publication de la Déclaration Balfour – qu’il jugeait antisémite –, il rédigea en quelque sorte sa propre déclaration, exposant ses objections au sionisme. Son opposition farouche est en partie responsable de la décision de son cousin d’inclure au moins une référence aux Palestiniens dans la Déclaration.
Dans un mémorandum, il mit en garde :
Les Turcs et les autres musulmans de Palestine seront considérés comme des étrangers, tout comme les Juifs seront désormais traités en étrangers dans tous les pays sauf la Palestine.
De manière prophétique, il avertit aussi contre la création d’un État où la citoyenneté serait accordée sur une base religieuse.
Plus important encore fut son argument selon lequel le sionisme était loin de faire l’unanimité au sein de la communauté juive anglaise :
La sympathie que le président du Local Government Board présente comme répandue et enracinée dans le monde protestant envers l’idée de restaurer le peuple hébreu sur la terre qui devait être son héritage est, je le crains, souvent un désir à peine dissimulé de se débarrasser de l’élément juif au sein des populations protestantes.
Et il ajouta :
J’affirme qu’il n’existe pas de nation juive. Les membres de ma famille, par exemple, installés dans ce pays depuis des générations, n’ont absolument rien en commun – ni opinion ni aspiration – avec une autre famille juive d’un autre pays, si ce n’est qu’ils professent, à des degrés divers, la même religion. Il n’est pas plus exact de dire qu’un Anglais chrétien et un Français chrétien sont de la même nation.
Quand on dira aux Juifs que la Palestine est leur foyer national, chaque pays voudra immédiatement se débarrasser de ses citoyens juifs, et vous verrez une population en Palestine chasser ses habitants actuels.
Comme il le résuma sobrement à la fin :
« Si la Palestine devient le foyer national des Juifs, tous les électeurs de ma circonscription me diront : “Rentrez chez vous !!!” »
D’après Weizmann, Montagu mena une guerre totale contre la Déclaration et prononça des discours enflammés à son sujet lors des réunions du Cabinet. Dans ses mémoires, Weizmann écrivit à son sujet :
Il n’apportait rien de nouveau, mais la véhémence avec laquelle il défendait ses vues, l’implacabilité de son opposition, stupéfièrent le cabinet. J’ai cru comprendre que l’homme en pleurait presque.
...
L'opposition au sionisme et au rapprochement anglo-sioniste émanait également d'institutions au sein de la communauté juive britannique. L'une d'elles était l'Anglo-Jewish Association (AJA), fondée en 1871 par l'ancien rédacteur en chef du Jewish Chronicle, Abraham Benisch, et Albert Löwy, rabbin réformé londonien. Cette organisation se consacrait à aider les Juifs persécutés à travers le monde. Dès ses débuts, elle gagna la confiance de la communauté ; en 1878, elle forma un Conjoint Foreign Committee avec le Board of Deputies of British Jews.
En 1917, ces deux institutions étaient dirigées par des Juifs britanniques hostiles au projet sioniste. David Lindo Alexander présidait le Board of Deputies, tandis que Claude Montefiore dirigeait l'AJA. Bien que souvent en désaccord sur d'autres sujets, les deux hommes partageaient une profonde antipathie envers le sionisme et sa définition essentialiste du judaïsme.
Leur opposition les poussa à tenter de devancer la Déclaration Balfour en publiant une déclaration commune le 17 mai 1917, envoyée au Times. Celle-ci ne parut qu'une semaine plus tard – retard probablement dû aux sympathies sionistes du rédacteur en chef du journal. Ce délai réduisit l'impact de leur texte, car Chaim Weizmann avait déjà annoncé publiquement le soutien imminent du gouvernement britannique à un foyer juif en Palestine.
...
L'éruption de violence à grande échelle en Palestine en 1929 a conduit à une remise en question à Londres de la politique britannique envers le pays. La « terre sans peuple », telle que la Palestine était perçue par les dirigeants sionistes et ceux soutenant la colonisation de la Palestine, s'est avérée être pleine de gens qui rejetaient catégoriquement la transformation de leur patrie en un État juif et étaient même prêts à engager une lutte armée contre cette entreprise. Il était désormais beaucoup plus difficile de faire pression pour un transfert de Juifs d'Europe vers une Palestine qui se montrait de plus en plus résistante à l'idée que le « problème juif » de l'Europe serait résolu à ses dépens.
Cette réflexion fut nourrie par une commission royale d'enquête dirigée par Lord Shaw, qui en 1930 recommanda une sévère limitation de l'immigration juive et la fin des achats de terres par les sionistes, et suggéra que la Grande-Bretagne aiderait à construire un État respectant la majorité palestinienne sur cette terre. Il s'agissait d'un revirement total par rapport à la Déclaration Balfour, et cela devint un Livre Blanc, rédigé par Sidney Webb, alors secrétaire d'État aux colonies. Une autre enquête, la commission Hope-Simpson, affirma également son soutien à une réorientation de la politique britannique en Palestine.
Le lobby sioniste fit face à son premier défi sérieux dans son travail en Grande-Bretagne ; et pourtant, étonnamment, il ne lui fallut qu'un mois pour inverser ce revirement ! Durant ce mois, le Premier ministre Ramsay MacDonald clarifia à la Chambre des communes que le Livre Blanc ne signifiait pas un retrait de l'engagement de Balfour, et, plus important encore, répéta cet engagement dans une lettre à Chaim Weizmann – tout en précisant clairement qu'il n'annulait pas le Livre Blanc. Cependant, tant les sionistes que les Palestiniens l'interprétèrent comme une annulation du Livre Blanc, ce qui est probablement plus significatif.
Ce retrait rapide laisse les chercheurs perplexes encore aujourd'hui, et certains universitaires, comme Carly Beckerman-Boys, affirment que ce revirement n'avait rien à voir avec le lobbying sioniste, mais bien plus avec le fait que changer de cap et investir dans la construction d'un véritable État palestinien à l'avenir aurait été trop coûteux. Cette considération a pu jouer un rôle, mais il existe aussi des preuves claires, comme plusieurs chercheurs l'ont démontré, que Weizmann fut intransigeant dans l'exercice de pressions sur le gouvernement britannique. Une personne en particulier fut prête à répondre à l'appel de Weizmann pour agir contre Webb (devenu Lord Passfield) et la nouvelle politique du gouvernement : l'ancien Premier ministre Lloyd George, qui participa à la campagne et fut récompensé par une invitation à être l'orateur principal dans l'un des lieux les plus prestigieux de Londres : le Savoy Hotel.
...
King et Crane recrutèrent sept experts dans différents domaines et partirent pour la région le 10 juin 1919, y restant pendant quarante-deux jours. Ils visitèrent plus de 1 500 localités – un exploit remarquable pour une si petite délégation. En Palestine, ils rencontrèrent des élites urbaines, des colons juifs et des missionnaires chrétiens. Ils se rendirent à Jaffa, Rishon LeZion, Jérusalem, Ramallah, Naplouse, Jénine, Nazareth, Haïfa et Acre avant de retourner en Turquie à bord du destroyer de la marine américaine Hazelwood. Ils saluèrent la sincérité des habitants urbains et ruraux de la Palestine. Ils découvrirent que la majorité d’entre eux étaient heureux de faire partie d’une Syrie indépendante panarabe, bien qu’un nombre non négligeable d’habitants des villes espéraient qu’un État palestinien indépendant finirait par être créé. Ils savaient surtout ce qu’ils ne voulaient pas : la présence sioniste, la déclaration Balfour et un mandat britannique ou français. Le rapport final de King et Crane évita de prendre des positions arrêtées, sauf sur un point : il affirma clairement que la population non juive de la Palestine s’opposait catégoriquement au sionisme et que les soumettre à une « immigration juive illimitée » serait une « violation flagrante » de leurs droits.
Deux des experts désapprouvèrent ce point du rapport et produisirent leur propre rapport minoritaire, reflétant mieux les positions américaine et britannique sur la Palestine. Leur rapport déclarait : « Le sionisme était dans l’intérêt supérieur du pays et de son peuple… et cela primait sur toutes les autres considérations ». Ils furent aidés par les efforts des sionistes sur le terrain pour trouver de « bons Arabes » favorables à un État juif en Palestine, mais ces manœuvres, comme les décrit Andrew Patrick, n’impressionnèrent pas les auteurs du rapport principal, qui rejetaient le sionisme.
À Paris et à Londres, le rapport fut accueilli avec méfiance, non seulement en raison de son rejet du sionisme, mais surtout parce qu’il insistait sur le droit à l’autodétermination des nations arabes dans des zones convoitées par les deux puissances européennes. Comme l’a noté Michael Reimer, « les Français, les Britanniques et même certains Américains soutenaient qu’une décision éclairée pouvait être prise à Paris [c’est-à-dire à la Conférence de paix de Versailles] concernant la Syrie sans consulter la population syrienne ». Sans de telles « décisions éclairées », un tel rapport risquait de remettre en cause le réseau d’accords secrets anglo-français, déjà mis en place en 1912, qui se partageait la Grande Syrie (Palestine, Liban, Syrie et Jordanie). La déclaration Balfour fut intégrée à cet arrangement, accordant la création d’un foyer national juif en Palestine ainsi que l’établissement d’un royaume hachémite en Transjordanie.
Le rapport ne fut publié qu’en 1922 – longtemps après que le président Wilson, le seul dirigeant mondial alors favorable à l’autodétermination arabe, eut quitté ses fonctions en raison d’un accident vasculaire cérébral invalidant. Le rapport fut soumis à la Société des Nations, mais fut immédiatement classé et ignoré.
Charles Crane accusa les sionistes et les Français d’avoir enterré le rapport, mais il semble que le Département d’État n’ait pas pu surmonter le manque d’intérêt tant à la Maison-Blanche qu’au Congrès pour impliquer davantage l’Amérique dans les affaires du monde arabe. Personne ne fit non plus d’effort concerté pour contester le soutien passif que le Congrès américain accordait au sionisme.
En ce qui concernait l’American Jewish Congress et l’American Zionist Federation, les deux principaux lobbies pro-sionistes de l’époque, l’enjeu n’était pas tant la publication du rapport que d’empêcher qu’il ait un quelconque impact. Sans qu’il y ait besoin de faire pression, le Congrès américain était déjà majoritairement pro-sioniste. Cela constitua une leçon importante sur le pouvoir de l’inertie – plus les gens tenaient le sionisme pour acquis, moins le lobby avait besoin de convaincre les politiciens de voter dans le bon sens.
Plusieurs historiens déplorèrent l’échec du rapport. S’il avait été écouté, écrivit Martin A. Smith, il aurait pu conduire à la création d’un État unitaire en Palestine (plutôt qu’à un partage) et aurait même pu contribuer à établir une Grande Syrie. Andrew Patrick va plus loin, affirmant que les peuples du Moyen-Orient n’avaient pas été pris au sérieux en 1919, ce qui a engendré des cycles de violence qui persistent encore aujourd’hui. Lori Allen, dans un livre récent, porte un jugement encore plus sévère. Elle doute même de la sincérité de King et Crane eux-mêmes, car ils étaient imprégnés d’une mentalité profondément orientaliste et concevaient les Arabes en général comme une « race » intrinsèquement incapable de former des États-nations démocratiques.
...
Il était clair qu'il y avait deux issues possibles aux délibérations de l'UNSCOP : soit soutenir l'idée d'un État juif sur le sol de la Palestine historique, soit considérer la Palestine comme un État démocratique binational, auquel cas la majorité palestinienne autochtone écrasante déterminerait l'avenir du pays. L'administration Truman, qui jusqu'alors avait gardé un profil bas dans les négociations, fut encouragée par le mouvement sioniste à exercer des pressions sur les pays pour qu'ils votent en faveur de la première option. Quant aux onze membres du comité, il était clair, même avant leur réunion, que beaucoup d'entre eux soutenaient l'idée de partitionner la Palestine en deux États.
Cette impression fut renforcée lorsque, le 14 mai 1947, Andreï Gromyko, vice-ministre soviétique des Affaires étrangères, annonça le soutien de son gouvernement à un État juif en Palestine. Ce fut un moment très important pour le lobby sioniste, qui avait suivi de près le désaccord entre le Département d'État, opposé à la partition, et la Maison-Blanche, qui y était favorable.
Quoi qu'il en soit, début novembre 1947, l'UNSCOP était prêt à soumettre deux rapports pour un vote à l'Assemblée générale de l'ONU : un rapport minoritaire proposant un État binational, avec une majorité et une identité palestiniennes, et un rapport majoritaire recommandant la partition du pays en un État arabe et un État juif.
Le Département d'État soutenait pleinement le rapport minoritaire, et le secrétaire d'État, George Marshall, était également prêt à l'approuver. Mais le lobby était en contact constant avec le président, qui penchait de toute façon pour la partition. Marshall était tiraillé entre Loy Henderson, directeur du Bureau des affaires du Proche-Orient et de l'Afrique au Département d'État, et le président. Sans l'insistance de Truman en faveur de la partition, Marshall aurait orienté la politique américaine contre celle-ci.
La question qui se posait au lobby était de savoir comment les États-Unis aideraient le mouvement sioniste durant le mois crucial de novembre 1947 pour garantir que l'Assemblée générale voterait en faveur de la résolution sur la partition. Le secrétariat de l'ONU avait déterminé qu'une majorité simple ne suffisait pas : une majorité des deux tiers était nécessaire. Le débat à Flushing Meadows sur la partition commença le 26 novembre 1947. La délégation sioniste fut surprise d'entendre le représentant des Philippines s'opposer à la résolution ; ils avaient compté son vote comme acquis en sa faveur. Le lobby en conclut que les États-Unis n'avaient pas tenu leur promesse, n'ayant pas exercé suffisamment de pression sur un pays entièrement sous leur domination. Une surprise similaire se produisit lorsque le représentant d'Haïti, également sous influence américaine et considéré comme un vote « acquis », s'exprima contre la résolution de partition.
La nuit de Thanksgiving tomba le 27 novembre, et les principaux activistes du lobby racontèrent plus tard qu'ils n'avaient pas pu profiter de leur dinde, trop occupés à supplier le président d'intensifier ses pressions sur des pays récalcitrants comme les Philippines et Haïti. Ces deux pays, ainsi que l'Éthiopie et le Liberia, étaient indispensables pour obtenir la majorité des deux tiers.
Issa Nakhleh, représentant du Comité suprême arabe, écrivit plus tard, en février 1948, au secrétaire général de l'ONU pour décrire la honte du délégué haïtien lorsqu'il dut finalement voter pour la partition. Voici un extrait de sa lettre :
« Le délégué d'Haïti a prononcé un discours très ferme contre la partition mercredi, sur instruction de son gouvernement. Samedi, il a fait circuler une note aux délégations expliquant qu'il votait pour la partition conformément à de nouvelles instructions de son gouvernement. Le délégué haïtien ne trouvait pas les mots pour décrire sa honte, et on l'a vu en larmes dans le hall et le salon des délégués. Homme sincère et noble, il ne pouvait cacher que son gouvernement avait cédé à la pression et avait été contraint de modifier ses instructions. »
En septembre 1947, le lobby avait conclu que seuls les États-Unis pouvaient obtenir la majorité des deux tiers. Maintenant, quarante-huit heures avant le vote, ses réseaux de contacts devaient donner le coup de pouce final. Les membres du lobby et les représentants officiels de l'Agence juive passèrent ces dernières heures à alterner entre le Temple Emanu-El et la suite de Chaim Weizmann au Waldorf Astoria. La plupart des réunions eurent lieu au temple, l'une des plus grandes synagogues du monde, toujours située aujourd'hui à East 65th Street et Fifth Avenue : un immense bâtiment en calcaire, mêlant styles byzantin, roman primitif, mauresque et Art déco.
Durant ces heures, même des Juifs non sionistes furent recrutés, comme Bernard Baruch, un magnat réticent qui avait fait fortune en spéculant sur le sucre et était devenu l'un des principaux industriels américains. On lui demanda d'exercer des pressions sur le New York Times pour qu'il publie un éditorial condamnant les pays qui envisageaient encore de s'abstenir ou de voter contre la partition. « J'ai accepté », confia-t-il à un ami, mais « toute cette histoire me rend malade. »
Deux personnes furent cruciales dans cet ultime effort : Sol Bloom, un congressiste pro-sioniste de New York, et David Niles. Niles, assistant spécial du président pour les affaires des minorités, était, comme l'écrit David Friedman, « un conseiller juif peu connu ou apprécié du président, et le reste appartient à l'histoire » – ce qui signifie, du moins à ses yeux, que le soutien de Truman à la partition et la reconnaissance d'Israël devaient beaucoup à Niles, qui travaillait « contre les experts ».
Niles fournissait au groupe de pression new-yorkais des informations sur l'état d'esprit à la Maison-Blanche. Il semblait que l'administration était prête à utiliser ses connexions avec les pays récalcitrants pour les persuader de voter en faveur de la partition. Mais pour cela, il fallait recruter des membres éminents de la communauté juive américaine des affaires pour aider à la mission.
Les membres du lobby et de la délégation sioniste à l'ONU utilisèrent Niles pour transmettre des messages à la Maison-Blanche sur leurs propres tentatives autonomes de pression sur les États membres réticents. Cette action indépendante scandalisa certains membres du personnel de la Maison-Blanche et du Département d'État. Matt Connelly, secrétaire particulier du président, rédigea un mémorandum pour lui transmettre une plainte du sous-secrétaire Robert Lovett : « Notre position est gravement entravée par les pressions intenses exercées par les agences juives. Il y a eu des indications de pots-de-vin et de menaces de la part de ces groupes. »
Ils menacèrent les politiciens libériens en leur disant qu'ils avaient le pouvoir de faire échouer une promesse américaine d'aide au développement des ressources naturelles du Liberia. Harvey Firestone, propriétaire de la célèbre entreprise de pneus, déclara qu'on lui avait demandé de persuader le président libérien de voter pour la partition.
Des promesses similaires de prêts et d'aide financière furent faites à Haïti, ainsi qu'une assistance politique au Nicaragua. Lovett rapporta que le délégué nicaraguayen à l'ONU l'avait informé qu'on lui avait proposé des pots-de-vin politiques : « Dans le cas du Nicaragua, le délégué s'est vu dire par certains de ces groupes que s'il coopérait, ils veilleraient à ce que leur gouvernement soit reconnu par les États-Unis. »
Il est intéressant de noter que Lovett rapporta ces plaintes, alors que le délégué philippin affirma que Lovett avait fait pression sur son gouvernement pour qu'il vote en faveur. Les « pots-de-vin », pour ainsi dire, offerts en échange d'un vote pour la partition, étaient variés : argent pour les dirigeants politiques, reconnaissance américaine pour les jeunes États, aide au développement local. Toutes ces promesses furent faites au nom des États-Unis, soit par des membres influents de la communauté sioniste américaine, soit par des représentants officiels américains. Les pays approchés incluaient la Chine, l'Équateur, le Paraguay et la Grèce.
Le Congrès juif mondial participa à ces négociations ; c'était une organisation vétérane, fondée en 1936 pour coordonner la diplomatie pan-juive en faveur des communautés juives dans le besoin. Elle se considérait également comme une organisation sioniste, tout comme ceux qui travaillaient avec elle. Cependant, ses archives ne révèlent pas le contexte des conversations avec les délégués étrangers.
Lorsque les quarante-huit heures furent écoulées, il était clair que le lobby avait fait son travail. Malgré de sérieuses réserves du Département d'État, les partisans d'Israël savourèrent le goût de la victoire. Le 29 novembre, les deux tiers des membres votèrent en faveur d'un programme qui ignorait les aspirations des Palestiniens, notamment leur droit à l'autodétermination, la construction d'un État démocratique couvrant toute la Palestine historique et l'intégration du pays dans le monde arabe. La résolution adoptée à la majorité des deux tiers par l'Assemblée générale, la résolution 181, offrait aux Palestiniens moins de la moitié de leur patrie et leur demandait d'être en union économique avec le futur État juif (tout en permettant aux citoyens des deux États de voter dans l'État de leur choix). Elle établissait également un calendrier pour le retrait britannique de Palestine (à achever avant le 15 mai 1948) et une carte délimitant les frontières des deux États.
Ce n'était pas exactement la vision sioniste – le mouvement souhaitait construire un État sur une partie bien plus grande de la Palestine et, si partition il devait y avoir, la partager avec la Transjordanie plutôt qu'avec les Palestiniens. Le mouvement rejetait également l'idée d'une Jérusalem internationale, qu'il voulait comme capitale de l'État juif. Cependant, comme des recherches récentes l'ont montré, cette version réduite du rêve sioniste fut acceptée car il était clair que les Palestiniens et le monde arabe la rejetteraient de toute façon, et que ce qui compterait serait qui aurait le pouvoir de prendre le contrôle de l'État mandataire. Pour les sionistes, l'importance de la résolution de l'ONU était sa reconnaissance de l'État juif, pas sa carte de partition ou ses arrangements. La direction sioniste avait déjà préparé les plans pour s'emparer par la force du maximum de terres palestiniennes et n'y laisser qu'un minimum de Palestiniens.
...
Le principal cheval de bataille de Fulbright était son inquiétude quant à l'influence des pays étrangers sur la politique étrangère américaine. Mais il portait un intérêt particulier à la Palestine et à Israël. Comme les Palestiniens eux-mêmes et tant d'autres personnes par la suite, il considérait le plan de partage de l'ONU de 1947 comme injuste et inéquitable, car il ne respectait pas les principes démocratiques ni le droit à l'autodétermination des Palestiniens. Il s'est très tôt heurté à l'AIPAC lorsque celle-ci a organisé le boycottage des navires arabes dans les ports, ce qu'il a qualifié d'« intervention irresponsable dans l'élaboration de la politique étrangère américaine ».
Plus tard, en 1960, il a repéré des initiatives au Capitole en faveur d'Israël, comme la pression exercée sur l'Égypte pour qu'elle ouvre le canal de Suez à la navigation israélienne. Il a affirmé que cela n'avait rien à voir avec les intérêts de la politique étrangère américaine et que c'était le résultat de « l'existence d'un groupe de pression aux États-Unis qui cherche à injecter le conflit arabo-israélien dans la politique intérieure ». Il a aussi soutenu, de manière tout à fait sensée, que de telles pressions ne feraient que renforcer la détermination de l'Égypte à refuser ce passage – et l'histoire lui a donné entièrement raison. Ses remarques conclusives sur cet incident, concernant la conviction arabe que les États-Unis prendraient toujours le parti d'Israël, méritent d'être rappelées :
« Cette conviction arabe – pour laquelle je regrette de dire que l'histoire offre certaines justifications – est le plus lourd fardeau que la diplomatie américaine doit porter au Moyen-Orient. »
Alors que l'AIPAC croyait pouvoir agir en toute impunité, Fulbright, en tant que président du Comité des relations étrangères du Sénat, a décidé d'enquêter sur les finances de l'organisation. Bien que ses sympathies pour la Palestine suggèrent qu'il considérait l'AIPAC comme nuisible aux intérêts nationaux américains, il semblait que la seule façon de limiter son influence sur la politique des États-Unis était de l'accuser de fraude fiscale.
Il a allégué que l'AIPAC violait le Foreign Agents Registration Act, une loi destinée à limiter le financement par des nations étrangères des campagnes politiques. Il a lancé des auditions et produit des preuves accablantes. Les trois cents pages du rapport d'enquête ont révélé que diverses organisations pro-sionistes utilisaient des fonds exonérés d'impôts, collectés via l'United Jewish Appeal (destinés à aider les communautés pauvres en Israël), pour financer les activités de l'AIPAC aux États-Unis. En quatre ans, le lobby avait levé 5 millions de dollars, en franchise d'impôts, auprès de la communauté juive américaine. Une partie de cet argent provenait même de deux mafieux notoires, Aaron Weisberg et John Factor, surnommé « Jack le Barbier ».
Le comité de Fulbright s'est appuyé sur des écoutes du FBI et des documents subpoenaés, révélant comment les abonnements au Near East Report, organe de propagande de l'AIPAC, servaient à contourner les règles fiscales pour les donateurs. Mais la violation la plus flagrante des réglementations financières provenait des liens entre l'AIPAC et l'Agence juive en Israël. Cette organisation sioniste, vestige de l'époque pré-mandataire, jouait un double rôle après la création d'Israël : judaïser les terres en Israël et financer le lobbying à l'étranger.
Le système était assez complexe. Une partie des fonds nécessaires à l'AIPAC venait directement d'Israël – par exemple, Kenen recevait des paiements trimestriels de 5 000 dollars pour son travail. Mais la majeure partie provenait de donateurs juifs américains achetant des obligations israéliennes. Officiellement, ces donateurs recevaient des parts dans des projets en Israël, censés se concentrer sur des questions sociales et aider les communautés défavorisées. En réalité, une partie de l'argent revenait à l'AIPAC via une nouvelle entité, la Jewish Agency American Section, enregistrée aux États-Unis. Le comité de Fulbright a découvert qu'aucun de ces fonds n'atteignait les citoyens israéliens dans le besoin. Au lieu de cela, l'argent allait à l'État israélien, qui le renvoyait immédiatement aux États-Unis – directement vers des organisations sionistes. Par exemple, pendant huit ans, 80 % du budget de l'AZEC (dont l'AIPAC était officiellement la branche de lobbying) provenait de l'Agence juive en Israël. Fulbright était à la recherche de ces violations, et il les a trouvées. Entre 1955 et 1962, la Jewish Agency American Section a ainsi reçu 5 millions de dollars de donateurs américains – des fonds initialement destinés aux plus démunis en Israël.
Cet argent servait aussi à financer des voyages en Israël organisés par l'American Christian Palestine Committee, ainsi que des chaires de culture hébraïque dans les universités américaines.
Comme l'a révélé Alfred Lilienthal en 1995, ces fonds masqués « touchaient presque tous les aspects des relations judéo-chrétiennes » et graissaient les rouages de la machine à influencer les médias et les politiciens américains pour qu'ils adoptent une position pro-israélienne.
Un autre organe important financé par Israël, avec l'argent des Juifs américains, était la Jewish Telegraphic Agency (JTA). À l'origine, cette agence s'intéressait aux affaires juives en général, mais elle est progressivement devenue un porte-voix d'Israël et une partie du lobby aux États-Unis. Fondée en 1917 pour informer les médias internationaux sur les questions concernant les communautés juives, elle est restée très fidèle au récit israélien jusqu'au XXIe siècle. Mais comme d'autres organisations juives progressistes, elle est devenue plus critique envers Israël à l'époque de Netanyahu, se distanciant clairement de l'AIPAC : « Nous respectons les nombreuses organisations de défense juives et israéliennes, mais la JTA a une mission différente : fournir une information équilibrée et fiable. » Cette nouvelle ligne a poussé le lobby à créer en 2010 une agence de presse alternative, le Jewish News Service, loyal à la droite israélienne. Mais dans les années 1960, la JTA affichait une fidélité absolue à la narration israélienne.
Fulbright est devenu l'ennemi juré du lobby pro-israélien, qu'il fallait abattre par tous les moyens. L'AIPAC a immédiatement commencé à faire pression sur le nouveau président, John F. Kennedy, et son vice-président, Lyndon B. Johnson. Le conseiller aux affaires juives de Kennedy, Myer Feldman, a averti le président : « La communauté juive est très inquiète à propos de cette enquête. » La pression a partiellement fonctionné : Fulbright a accepté, à contrecœur, de tenir les auditions à huis clos.
Mais cela n'a pas empêché les méfaits de l'AIPAC d'être révélés. Un résumé du rapport accablant a été publié dans Newsweek le 12 août 1963, provoquant un tollé immédiat. Le souvenir de ces auditions a motivé l'AIPAC à saboter la carrière de Fulbright à chaque occasion.
La dernière goutte d'eau a été son refus de rejoindre un groupe de 59 sénateurs et 238 représentants qui ont signé une tribune dans le New York Times (le 11 mai 1969) attaquant la position de l'ONU sur le conflit – notamment sa demande qu'Israël se retire des territoires occupés lors de la guerre de juin 1967 et son inquiétude pour le sort des réfugiés palestiniens. Son opposition ultérieure à un financement massif d'Israël était déjà anticipée par l'AIPAC, tout comme ses doutes quant à l'octroi d'une aide de 2 milliards de dollars après la guerre d'octobre 1973 :
« Au lieu de réarmer Israël, nous pourrions avoir la paix au Moyen-Orient immédiatement si nous demandions simplement à Tel Aviv de se retirer derrière ses frontières de 1967 et de les garantir. »
La campagne contre lui est devenue un modèle pour l'AIPAC. Le Near East Report l'a accusé d'être « constamment hostile à Israël et à ses partisans dans ce pays ». Tout a été fait pour qu'il ne soit pas réélu. Des fonds du lobby ont afflué vers la campagne de son rival, le gouverneur de l'Arkansas Dale Bumpers, lors des primaires démocrates de mai 1974. Tous ses opposants ont été financés et soutenus.
Selon les mots de Lilienthal :
« Au nom des Juifs de l'Arkansas, l'avocat Philip Kaplan a déclaré que "Fulbright est un Néandertalien". Philip Back, président local de Bonds for Israel, a affirmé que la déclaration du sénateur selon laquelle le Congrès était contrôlé par Israël était "universellement détestée par les Juifs de l'Arkansas, et il devrait être renvoyé à la vie privée". Un proche de Bumpers s'est vanté auprès du Chicago Tribune : "J'aurais pu acheter le centre de l'Arkansas avec les offres d'argent de la communauté juive – elles venaient surtout de New York et de Californie, où l'on collecte beaucoup de fonds à des fins politiques." »
Depuis lors, le chemin vers le Capitole est jonché de candidats, parmi l'élite politique américaine, dont les carrières ont été torpillées de la même manière par l'AIPAC. C'est ainsi que le lobby a manipulé la politique du Congrès avec un tel succès que très peu ont osé, depuis, suivre les traces de Fulbright."
...
"Dans cette campagne particulière, AIPAC a été chargée de cibler des médias que Israël négligeait habituellement, comme Al Jazeera. Plus précisément, le lobby a été appelé sur le champ de bataille après que la chaîne a diffusé un documentaire d’investigation intitulé The Lobby. Bien que le premier volet ait été diffusé avec succès en Grande-Bretagne, la seconde partie, portant sur les actions du lobby américain, n’a jamais pu être diffusée.
AIPAC a réussi à la censurer, et elle n’est désormais disponible que sur YouTube. Dans ses actions, AIPAC a révélé à quel point elle pouvait contrôler le droit à la liberté d’expression aux États-Unis. Mais que cherchait-elle tant à dissimuler ? Le journaliste d’Al Jazeera, James Anthony Kleinfeld, a réussi à se faire passer pour un fervent soutien d’Israël et a été accueilli par plusieurs organisations pro-israéliennes pendant les ères Obama et Trump. Il a été invité par des groupes tels que StandWithUs, le Brandeis Center, l’Israel Project, la Foundation for Defense of Democracies, l’Israel on Campus Coalition, la Zionist Organization of America, Fuel for Truth et le Canary Mission.
Penchons-nous sur les activités de ces organisations – toutes toujours actives aujourd’hui – en commençant par StandWithUs (SWU), également connu sous le nom d’Israel Emergency Alliance. Fondée en 2001 par Roz Rothstein, une thérapeute familiale de Los Angeles, l’organisation a gagné en visibilité autour de l’élection de Trump en 2016, avec dix-huit responsables à plein temps aux États-Unis et des antennes ailleurs. Selon des recherches récentes, SWU considère la Cisjordanie comme faisant partie d’Israël et soutient la légitimation des colonies illégales israéliennes. Sur leur site web, ils consacrent une large place à la Cisjordanie, qu’ils appellent « Cisjordanie/Judée-Samarie ». Ils affirment que l’argument selon lequel la Cisjordanie appartient à Israël et devrait être nommée Judée-Samarie est aussi valable moralement et juridiquement que le point de vue inverse (c’est-à-dire qu’il s’agit d’un territoire illégalement occupé). On pourrait comparer cela à dire que l’opposition à l’apartheid en Afrique du Sud et son soutien étaient tous deux moralement et juridiquement défendables.
SWU agit dans plusieurs domaines. Elle est active sur les campus américains, où elle imite le travail d’une ONG israélienne, Im Tirtzu, soutenue par le gouvernement, dont le rôle principal est de surveiller les enseignants des universités israéliennes pour détecter d’éventuels messages anti-sionistes dans leurs cours. SWU dispose d’une armée similaire de militants chargés de missions identiques. Ils sont même plus systématiques que leur homologue israélien, et il est possible d’obtenir un diplôme de « fellow » ou « ambassadeur » dans nombre de leurs programmes de formation au militantisme pro-israélien. Sur les campus américains, SWU a tenté d’empêcher étudiants et professeurs de soutenir le mouvement BDS. Les différents gouvernements Netanyahu appréciaient beaucoup Roz Rothstein, et le ministère israélien des Affaires étrangères a contribué au financement des opérations de SWU aux États-Unis. Rothstein a été saluée par le Jerusalem Post (de droite) comme l’une des cinquante femmes juives les plus influentes au monde en 2016. En 2008, avec l’aide du Jerusalem Post, SWU a commencé à publier le Campus Post, un journal mensuel comprenant des articles de journalistes du Jerusalem Post sur l’actualité, la société et la culture israéliennes, tandis que des étudiants et d’autres contributeurs nord-américains écrivaient sur le militantisme pro-israélien. Cependant, cette publication n’a pas duré.
SWU est également très procédurière : elle dispose d’un service juridique employant quatre-vingts avocats, qui instrumentalisent les procédures judiciaires contre les résolutions BDS et les militants pro-palestiniens sur les campus. Elle gagne souvent – mais pas toujours. L’une de ses défaites les plus retentissantes a été sa campagne contre l’Olympia Food Co-op dans l’État de Washington. Cet affrontement, ainsi que deux autres impliquant l’Université de Fordham et l’entreprise Caterpillar, illustrent bien l’étendue des capacités juridiques du lobby et sa détermination à étouffer toute tentative de solidarité avec la Palestine.
L’Olympia Food Co-op a débuté comme une petite épicerie dans le centre d’Olympia en 1977. Faisant partie d’un réseau de coopératives alimentaires émergent dans la région, elle privilégiait les matériaux recyclés pour la construction de ses magasins. La Co-op est dirigée par un conseil d’administration. En 2010, celui-ci a décidé de boycotter les produits israéliens. Cinq membres, soutenus par SWU, ont poursuivi leurs collègues, affirmant que le conseil avait outrepassé ses attributions et violé ses obligations fiduciaires. SWU a d’abord revendiqué le dépôt de la plainte, déclarant qu’elle découlait d’un partenariat avec le ministère israélien des Affaires étrangères. Après huit ans de procédures et plusieurs décisions de justice, le tribunal a jugé la plainte illégale. SWU est devenue ambiguë sur son implication et s’est retirée, probablement gênée par cet échec.
En apparence, l’affaire de l’Université de Fordham était similaire – mais cette fois, SWU a gagné. En 2016, Fordham a refusé la demande du groupe Students for Justice in Palestine (SJP) d’être reconnu comme association étudiante officielle, arguant que ses objectifs allaient « à l’encontre de la mission et des valeurs de l’université ». Les étudiants de SJP ont porté plainte et ont gagné en première instance, invoquant une violation des règles internes de Fordham, interdite par l’Article 78 du droit civil new-yorkais. L’université a fait appel, et en 2020, SWU a déposé un mémoire amicus curiae soutenant Fordham. Roz Rothstein a déclaré que Fordham était l’une des premières universités à « reconnaître la bigoterie de SJP ». SWU a argué que les tribunaux avaient une compétence limitée pour dicter les décisions des universités privées, et que la position de Fordham était conforme au Titre VI du Civil Rights Act, qui interdit la discrimination raciale dans les programmes bénéficiant de fonds fédéraux. La cour d’appel a donné raison à Fordham, et en mai 2021, la Cour d’appel de New York a rejeté la requête des étudiants, mettant fin à quatre ans de procédure.
Entre l’échec à Olympia et le succès à Fordham, il y a eu des cas non conclusifs, comme la lutte pour « sauver » Caterpillar – le plus grand fabricant mondial d’équipements de construction – des « griffes » du mouvement BDS. Son bulldozer jaune emblématique, le D9, est devenu le symbole de l’une des méthodes les plus terrifiantes de l’occupation israélienne : la démolition des maisons palestiniennes. Le « Dubbi », ou « Teddy Bear » (D9R), en était la version améliorée, désormais protégée des pierres lancées par des victimes désespérées. Un conducteur de D9R a tué l’activiste américaine Rachel Corrie à Gaza en mars 2003.
En 2005, le groupe pro-palestinien Jewish Voice for Peace (JVP) a présenté une résolution lors d’une assemblée d’actionnaires de Caterpillar, en partenariat avec quatre ordres religieux catholiques. Ils demandaient à l’entreprise d’enquêter sur l’utilisation de ses bulldozers pour détruire des maisons palestiniennes, ce qui, selon JVP, violait son code éthique. SWU a réagi en incitant ses membres à acheter des actions Caterpillar et à écrire des lettres de soutien. Ses représentants ont tenté de convaincre les actionnaires que Caterpillar était injustement ciblé. Depuis, le mouvement de solidarité avec la Palestine manifeste chaque année lors des assemblées, tandis que les D9 continuent de raser des maisons palestiniennes (au moment où ce livre était écrit, ils étaient utilisés dans le camp de réfugiés de Jénine en juillet 2023)."