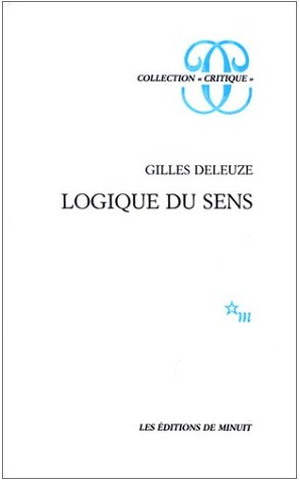Deleuze en pleine fraîcheur, il s'engage dans la fabrication d'un engin.
Il y a quelque chose de rustique dans cet ouvrage, de primitif, on découvre comme un type inédit de bombe artisanale. C'est qu'il contrevient implicitement au principe cartésien, éminemment moderne, selon lequel une pensée n'est pas un corps, il ignore cette idée commune selon laquelle l'entendement ne se développe pas dans l'étendue. Spinoza lui-même disait encore que l'entendement ne peint pas de "tableaux". (Même si, entre parenthèses, j'aimerais ajouter en schématisant sans aucune vergogne que cette distinction entre corps et entendement serait elle-même, sans doute, plutôt envisagée sous l'angle matériel chez Spinoza, et abstrait chez Descartes. Ce qui n'est pas anecdotique, étant donné que ça permet la filiation Spinoza-Deleuze et explique le manque de goût de ce dernier pour le pauvre René, condamné à l'inconsistance. À moins que je dise n'importe quoi, mais peu importe, bienvenue.) En d'autres termes, Deleuze envoie valser l'idée que concepts logiques et phénomènes physiques vaqueraient dans des domaines distincts, et ce au grand bouleversement des éléments en présence. Tout sur le même plan, ça s'appelle l'immanence.
Alors Deleuze renoue avec le vieux Héraclite, et on entre en contact avec un tout autre entendement, un prototype bricolé à l'ancienne. Les concepts se configurent suivant des rapports matériels, spatiaux, corporels, en images, en mouvements, selon des relations complexes et paradoxales de surface, de fêlure, de profondeur, de vaporisation, de survol. C'est la logique du sens.
Héritier mutant de Hume, Deleuze est empiriste. Mais attention, cet empirisme ne se présente pas comme une thèse objective à défendre, du type "l'expérience sensible est à la base toute connaissance". Non, on est plutôt en présence d'une épreuve matérielle et vitale. C'est pourquoi un tel empirisme est dit transcendantal, c'est-à-dire que le penseur ne disserte pas du dehors, suivant un point de vue logique, sur un hypothétique primat de l'expérience sensible ; au contraire c'est la muette et aveugle expérience, elle seule, qui fournit au philosophe ses matériaux. Autant que possible, cette insensée logique du sens ne s'ancre donc pas dans des abstractions a priori, mais s'élabore par impressions et expressions, par signes et images prises dans le mouvement du divers. Si de la cohérence est produite, c'est prise dans le chaos, loin des catégories traditionnelles et stables d'une logique absolue. Si quelque chose de nouveau s'organise, c'est uniquement à partir et au sein des flux.
Deleuze tient ferme la barre et ne dévie pas de ce programme déroutant, sa lecture nous plonge dans une matière fortement contre-intuitive, elle nous retourne comme un spaghetti dans une expérience de chimie amusante. Mais après tout, pourquoi cette entreprise absurde, pourquoi, alors que le rationalisme classique agit déjà comme un outil extrêmement puissant dans le corps-à-corps avec les phénomènes, pourquoi imposer à la pensée les violents caprices et les tangibles contraintes de la matière ? Pourquoi la logique du sens ? Parce qu'un philosophe n'a pas à rester en paix, il s'embarque à l'aventure.