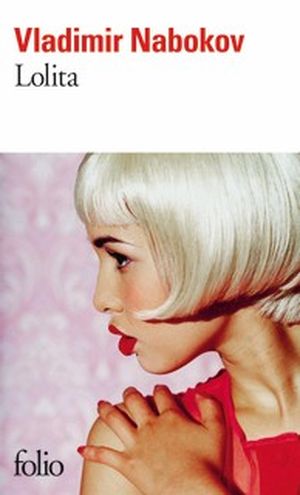Vladimir Nabokov, écrivain américain d’origine russe, tente de publier Lolita aux États-Unis en 1955 : refus catégorique des éditeurs, qui qualifient le roman d’ «insensée perversité» et de «pornographie pure». Nabokov se tourne alors vers Maurice Girodias, un éditeur parisien d’ouvrages sulfureux, qui accepte de publier le roman. Censure et scandale accompagnent la sortie de Lolita, qui rencontre pourtant un succès fulgurant. Stanley Kubrick le porte à l’écran en 1974, et Lolita devient une icône incontournable de la culture pop. Une antonomase qui désigne une “jeune fille aguicheuse qui joue avec la faiblesse des hommes”. Un contresens égrillard lorsqu’on connaît l’histoire de Nabokov.
Lolita, de son vrai nom Dolores Haze, a 12 ans lorsque sa mère meurt dans un accident de voiture. Démarre alors un long périple avec “Humbert Humbert”, son nouveau beau-père qui voue une inénarrable passion pour les “nymphettes”. Les nymphettes sont ces “pucelles, âgées au minimum de neuf ans et au maximum de quatorze ans, qui révèlent à certains voyageurs ensorcelés, comptant le double de leur âge et même bien davantage, leur nature véritable, laquelle n’est pas humaine mais nymphique (c’est-à-dire démoniaque).”
Humbert raconte l’errance de Lolita depuis la prison où il attend son jugement. Nabokov fait un pari incroyablement audacieux en proposant au lecteur de se mettre dans la peau d’un pédophile ; avec une finesse et une intelligence prodigieuses, Nabokov parvient à nous faire aimer Humbert, qui se qualifie pourtant lui même de “détraqué” et de “pédo-névrosé”. Le passage de la narration à la première personne à la narration à la troisième nous permet à la fois de nous identifier au personnage, tout en prenant du recul sur la situation ; cet équilibre magistralement bien orchestré par Nabokov nous positionne en tant que témoins et juges d’une idylle impudente. On a presque l’impression d’étudier un cas clinique - les références d’Humbert au milieu psychiatrique sont d’ailleurs nombreuses, et notre éthique s’endort au fil des pages qui défilent, comme Humbert s’endort lui-même dans son imagination malsaine.
Et pire, on en vient presque à comprendre et à pardonner Humbert pour sa monomanie des jeunes filles ; il redouble de stratagèmes pour intellectualiser et dédramatiser ses vices, en mettant en avant des arguments juridiques et ethnologiques. Humbert parle du “Children & Young Act” de 1933 qui stipule qu’à partir de 7 ans une fille n’est plus une enfant mais une jeune personne, évoque l’Inde qui autorise les mariages avec les enfants, et atténue la notion de pédophilie en préférant parler de “nympholepte” : “Pour être nympholepte, il faut être un artiste doublé d’un fou, une créature d’une infinie mélancolie, avec une flamme de poison ardent dans les reins”, explique-t-il.
Le bourreau devient la victime d’une créature fantasmagorique et éthérée qui provoque l’affolement des sens du pauvre Humbert. Il parvient à rallier le lecteur à sa cause en admettant ses torts, demande pardon pour ses actes “pervers”, pour son “démon” incontrôlable. Il flatte son audience, parle de son “docte lecteur”, du “lecteur perspicace qui aura deviné depuis longtemps” le twist final que nous propose Nabokov.
Le tortionnaire nous convainc presque de son innocence. Il présente Lolita comme une créature hors du temps, un monstre aguicheur et responsable de sa propre démence. Mais le “docte” lecteur dont il parle n’est pas dupe : même si les états d’âme de Lolita ne sont pas exprimés et que son indolence pourrait passer pour du consentement, l’enfant paraît avoir parfaitement conscience d’être sous la férule d’un beau-père abusif. Lolita n’est pas cette créature chimérique dont parle Humbert, mais une enfant comme les autres. Elle parle d’ailleurs de “viol” dès son premier rapport sexuel avec Humbert, lui reproche d’être une “espèce de brute”, et on découvre “les sanglots la nuit - chaque nuit, chaque nuit” versés par Lolita dès que Humbert Humbert fait mine de dormir. Oui, Lolita est bien la victime et non le bourreau. Une enfant abusée, désabusée, ce que Nabokov confirme dans une interview avec Bernard Pivot : «Eh bien, Lolita n'est pas une jeune fille perverse. C'est une pauvre enfant. Une pauvre enfant que l'on débauche et dont les sens ne s'éveillent jamais sous les caresses de l'immonde Monsieur Humbert.»
On pourrait penser que Nabokov a choisi ce sujet tabou pour mettre en garde contre les dangers de la pédophilie, ou au contraire pour en faire l’éloge - le récit nous fait parfois douter sur les véritables intentions de l’auteur. Ce dernier explique : “À mes yeux, une oeuvre de fiction n’existe que dans la mesure où elle suscite en moi ce que j’appellerai crûment une jubilation esthétique, à savoir le sentiment d’être relié quelque part, je ne sais comment, à d’autres modes d’existence où l’art (la curiosité, la tendresse, la gentillesse, l’extase) constitue la norme.” Il exclut toute notion de moralité ou d’apologie de la pédophilie : pour lui, ce qui importe, c’est l’art. Nabokov aurait-il donc écrit “Lolita” sans arrière-pensée ni désir de venger toutes les jeunes filles abusées ? Serait-ce simplement une apologie de l’esthétisme, de la nitescence de la littérature anglaise ?
Analysons un instant l’impact que ce roman a eu sur les générations futures : “Lolita” est devenu dans le langage courant une “jeune fille aguicheuse qui joue avec la faiblesse des hommes”. Ce contresens abominable ne traduit pas la volonté de Nabokov, qui montre à plusieurs reprises dans son roman que Lolita souffre de la situation.
C’est cette mésinterprétation qui a poussé Christophe Tison, un écrivain français également victime d’abus sexuels dans sa jeunesse, à publier “Journal de L”. Un ouvrage paru aux Éditions Goutte d’Or en 2019, où Christophe donne la parole à Lolita.
Je ne peux que recommander ce livre aux amoureux des mots. “Lolita” est une odyssée littéraire, un phénomène qui continue d’inspirer toutes les générations. Un succès mondial qui expose le délire libidineux d’un personnage à la fois détestable et délectable, un homme qui confond son imaginaire vicieux avec la réalité. Je n’aurais jamais pensé pouvoir adopter le point de vue d’un pédophile sans en ressentir une certaine culpabilité, mais Nabokov m’a prouvé l’ambiguïté du crime : si le crime n’est que pulsions incontrôlables, que le coeur et le cerveau sont malades, que l’accusé reconnaît ses torts et a des remords, est-il toujours blâmable ?
La réponse est oui, indubitablement : une enfance brisée par un pédophile ne connaît pas de châtiment assez fort. Ce qui ne nous empêche pas de dévorer le roman de Nabokov et de nous laisser transporter dans un flot d’émotions et de sensations.